SECTION 2 ANALYSE DES
ACTIVITÉS DES PROGRAMMES
Le résultat stratégique du Service correctionnel du Canada (SCC) se lit comme suit : «
Hébergement
et réinsertion sociale efficace et en toute sécurité des délinquants dans les collectivités
canadiennes
». Pour atteindre ce résultat stratégique, le SCC compte sur les deux activités
de programme. La première est la Prise en charge et la Garde et la
deuxième est la Réadaptation et la Gestion
des cas. Comme on l'indique à la section 1, les plans, les priorités et les résultats ont été regroupés
pour ces deux activités.
Description de l'activité de programme :
Administrer des peines au moyen de la garde raisonnable, sécuritaire
et humaine.
L'activité
prise en charge et garde
comprend une vaste gamme d'activités destinées à répondre
aux besoins des délinquants en matière de santé et de sécurité. La prise en charge consiste plus
particulièrement à répondre aux besoins de base des détenus tels que l'alimentation, l'habillement et
les soins de santé mentale et physique. La garde renvoie à des questions de sécurité dans les
établissements
et dans la collectivité, c'est-à-dire assurer la sécurité dans les établissements, interdire la
consommation de drogue, placer les délinquants dans les établissements appropriés et contrôler leurs mouvements
en fonction du risque et pour prévenir les incidents liés aux cas d'incompatibilité.
Résultat escompté
: garde raisonnable, sûre, sécuritaire et
humaine.
L'activité
prise en charge et garde
comprend les sous-activités clés suivantes : sécurité,
services de santé, services en établissement et services de logement .
Pour l'exercice 2004/05, les priorités associées à cette activité de programme étaient les suivantes:
-
améliorer la sécurité dans les établissements à sécurité
maximale;
-
améliorer les stratégies opérationnelles pour maîtriser l'offre de drogues et réduire
la demande;
-
réduire l'incidence négative de la toxicomanie sur le comportement des délinquants pendant leur
incarcération et après leur mise en liberté;
-
réduire le risque de transmission des maladies infectieuses; et
-
optimiser la prestation de services de santé mentale
accrédités.
Les dépenses totales prévues et réelles ainsi que les ressources humaines affectées à la réalisation
des plans établis pour cette activité figurent dans les tableaux suivants:
Prise en charge et garde – Ressources financières 2004-2005 (en millions de dollars)
|
Dépenses prévues
|
Autorisations
|
Dépenses réelles
|
|
1 199,9 $
|
1 224,3 $
|
1 161 $
|
Prise en charge et garde – Ressources humaines 2004-2005
|
Prévues
|
Autorisations
|
Réelles
|
|
10 960
|
S.O.
|
10 898
|
Assurer la
sécurité publique tout en protégeant les droits de tous les Canadiens et les Canadiennes est un élément
fondamental du mandat du Service. Les plans et les sous-activités liés à la sécurité pour 2004/05
inclus:
Modifier les activités opérationnelles de première ligne, au besoin.
Tout au long de l'exercice, le SCC a mis en œuvre plusieurs initiatives afin de continuer à améliorer
la sécurité des
détenus, des employés et des membres du public. Plus spécifiquement:
-
examen de tous les plans correctionnels des délinquants incarcérés dans un établissement à sécurité maximale;
-
adoption de procédures améliorées de contrôle des déplacements par tous les établissements;
-
ajout de postes de directeur adjoint, Programmes de
sécurité, dans les établissements à sécurité maximale;
-
élaboration et application d'un Système de profils et d'indicateurs du climat (SPIC) dans tous les établissements à sécurité maximale
pour déterminer les facteurs qui contribuent à l'augmentation du risque en établissement et prendre les mesures
nécessaires pour prévenir les incidents;
-
organisation de séances
d'information sur la gestion des gangs à l'intention du personnel de première
ligne afin d'améliorer la sécurité dynamique des établissements;
-
donne des séances de formation spécialisée aux agents de libération conditionnelle dans
la collectivité, à la suite du meurtre tragique d'une agente de libération conditionnelle à Yellowknife;
-
augmentation des fouilles régulières et
prévues dans tous les établissements; et
-
mise en œuvre d'une politique permettant à tous les agents de correction de première ligne dans les établissements à sécurité maximale, à sécurité moyenne
et multisécuritaires d'être équipé de menottes.
Améliorer les méthodes de collecte de renseignements stratégiques pour enrayer les risques que présentent
les
délinquants, y compris la mise en oeuvre du programme amélioré de formation des agents de renseignements
de sécurité.
L'importance du modèle de gestion du renseignement stratégique et du perfectionnement continu des employés
du SCC est particuli'erement visible étant donné la croissance du crime organisé, comme en témoigne le
nombre de délinquants affiliés à des gangs.
-
Au 31 mars 2005, 1 664 délinquants (1 047 en établissement et 617 dans la collectivité) étaient
membres d'une organisation criminelle ou y étaient associés, ce qui représente 8 % de la population de
délinquants totale du SCC.
-
En 2004-2005, 14 % des incidents graves survenus en établissement mettaient en cause un ou plusieurs détenus
affiliés à un gang ou à une
organisation criminelle
11
.
Dans la collectivité,
cette proportion est de 7 %.
L'approche adoptée par le SCC pour gérer le problème des gangs et des associations criminelles fait appel à des
stratégies de répression et d'intervention. En 2004 /05 , le SCC a adopté un modèle de gestion du
renseignement stratégique et la formation initiale du personnel est maintenant
terminée. La mise en œuvre de ce modèle
améliorera la capacité en matière de gestion des renseignements stratégiques ou des processus normalisés
qui seront mis en place pour améliorer l'échange de renseignements au sein du SCC et avec différents partenaires
et intervenants. La surveillance et l'analyse améliorée des incidents, des rapports et des renseignements devraient
contribuer dans un avenir rapproché à la
détection et à la prévention de la violence ainsi que
des activités criminelles liées à la drogue et aux gangs dans les établissements.
Contribuer à l'élaboration d'un projet complet d'échange d'information et d'interopérabilité en
matière de sécurité publique et renforcer les partenariats avec des intervenants du système de justice
pénale et d'autres organismes
fédéraux (p. ex. la police, les organismes de SPPCC).
Pour faire suite à l'engagement du gouvernement d'améliorer la capacité globale d'échange d'information
des organismes de justice pénale, le SCC a entrepris d'accroître la connectivité avec d'autres partenaires de
justice pénale. Par exemple, mentionnons les établissements résidentiels communautaires (ERC) du secteur privé,
les organismes de surveillance
à contrat, les services correctionnels et les bureaux de libération conditionnelle provinciaux
et les services de police. Éventuellement les tribunaux, les procureurs de la Couronne et l'Agence des services frontaliers
du Canada auront eux aussi un accès similaire. À ce jour, les ERC et les organismes d'enquête communautaire
et de surveillance des libérés conditionnels (OECSLC) suivants sont connectés au SGD :
-
la
totalité des ERC et 62 % des OECSLC des provinces de l'Atlantique
-
87 % des ERC et la totalité des OECSLC de la région du Québec
-
la totalité des ERC et des OECSLC de la Colombie-Britannique et du Yukon;
-
91% des ERC et la totalité des OECSLC de l'Alberta; et
-
50% des ERC du Manitoba; et
-
13% des ERC de l'Ontario.
InfoPol, un système permettant aux services de police d'avoir accès à
des renseignements pertinents sur les
délinquants sous responsabilité fédérale, a aussi été mis à la disposition d'autres
utilisateurs policiers au cours du dernier exercice. Au mois de mars 2005, quelque 1 040 utilisateurs des cinq régions
du SCC y étaient connectés, incluant tous les principaux services de police. Un plan a été élaboré en
vue d'établir la connectivité avec de petits
services de police et des détachements de la GRC.
D'autres initiatives d'échange d'information ont aussi été entreprises en collaboration avec Passeport Canada,
l'Agence des services frontaliers du Canada, le registre des délinquants sexuels de l'Ontario et le Centre canadien de la
statistique juridique.
Des initiatives ont aussi été mises en œuvre pour mettre en place un réseau protégé permettant
la communication
électronique de renseignement de sécurité entre divers organismes (RINS) et accroître
la capacité du SCC de reprendre ses activités après sinistre.
Indicateurs de rendement clés et autres indicateurs
Les résultats initiaux des plans et activités décrits ci-après sont encourageants. Comme le montrent
les indicateurs de rendement clés, le SCC a considérablement amélioré ses
résultats dans un certain
nombre de domaines.
Incidents graves survenus dans les établissements
Au cours de l'exercice 2004/05, environ 18 600
12
délinquants ont été incarcérés à un
moment ou à un autre pendant l'année. Il s'est produit 55 incidents de sécurité graves pendant cette
période, ce qui représente une
diminution importante par rapport à l'année précédente (81).
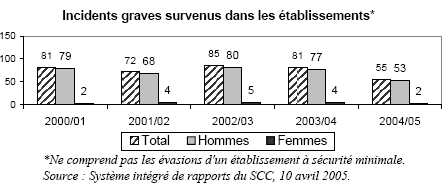
D'autres données sur les incidents graves survenus dans les établissements sont présentées dans le tableau
suivant :
Incidents graves survenus dans les établissements*
|
|
2000/01
|
2001/02
|
2002/03
|
2003/04
|
2004/05
|
|
Meurtres – Employés
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Meurtres – Détenus
|
0
|
1
|
2
|
8
|
3
|
|
Tentatives de meurtre – Détenus
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
|
Prises d'otages / séquestrations
|
5
|
2
|
3
|
1
|
2
|
|
Suicides de détenus
|
9
|
13
|
12
|
11
|
9
|
|
Voies de fait graves contre des employés
|
3
|
3
|
0
|
0
|
1
|
|
Voies de fait graves contre des détenus
|
54
|
31
|
51
|
43
|
31
|
|
Bagarres importantes entre détenus
|
0
|
7
|
11
|
7
|
6
|
|
Incidents violents
|
8
|
9
|
4
|
8
|
1
|
|
Évasions d'établissements à
sécurité maximale ou moyenne
|
2
|
5
|
0
|
2
|
2
|
|
Évasions lors de sorties sous escorte
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
N bre total d'incidents graves
|
81
|
72
|
85
|
81
|
55
|
|
Taux par 1 000 détenus
|
4,4
|
3,9
|
4,6
|
4,4
|
3,0
|
Comme le montre le tableau présenté ci-après, le SCC a réussi à réduire le
nombre d'évasions
des établissements à sécurité minimale en assurant une meilleure gestion de la population carcérale
et augmentant les mesures de sécurité dynamique dans ses établissements.
Évasions d'un établissement à sécurité minimale*
|
|
2000/01
|
2001/02
|
2002/03
|
2003/04
|
2004/05
|
|
Nombre d'évasions
|
80
|
56
|
48
|
54
|
31
|
|
Taux par 1 000 détenus
|
15,2
|
10,7
|
9,8
|
10,8
|
7,3
|
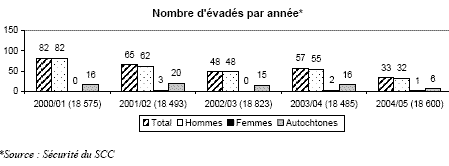
Sur les 33 évadés, 31 ont été repris et deux sont encore
en liberté. En 2004/05, le nombre
de crimes connus commis par des évadés a diminué par rapport au nombre enregistré pour l'exercice précédent
(7 et 16 respectivement). Sur les sept crimes commis, les deux plus graves étaient des vols qualifiés. Les fugitifs
qui ont été capturés ont passé en moyenne 25 jours en liberté.
Parmi les incidents graves survenus dans les établissements figurent les voies
de fait contre des employés qui ont
donné lieu à des blessures graves. Le SCC prend très au sérieux ce type de comportement violent. Conformément à la
politique établie, il signale ces incidents à la police et veille à ce qu'ils soient suivis de conséquences
dans le cadre du système disciplinaire interne et/ou de poursuites au tribunal.
Blessures signalées à la suite de voies de fait sur un
employé
|
Type de blessure
|
2000/01
|
2001/02
|
2002/03
|
2003/04
|
2004/05
|
|
Grave
13
|
3
|
3
|
0
|
0
|
1
|
|
Sans gravité
14
|
99
|
89
|
90
|
85
|
62
|
|
Taux par 1 000 employés
|
8,1
|
7,3
|
7,1
|
6,7
|
5,0
|
|
Source : Système intégré de rapports du SCC, 10 avril
2005.
|
Saisies de drogues dans les établissements
Le Service prend de plus en plus de mesures pour
éliminer les drogues de tous les centres et unités correctionnels.
La consommation de drogues a des répercussions importantes sur la santé et la sécurité du personnel du
SCC, des délinquants et du public. Voici quelques-unes des mesures de répression adoptées par le SCC :
fouilles discrètes des visiteurs au moyen de détecteur de métaux, de détecteurs ioniques, de chiens détecteurs
de drogue et fouilles des
cellules, des bâtiments, des terrains et des délinquants. Ces mesures s'imposent en raison
du pourcentage élevé de délinquants sous responsabilité fédérale (80 %)
15
qui
déclarent être toxicomanes à l'admission, du nombre de délinquants affiliés à des organisations
criminelles (1 047)
16
et du nombre
élevé de personnes qui
entrent dans les établissements du SCC et qui en sortent tous les jours.
11
Incidents de sécurité graves dans les établissements, 2004-2005
, Direction de la sécurité, Service correctionnel du Canada.
12
Comprend les délinquants sous responsabilité fédérale et sous
responsabilité provinciale qui ont été incarcérés pendant au moins une journée dans un établissement fédéral au cours de l'exercice.
13
Blessure qui empêche la victime de reprendre une vie normale pendant un certain temps.
14
Blessure qui n'empêche pas la victime de poursuivre une vie normale (écorchures mineures, contusions,
entorses, etc.).
15
Motiuk, L. et al.
Le retour en toute sécurité des délinquants dans la communauté – Aperçu statistique
, rapport de recherche du SCC, SR-4, avril 2003,
http://www.csc-scc.gc.ca/text/faits/facts08_f.shtml
.
16
Système de gestion des délinquants, 10
avril 2005.
Saisies de drogue dans les établissements
|
|
1999/00
|
2000/01
|
2001/02
|
2002/03
|
2003/04
|
2004/05
|
|
Comprimés divers (nombre)
|
1 894
|
2 979
|
3 769
|
4 788
|
3 999
|
4 955
|
|
Cocaïne (grammes)
|
159
|
355
|
180
|
159
|
128
|
272
|
|
Opiacés
(grammes)
|
164
|
245
|
208
|
226
|
92
|
310
|
|
Alcool et alcool artisanal (litres)
|
8 918
|
8 246
|
9 576
|
8 731
|
12 358
|
8 707
|
|
THC (grammes)
|
5 444
|
8 014
|
7 481
|
9 358
|
9 984
|
8 400
|
|
Opiacés (comprimés)
|
509
|
482
|
1 011
|
1 570
|
2 267
|
2 237
|
|
Source : Système de gestion des délinquants du SCC, 10 avril
2005.
|
Isolement
Il existe deux types d'isolement : l'isolement sollicité et l'isolement non sollicité. En 2004 /05 , il y a eu
5 322 admissions ou réadmissions en isolement non sollicité, soit un nombre légèrement inférieur à celui
qui a été enregistré en 2003/04 (5 493). Le nombre d'admissions ou de réadmissions en isolement
sollicité a toutefois augmenté, passant de
1 852 en 2003/04 à 1 899 en 2004/05. Les deux types d'isolement
donnent souvent lieu à la réadmission du même délinquant au cours d'une période de référence
quelconque.
En moyenne, la durée de séjour en isolement non sollicité a été de 34,9 jours en 2004/05,
soit une légère hausse par rapport aux 34,6 jours enregistrés en 2003/04 et aux 29,6 jours enregistrés
en 2002/03. La durée moyenne de séjour en isolement sollicité a été de 66,8 jours, ce qui
représente une légère diminution par rapport aux 66,78 jours enregistrés en 2003/04 et aux 60,6 jours
enregistrés en 2002/03.
Le temps de plus en plus long passé en isolement, sollicité ou non, par les délinquants constitue un sujet
de préoccupation pour le SCC, qui examine des options en vue de
réduire la durée des séjours. Le SCC
se penche aussi sur des problèmes fondamentaux comme l'absence de solutions de rechange à l'isolement sollicité,
les possibilités de réinsertion en toute sécurité des délinquants en isolement non sollicité dans
la population générale et la souplesse du processus de transfèrement pour gérer le déplacement
de ces détenus.
Plaintes
et griefs des délinquants
Le système de règlement des griefs constitue un mécanisme prosocial permettant aux délinquants de résoudre
des différends lorsqu'ils sont en désaccord avec une décision ou une politique du SCC ou, encore, avec son application.
Le SCC a reçu en moyenne 21 000 plaintes et griefs par année à tous les paliers du processus au cours
des cinq dernières
années. En 2004/05, il a reçu presque 19 000 plaintes et griefs, soit une diminution
de 9 % par rapport à l'année précédente et le nombre le plus faible enregistré au cours des
cinq dernières années. Un examen des données relatives aux griefs résolus à chaque palier a révélé que
la majorité d'entre eux, soit environ 80 %, étaient réglés en établissement. Il
s'agit d'un
résultat semblable à ceux qui ont été enregistrés pour les cinq dernières années.
Plaintes à la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP)
Les délinquants qui relèvent de la responsabilité du SCC et qui sont citoyens canadiens ou ont le droit d'être
présents au Canada sont autorisés à déposer une plainte à la Commission
canadienne des droits
de la personne lorsqu'ils estiment avoir fait l'objet de discrimination fondée sur l'un des onze motifs énoncés
dans la
Loi canadienne sur les droits de la personne.
Comme le montre la figure présentée ci-après, les délinquants ont déposé 34 plaintes
devant la CCDP en 2004/05 sur une possibilité de 26 658 délinquants, ce qui équivaut à un
ratio de 1,3 plainte
par 1 000 délinquants. Il s'agit d'une légère augmentation par rapport à l'exercice
2003/04, au cours duquel 31 plaintes avaient été déposées. Les 34 plaintes ont été formulées
par 32 personnes. Celles-ci étaient fondées sur 50 motifs différents
17
,
soit la religion (15), la race, la couleur et l'origine nationale ou ethnique (13),
la déficience (12), les représailles
(4), le sexe (4), la situation de famille (1) et l'âge (1).
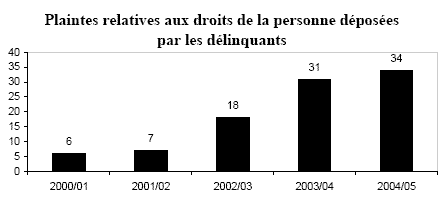
Outre les 34 nouvelles plaintes déposées à la CCDP, 39 plaintes ont été reportées
des exercices précédents, ce
qui porte à 73 le nombre total de plaintes formulées par les délinquants
devant la CCDP que le SCC a eu à traiter en 2004/05. De ce nombre, 60 plaintes ont été rejetées
par la CCDP, qui estimait qu'il n'y avait pas eu violation des droits de la personne. Les 13 autres plaintes demeurent actives.
-
Aux termes de la LSCMLC, le SCC doit
prodiguer à tous les détenus les soins de santé essentiels
et leur offrir un accès raisonnable aux soins de santé non essentiels. En offrant aux détenus des soins de
santé répondant à leurs
besoins, on favorise leur participation à des programmes correctionnels qui contribuent à leur réinsertion
sociale, à la
santé publique et à la sécurité dans la société. Les coûts des soins
de santé constituent
une préoccupation pour tous les Canadiens, mais les coûts des soins de santé pour les détenus sont supérieurs à la
moyenne en raison du taux plus élevé de problèmes de santé mentale, de toxicomanie et autres pratiques
malsaines et de maladies infectieuses comme le VIH et l'hépatite C. Les conditions de sécurité dans
lesquelles les services de santé sont donnés
constituent des facteurs de coûts supplémentaires. Selon
une étude récente
18
, comparativement aux autres membres de la
société canadienne,
les détenus :
-
sont plus de deux fois plus susceptibles de fumer;
-
sont 30 fois plus susceptibles de s'injecter de la drogue;
-
sont de deux à dix fois plus susceptibles d'être atteints d'un trouble d'alcoolisme ou d'abus d'une
substance;
-
sont plus de deux fois plus susceptibles d'être infectés par le virus de l'hépatite B;
-
sont plus de 20 fois plus susceptibles d'être infectés par le virus de l'hépatite C;
-
sont plus de 10 fois plus susceptibles d'être infectés par le VIH;
-
sont plus de deux fois plus susceptibles d'avoir été atteints d'un trouble mental quelconque;
-
sont huit fois plus susceptibles de
se suicider;
-
affichent un taux de risque de mortalité prématurée de 45 % plus élevé;
et
-
sont plus susceptibles de suivre un traitement antidiabétique, un traitement pour une maladie cardiovasculaire
ou un traitement antiasthmatique
19
.
À la suite de la publication du rapport du vérificateur général sur les services pharmaceutiques offerts
aux clients
fédéraux, y compris les détenus, le SCC a communiqué avec cinq autres ministères chargés
d'offrir des services de santé aux clients fédéraux en vue de trouver des moyens de réaliser des économies,
d'adopter des processus communs, par exemple, un outil de vérification, et d'établir des procédures d'examen
sur l'utilisation des médicaments. Un comité interministériel a été
formé pour mettre en œuvre
le plan d'action en 2005/06.
Voici les plans et activités qui ont été mis en place relativement à ces questions de santé et à d'autres
problèmes de santé touchant les délinquants.
Mettre en oeuvre des initiatives qui aident à gérer les problèmes de dépendance et à réduire
les dommages causés par la drogue, à l'appui de la
Stratégie canadienne antidrogue.
En vue d'améliorer continuellement les mesures visant à prévenir et à contrôler les maladies infectieuses,
le SCC travaille en étroite collaboration avec Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada, reçoit
des conseils et des services de soutien pour la surveillance, la prévention et le contrôle des maladies infectieuses
dans les établissements et participe à
la validation du matériel existant concernant la recherche sur l'échange
de seringues en prison. La participation du SCC à l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada
est un exemple de cette collaboration
20
. En 2004/05, la première année de l'initiative,
les fonds additionnels alloués au SCC lui ont permis de mettre en œuvre des activités de promotion de la santé dans
les
centres de réception et d'appuyer l'élaboration de l'initiative sur les pratiques de tatouage sécuritaires,
destinée à être mise à l'essai dans certains établissements au cours de l'exercice 2005/06. Les
objectifs du projet pilote sont les suivants.
-
réduire les comportements à risque associés à la transmission de maladies infectieuses
chez les membres de la population carcérale, les employés
du SCC et l'ensemble de la société ;
-
réduire au minimum le risque de blessures au sein du personnel du Service correctionnel du Canada;
-
sensibiliser les délinquants au risque de transmission de maladies infectieuses associé aux pratiques
de tatouage illicites;
-
promouvoir la santé et le bien-être;
-
mettre en œuvre le projet pilote tout en assurant la sécurité.
Au cours de l'exercice 2004/05,
des séances de formation du personnel ont été offertes dans six établissements.
L'usage de la méthadone est reconnu à l'échelle internationale comme étant une méthode efficace
pour le traitement de la toxicomanie opiacée. Au 31 décembre 2004, 512 détenus participaient
au programme de TEM et 42 faisaient l'objet d'une évaluation en vue d'y participer. Au cours de l'année civile 2004,
1 004 détenus ont été surveillés dans le cadre du programme. La création d'une base
de données sur le TEM en 2004/05 permettra d'obtenir des résultats plus détaillés pour les prochaines
années.
L'instauration d'une base de données informatisée sur le Programme de traitement d'entretien à la méthadone
(PTEM) en 2004/05 permettra au SCC de fournir des données plus détaillées sur
les résultats au cours
des prochaines années. Ce programme coûte plus de six millions de dollars par année dont un million provient
de la Stratégie canadienne antidrogue.
Élaborer un protocole pour évaluer les caractéristiques et les comportements associés aux troubles
du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF), les types d'interventions requises et la formation à donner au personnel.
Le
personnel doit avoir des interactions plus directes, plus intensives et plus fréquentes avec les délinquants atteints
de TSAF en raison des comportements associés à cet état, comme l'impulsivité, la déficience
de la mémoire à court terme et l'incapacité d'établir une distinction entre la cause et l'effet. Comme
les TSAF constituent un handicap permanent, il faut offrir un continuum de soins et des interventions de niveau
élevé pendant
toute la durée de la peine et après l'expiration du mandat.
En 2004/05, le SCC a mis au point un outil pour évaluer les TSAF, qui est actuellement mis à l'essai dans un établissement.
Si cet outil s'avère valide et fiable, il permettra au SCC de déterminer avec plus d'exactitude le nombre de délinquants
atteints de TSAF.
En outre, en 2004/05, une enquête a été réalisée auprès
des membres du personnel; cette
enquête a permis de cerner cinq priorités : sensibilisation du personnel et connaissances à propos des TSAF;
diagnostic; cadre de vie pour les délinquants atteints du TSAF; participation de la collectivité; traitement.
Améliorer les approches de promotion de la santé.
Le SCC s'est engagé à offrir un environnement sûr et sain pour le personnel, les
délinquants et
le grand public. Pour ce faire, le Service cherche des moyens d'augmenter sa capacité de faire la promotion de la santé auprès
des détenus afin de les inciter à adopter des modes de vie sains.
En 2004/05, le SCC a réalisé de modestes gains en ce qui concerne le Programme de counseling et d'éducation
par les pairs et le Programme d'éducation et d'entraide par les pairs autochtones, intitulé Cercles des gardiens du
savoir. Ces efforts se poursuivront en 2005/06.
Le Programme de sensibilisation à la réception (PSR) du SCC a aussi été renforcé grâce à des
ressources additionnelles fournies aux centres de réception. Ce programme permet de fournir aux détenus nouvellement
admis des renseignements sur les risques pour la santé, les choix sains et les services de santé offerts dans les établissements
du SCC. En outre, les
détenus sont invités à passer des tests, s'il y a lieu, et ils sont informés sur
les mesures à prendre pour se protéger et protéger les autres contre les maladies.
Les trois outils principaux de promotion de la santé maintenant utilisés par le SCC, soit le Programme de sensibilisation à la
réception, le programme de counseling et d'éducation par les pairs et le programme Choisir la santé dans les
prisons, ont
été révisés et mis à jour en 2004/05.
De plus, le SCC, avec les conseils techniques de l'Agence de santé publique du Canada, offre un Programme de prévention
et de contrôle de la tuberculose qui incite les délinquants à passer un test de dépistage de la tuberculose
et à faire un suivi annuel. Des vaccins contre l'hépatite A et B sont offerts régulièrement.
Fournir des services de soutien
pour les délinquants atteints de maladies chroniques et ceux qui ont besoin de
soins palliatifs.
Le SCC veille à répondre aux besoins médicaux des délinquants atteints de maladies chroniques en :
-
procédant à une évaluation individuelle des besoins;
-
appliquant les lignes directrices sur les soins palliatifs du SCC;
-
adoptant un outil d'évaluation à la réception pour tous
les délinquants de plus de 50 ans
afin de mieux évaluer l'état de santé de ce groupe de patients.
Dans le cadre de son mandat, l'Aumônerie offre aussi du soutien aux délinquants qui ont besoin de soins palliatifs
en établissement et dans la collectivité et des services de pastorale aux délinquants hospitalisés.
Amener les collectivités à participer activement à la poursuite des
soins pour les délinquants qui font
la transition entre l'établissement et la collectivité.
Des liens ont été établis avec les organismes de la santé publique et de la collectivité de façon à pouvoir
offrir aux délinquants des services de soutien après leur libération. Des dispositions pour le traitement de
suivi sont prises avant la libération dans le cas des délinquants
traités pour des maladies infectieuses, des
maladies chroniques, des soins palliatifs, des problèmes de toxicomanie et des troubles de santé mentale.
Au cours de l'exercice 2004/05, des travaux ont été entrepris pour élaborer des lignes directrices sur la planification
de la mise en liberté de manière à ce que les professionnels de la santé travaillent en collaboration
avec les établissements et les bureaux de libération
conditionnelle.
Élaborer et mettre en œuvre un meilleur cadre d'assurance de la qualité pour les services de santé offerts
dans les établissements du SCC.
Le SCC est déterminé à mettre en œuvre un processus d'amélioration de la qualité afin de
répondre aux exigences du Conseil canadien d'agrément des services de santé pour toutes ses unités de
soins de santé et ses
infirmeries. Quelques examens des établissements ont été effectués, et le
SCC prévoit que tous les établissements auront été examinés d'ici la fin de 2006.
Offrir des traitements plus ciblés pour résoudre les problèmes de santé mentale.
En 2004/05, le SCC a adopté une stratégie de santé mentale à l'intention des délinquants; cette
stratégie comporte quatre éléments : effectuer une évaluation clinique complète de la santé mentale
de tous les délinquants à leur admission; s'assurer que tous les centres de traitement satisfont à des exigences
nationales uniformes; donner des soins intermédiaires, dans les établissements ordinaires, aux détenus souffrant
de troubles mentaux; établir une stratégie de santé mentale communautaire.
Les
résultats obtenus à ce jour comprennent l'adoption de critères d'admission dans les unités psychiatriques
de tous les centres de traitement, la prestation de programmes pour les délinquants sexuels et les délinquants violents
non atteints de troubles mentaux à l'extérieur des centres de traitement et l'élaboration de plans d'action
pour le recours à la force avec les délinquants souffrant de troubles mentaux.
Le
gouvernement du Canada a alloué 29,5 millions de dollars sur cinq ans pour financer le volet de la stratégie
relatif à la santé mentale dans la collectivité. Les fonds serviront à la planification de la mise en
liberté, aux soins ambulatoires, à l'emploi de personnel médical spécialisé en santé mentale
dans les bureaux de libération conditionnelle ainsi qu'à l'organisation de séances de formation annuelles
sur
la santé mentale à l'intention du personnel de la collectivité.
Indicateurs de rendement clés et autres indicateurs
Évaluations de la santé à l'admission
Dans les 48 heures qui suivent leur admission dans un établissement du SCC, on fait subir à tous les
délinquants une évaluation médicale afin d'évaluer leur état de
santé et de leur prescrire
un traitement au besoin.
Prestation de services de santé
Au cours du dernier exercice, tous les établissements ont effectué trois autovérifications
21
dans
les domaines suivants : consentement aux services de santé, services de santé et prévention du suicide.
Ces examens ont donné lieu à un changement dans la politique à
propos de la prévention du suicide. La DC 843,
Prévention,
gestion et intervention en matière de suicide et d'automutilation
, a été modifiée afin de donner
des éclaircissements sur le genre de formation qui doit être offerte aux agents de correction et aux autres membres
du personnel qui ont des contacts directs avec les délinquants ainsi que sur la fréquence de cette formation.
Accès aux
soins de santé essentiels
En 2004/05, le SCC a accordé aux délinquants plus de 16 000 permissions de sortir avec ou sans
escorte pour des raisons médicales. L'objectif de ces permissions de sortir était de répondre aux besoins de
santé essentiels des délinquants.
Réduire le taux de transmission des maladies infectieuses.
Le contrôle et la gestion efficaces des
maladies infectieuses dans les établissements correctionnels sont des éléments
essentiels à la protection de la santé des détenus, des employés et, en bout de ligne, du public. Le
tableau suivant montre les taux de prévalence estimés à la fin de l'exercice.
17
Le nombre de motifs est supérieur au nombre de plaintes déposées
parce que certaines plaintes sont
fondées sur plusieurs motifs.
18
« Évaluation des besoins en soins de santé des détenus sous responsabilité fédérale »,
Revue canadienne de santé publique
, avril 2004.
19
Le point sur les maladies infectieuses
, Service correctionnel du Canada, hiver 2004,
www.csc-scc.gc.ca/text/pblct/hsbulletin/2003/no2/index_f.shtml
.
20
De plus amples renseignements sur l'Initiative fédérale de lutte
contre le VIH/sida au Canada sont fournis à l'adresse suivante :
http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/vih_sida/index.html
.
21
Le SCC a
adopté des outils de surveillance de la gestion (OSG) pour permettre aux établissements de procéder à des autoévaluations visant à assurer la conformité avec
la loi et la politique.
Prévalence des maladies infectieuses
22
|
Maladies infectieuses
|
Décembre 2001
|
Décembre 2002
|
Décembre 2003
|
Décembre 2004
|
|
VIH/sida
|
223 (1,8 %)
|
251 (2,04 %)
|
227 (1,86 %)
|
182 (1,47 %)
|
|
Hépatite B
|
43 (0,3 %)
|
30 (0,24 %)
|
17 (0,14 %)
|
16 (0,13 %)
|
|
Hépatite C
|
2 993 (23,6 %)
|
3 173 (25,81 %)
|
3 111 (25,54 %)
|
3 303 (26,65 %)
|
|
Infections transmises sexuellement (ITS)
|
|
Chlamydia
|
23 (0,18 %)
|
53 (0,43 %)
|
58 (0,48 %)
|
53 (0,43 %)
|
|
Gonorrhée
|
13 (0,10 %)
|
20 (0,16 %)
|
7 (0,06 %)
|
11 (0,09 %)
|
|
Syphilis
|
0 (0 %)
|
3 (0,02 %)
|
4 (0,03 %)
|
10 (0,08 %)
|
|
Autre ITS
|
35 (0,27 %)
|
53 (0,43 %)
|
85 (0,70 %)
|
91 (0,73 %)
|
|
Tuberculose latente
|
2 658 (21,1 %)
|
2 219 (18,8 %)
|
Non disponible
|
Non disponible
|
Décès de détenus, selon la cause
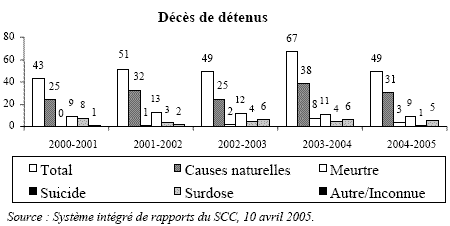
On procède à une enquête sur tous les décès de détenus afin d'établir les facteurs
qui ont contribué aux
décès autres que ceux de cause naturelle et empêcher les décès évitables
en informant, surveillant et soutenant davantage les délinquants. Même si on a enregistré une légère
diminution du nombre de suicides de détenus (9 comparativement à la moyenne quinquennale de 11), il convient de noter
que le suicide est presque quatre fois plus fréquent chez les délinquants de sexe masculin que chez les hommes du même
âge
dans la société canadienne. Tous les détenus qui se sont suicidés étaient des hommes, dont quatre
Autochtones .
Le SCC administre les peines en assurant la garde raisonnable, sûre et humaine des délinquants. Cela comprend
la prestation de services en établissement, comme les repas, les vêtements et
les fournitures, ainsi que des logements
sûrs, sécuritaires et humains.
Les plans et les activités relatifs associés aux services en établissement et aux services de logement sont
présentés ci-après.
Mettre en oeuvre la stratégie de développement durable du SCC (révision 2003).
La Stratégie de développement durable (SDD) du SCC vise à
protéger la santé et la sécurité des
délinquants, du personnel et du public et à atténuer dans la mesure du possible les incidences environnementales
des programmes et des activités du SCC, conformément à la politique de l'administration fédérale.
Le Service correctionnel du Canada a présenté la Révision 2003 de sa Stratégie de développement
durable (SDD) en février 2004.
Les progrès accomplis par rapport aux engagements pris dans le cadre de la stratégie
sont décrits dans le tableau 18. Une vérification interne a été effectuée en 2004 et les
résultats devraient être connus à l'automne 2005
23
.
Le SCC mettra en œuvre intégralement le cadre de responsabilisation en matière d'environnement en 2005/06 et
il produira un
rapport d'étape en octobre 2006.
Réviser le plan actuel d'immobilisations et de logement pour mieux répondre aux besoins de la population de délinquants
en évolution.
Le SCC doit composer avec une infrastructure vieillissante, qui nécessite des investissements importants de plus en plus
fréquents pour l'entretien et la et la conformité avec les changements apportés aux codes du bâtiment
et de
sécurité. Des améliorations relatives à la gestion des délinquants peuvent aussi entraîner
des coûts liés à l'infrastructure en vue d'adapter les anciens établissements pour faciliter la mise en œuvre
de stratégies d'intervention et de sécurité plus novatrices. En 2004/05, le SCC a pris les mesures suivantes
pour répondre aux nouveaux besoins relatifs aux établissements:
-
On a
procédé à un examen dans chacun des établissements à sécurité maximale
afin de déterminer les améliorations à apporter aux infrastructures à court et à moyen terme.
On a apporté divers changements en vue d'améliorer l'observation : aménagement, installation de caméras
dans les rangées de tous les établissements à sécurité maximale, changements relatifs à la
gestion par
unité. De plus, on a fait des modifications relatives à la conception afin d'améliorer la surveillance
dans les aires de loisirs extérieures et dans l' aire des visites et de la correspondance. Ce programme restera en vigueur
pendant les deux prochains exercices.
-
Une nouvelle norme pour les unités résidentielles à sécurité maximale a été développée,
plus sûre, plus sécuritaire et mieux
adaptée; cette unité permet d'intégrer diverses fonctions
comme le logement des détenus, la gestion des cas, la sécurité, les programmes, certains services aux détenus
ainsi que la dotation. La planification et la conception, basé sur cette nouvelle norme, de deux nouvelles unités
résidentielles à sécurité maximale au Pénitencier de la Saskatchewan et à l'Établissement
de Kent a débuté en
2004/05.
-
Les travaux de réaménagement de certains établissements à sécurité maximale
ont été mis de l'avant dans le Plan d'investissement à long terme (PILT). Les activités de planification
relatives au réaménagement des Établissements de Kent et de Millhaven devraient commencer en 2005/06.
Augmenter le nombre de mesures de logement destinées aux délinquants et aux
délinquantes après la mise
en liberté.
Comme nous l'avons souligné dans la section portant sur la sous-activité Services de santé, des améliorations
aux services de soins de santé mentale offerts aux délinquants qui résident dans les CCC et les ERC
seront apportées durant l'exercice 2005/06 dans le cadre du volet de la stratégie portant sur la santé mentale
dans la collectivité.
Par
ailleurs, le SCC a terminé la première étape d'une étude en trois volets visant à établir
le profil des résidents des ERC de 1997 à 2003. Cette étude vise à établir une comparaison
entre ces derniers et les résidents des CCC et de la collectivité.
Élaborer et mettre en oeuvre des méthodes de rechange à la prestation de services.
Un examen des procédures
techniques et des pratiques de gestion des installations a été entrepris et les changements à apporter
seront terminés à la fin de 2006/07. Le tableau 20 dans la section 3, Information Supplémentaire, comporte
des renseignements détaillés sur la diversification des modes de prestation de services.
Au besoin, examiner les accords d'échange de services actuels avec les provinces et les territoires.
Les accords
d'échange de services (AES) contribuent à la sécurité publique grâce à l'établissement
de liens de collaboration officiels entre les administrations fédérale, provinciales et territoriales. Ces accords
régissent le transfèrement, la détention temporaire et le transport des délinquants. Des renseignements
détaillés sur les nouveaux AES et sur les AES renouvelés en 2004/05 sont présentés au
tableau 20,
dans la section 3, Information Supplémentaire.
Le SCC a aussi conclu des accords sur la communication de renseignements avec toutes les administrations du pays, conformément à l'article 23
de la LSCMLC et de l'article 743.2 du
Code criminel
, qui régit la communication de renseignements sur les peines
des délinquants. L'accord le plus récent a été conclu avec les Territoires-du-Nord-Ouest en mars 2005.
Indicateurs de rendement clés et autres indicateurs
Offrir un milieu de travail et de vie propre selon les normes reconnues
Les outils d'utilisation des gestionnaires n'ont pas permis de déterminer des problèmes de non-conformité ou
des domaines nécessitant des améliorations.
Offrir des repas nutritifs et équilibrés
Le taux quotidien du SCC pour nourrir
les délinquants était d'environ 4,50 $ au cours du dernier exercice.
On a effectué un examen national des politiques et pratiques relatives à la gestion des services alimentaires et on
a élaboré un plan d'action assorti de recommandations qui seront mis en œuvre au cours de l'exercice 2005/06. Voici
quelques-unes des recommandations : élaboration d'un programme de gestion normalisé visant à assurer l'uniformité dans
la
prestation des services de nutrition offerts aux délinquants; préparation d'un menu régional réparti
selon un cycle de quatre semaines (santé du cœur) pour combler les besoins nutritifs des délinquants et promouvoir
une meilleure alimentation dans les établissements; conception d'un plan quinquennal pour le remplacement de l'infrastructure
des services alimentaires.
Vêtements et achat d'effets personnels
Le SCC a
établi des politiques qui régissent la distribution de vêtements aux détenus et l'achat d'effets
personnels. Aucun cas de non-conformité aux politiques n'a été signalé au cours de l'exercice 2004/05.
Le logement répond à toutes les exigences de la loi et de la politique.
La cellule individuelle est la forme de logement des délinquants la plus souhaitable et la plus appropriée dans
les établissements.
Il arrive parfois que deux délinquants doivent partager une cellule conçue pour une seule personne (double occupation) à cause
de contraintes liées à la gestion des délinquants.
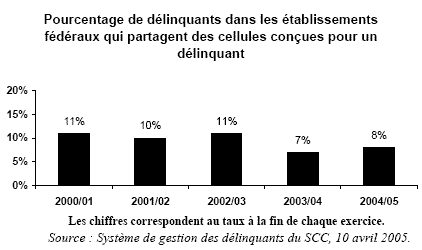
|
