Archivé
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquez avec nous.
Évaluation des initiatives internationales d’allégement de la dette au Canada
Vérification interne et Évaluation
Ministère
des Finances
Canada
Approuvé par le Comité de la verification et de l’evaluation
25 mars 2010
Table des matières
3.1 Participation
du Canada à l’allégement de la dette internationale
3.2
Structure et partenaires de l’allégement de la dette
3.3 Structure de
financement et montant
4. Approche et méthode d’évaluation
4.1 Études
de vérification et d’évaluation existantes du FMI et
de la Banque mondiale
4.2 Recension
des ouvrages de tierces parties
4.3 Entrevues
auprès d’informateurs clés
4.4 Recension
des dossiers et des documents internes
5. Questions de l’évaluation et enjeux
7.1 Pertinence
7.2 Conformité aux
priorités du gouvernement
7.3 Rendement :
Réalisation des résultats escomptés
7.4
Rendement :
Conception et exécution du programme
7.5 Rendement :
Efficience et économie du programme
Annexe A : Contexte de l’allégement de la dette
Annexe B : Description des rôles et responsabilités des partenaires de l’allégement de la dette
Annexe C : Définitions de termes et expressions communs
Annex E : Évaluation des initiatives canadiennes d’allégement de la dette internationale
Sommaire
Le présent rapport expose les résultats de l’Évaluation des initiatives internationales d’allégement de la dette au Canada. L’établissement de traitements de la dette internationale dans les années 1950 s’est inscrit dans le cadre d’un effort international coordonné pour fournir des méthodes de remboursement aux pays à revenu faible et moyen très endettés. Le Canada participe activement à cet effort depuis son lancement. La présente évaluation porte sur les initiatives lancées depuis 1996, année à laquelle elles ont été modifiées afin de cibler les pays pauvres très endettés (PPTE) et à laquelle a été amorcé le processus d’allégement de la dette, c’estàdire la radiation systématique de l’encours de la dette, des PPTE admissibles à l’allégement. Le nouveau programme cherchait à alléger le fardeau de la dette des PPTE et à leur permettre d’instaurer des programmes ciblant la croissance, la réduction de la pauvreté et d’autres mesures sociales. Le ministère des Finances représente le Canada auprès des institutions chargées d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques et initiatives relatives à l’allégement de la dette, notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le Club de Paris et d’autres institutions financières régionales.
La présente évaluation avait pour objectif de déterminer si la participation du Canada aux initiatives d’allégement de la dette (tant bilatérale que multilatérale) continuait d’être justifiée et de savoir quel était le rendement du Canada notamment au chapitre de l’efficience et de l’efficacité, de la conception et de la mise en œuvre, de l’harmonisation avec les priorités du gouvernement fédéral et de la concordance avec les rôles et responsabilités de ce dernier. Le fondement législatif de l’évaluation est l’article 42.1 de la Loi fédérale sur la responsabilité adoptée en 2006, qui prévoit un examen quinquennal de la pertinence et de l’efficacité de l’ensemble des programmes de subventions et de contributions. De plus, la valeur annuelle en dollars appréciable des paiements de transfert, évaluée à 199 millions de dollars en 20092010, et l’absence de vérifications antérieures du programme par le ministère des Finances rendent cette évaluation très prioritaire dans le Plan d’évaluation du ministère des Finances.
Quatre éléments de preuve ont été utilisés : des entrevues auprès d’informateurs clés, un examen des études d’évaluation et de surveillance du FMI et de la Banque mondiale, une recension des documents de tierces parties, dont ceux d’universités et d’organismes non gouvernementaux, ainsi qu’un examen de documents et rapports internes. Les sections qui suivent présentent les principales constatations et conclusions de l’évaluation.
Pertinence
Il est ressorti de l’évaluation que le mandat et les objectifs stratégiques de la participation du Canada aux initiatives d’allégement de la dette continuaient d’être pertinents. La théorie qui sous‑tend la fourniture d’un allégement de la dette aux pays pauvres est la théorie dite du « surendettement » en vertu de laquelle l’encours de la dette d’un pays dépasse sa capacité de rembourser les emprunts à l’avenir. L’allégement de la dette devrait, en théorie, libérer des ressources et créer une marge de manœuvre financière que les pays bénéficiaires peuvent appliquer à des fins de développement. Les éléments de preuve obtenus de toutes les sources montrent que le mandat et les objectifs stratégiques de la participation du Canada demeurent pertinents. Quatorze pays n’ont pas encore franchi toutes les étapes de l’Initiative en faveur des PPTE aboutissant à l’annulation intégrale de leur dette. De plus, compte tenu de la situation financière mondiale actuelle, plus de pays commencent à éprouver des difficultés financières et ont besoin d’annulation de la dette.
L’évaluation a également permis de constater que les objectifs et le mandat des initiatives d’allégement de la dette cadrent bien avec les priorités fédérales et sont conformes aux rôles et responsabilités du gouvernement fédéral à l’échelle internationale.
Le gouvernement fédéral a convenu d’indemniser intégralement la Commission canadienne du blé (CCB) et Exportation et développement Canada (EDC) des pertes subies (l’intérêt et le capital) par suite de la participation du Canada aux efforts d’allégement de la dette. L’évaluation s’est penchée sur le bien‑fondé de la poursuite d’un tel mécanisme et recommande que sa pertinence soit de nouveau examinée en fonction de l’évolution des circonstances, par exemple, la réduction du nombre de pays nécessitant un allégement intégral de la dette. En raison de cette baisse, les initiatives ciblent maintenant les politiques et programmes centrés sur la gestion de la dette et la viabilité de l’endettement dans ces pays.
Rendement
Les initiatives d’allégement de la dette sont menées de pair avec de nombreuses autres initiatives internationales, de sorte qu’il est impossible d’isoler l’incidence de l’allégement de la dette en soi. Le nombre de facteurs macroéconomiques et les différences inhérentes des pays visés font qu’il n’est pas possible d’attribuer directement les effets. De plus, l’efficacité de ces initiatives est largement tributaire de la participation de créanciers internationaux et s’imbrique dans la capacité du FMI et de la Banque mondiale de mobiliser les pays créanciers pour qu’ils instaurent des politiques en matière d’allégement de la dette et autres politiques à l’appui de ces pays en développement.
L’objectif premier de la réduction de l’encours de la dette des PPTE est en voie d’être atteint, comme le laissent supposer les éléments de preuve. Des 41 pays admissibles, 26 ont obtenu un allégement intégral de la dette et ont vu leur encours chuter dramatiquement. Certains de ces pays, surtout ceux dotés de systèmes politiques plus stables, ont également accru les sommes qu’ils consacrent aux politiques et programmes de réduction de la pauvreté. Toutefois, la mesure dans laquelle l’accroissement des dépenses a contribué à réduire la pauvreté et à améliorer les résultats sociaux n’est pas bien comprise. L’évaluation a trouvé des éléments d’une croissance économique supérieure dans les pays ayant dépassé le point d’achèvement que dans les autres PPTE.
Le programme d’allégement de la dette a connu de nombreux effets imprévus, notamment l’émergence de fonds de vautours, l’accès restreint aux prêts à des conditions favorables pour les pays autres que des PPTE et les créanciers éventuels nonmembres du Club de Paris qui sont prêts à consentir des prêts éventuellement insoutenables aux PPTE et, ainsi, recréer le problème initial.
On a constaté que l’administration du programme et le recours au système de paiements de transfert dans le cadre de l’allégement de la dette internationale étaient efficients, comportaient peu de double emploi et donnaient lieu à des coûts relativement faibles. On a signalé que le Canada ne connaîtra vraisemblablement pas de perte financière par suite de l’annulation de la dette étant donné que nombre des PPTE n’étaient pas en mesure de payer les frais du service de la dette. La mise en œuvre de la plupart des initiatives a été jugée conforme à la conception initiale, et les rajustements qui y ont été apportés cherchaient à faciliter l’admissibilité des pays au programme et l’obtention d’un allégement de leur dette.
Les documents d’évaluation du FMI, de même que les entrevues, ont fait état de préoccupations concernant les conditions imposées dans les étapes de l’Initiative en faveur des PPTE. On a également signalé que le changement de cap de l’initiative d’allégement de la dette en faveur de la gestion de la dette et de la viabilité de l’endettement pouvait donner lieu à un chevauchement entre l’ACDI et le ministère des Finances du Canada. L’évaluation a également fait ressortir la nécessité d’améliorer la qualité de l’information diffusée dans le public concernant les initiatives d’allégement de la dette, car elle est fragmentée et désuète.
Le ministère des Finances classe les initiatives d’allégement de la dette dans la catégorie des subventions et des contributions. Puisque les paiements au titre de l’allégement de la dette fluctuent d’année en année sous l’effet des difficultés imprévues que les pays bénéficiaires peuvent connaître quant au respect des conditions du programme, on a jugé que la structure de financement actuelle était par trop rigide et compliquait les efforts de rajustement des montants des paiements au besoin.
Dans l’ensemble, on a estimé que le fonctionnement des initiatives est bon et qu’aucun changement d’envergure ne semble nécessaire pour l’instant en ce qui concerne la conception ou l’exécution du programme. L’évaluation recommande cependant les mesures suivantes qui pourraient accroître l’efficience et l’efficacité de la participation du Canada aux initiatives d’allégement de la dette.
Recommandations de l’évaluation :
Recommandation 1 : Le ministère des Finances devrait songer à discuter de cet arrangement avec EDC afin de revoir la nécessité d’indemniser cette société d’État des pertes subies en raison des mesures d’allégement de la dette.
Recommandation 2 : Le ministère des Finances devrait faire valoir l’importance d’intégrer les plans économiques et de développement en vigueur des gouvernements débiteurs aux conditions économiques et financières que les ententes de l’initiative des PPTE exigent.
Recommandation 3 :Le ministère des Finances devrait améliorer l’information fournie sur les initiatives d’allégement de la dette, de sorte que l’information présentée aux Canadiennes et aux Canadiens soit d’actualité et décrive clairement le rôle du Canada, ses contributions à l’allégement de la dette bilatérale et multilatérale ainsi que le rendement des initiatives d’allégement de la dette.
Recommandation 4 : Le ministère des Finances devrait veiller à instaurer un mécanisme de réexamen périodique du processus de l’Initiative en faveur des PPTE prévoyant l’établissement des conditions et l’examen périodique de ces dernières de sorte qu’elles soient réalisables et essentielles à la croissance et au développement du pays bénéficiaire.
Recommandation 5 : Le ministère des Finances devrait examiner la structure de financement de l’allégement de la dette multilatérale afin de trouver le mécanisme de financement le mieux adapté et le plus efficient qui fournirait aux gestionnaires de programmes la marge de manœuvre voulue pour donner suite en temps opportun à l’évolution des besoins, qui est principalement le fait de facteurs extérieurs.
1. Introduction
Le présent rapport contient les constatations de l’évaluation de la participation du Canada aux initiatives d’allégement de la dette. L’évaluation a été menée conformément à la Politique sur l’évaluation de 2009 du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), qui exige que tous les programmes de subventions et de contributions, dont le présent programme, soient évalués au cinq ans.
Le Canada participe activement aux traitements de dette internationale amorcés dans les années 1950 dans le dessein de régler les difficultés financières que les pays débiteurs à faible et à moyen revenu éprouvaient. Avec le temps, les difficultés que nombre des pays débiteurs continuaient de connaître ont fait ressortir la nécessité d’appliquer un traitement de dette plus impliqué. Pendant les années 1990, des initiatives d’allégement de la dette ont été lancées dans le cadre d’un effort international pour aider les pays du monde à ramener leur endettement à un niveau plus viable. La présente évaluation a notamment comporté un examen des initiatives appliquées depuis 1996, année à laquelle les initiatives ont été modifiées afin de cibler les pays pauvres très endettés (PPTE) et à laquelle l’annulation systématique de parties importantes de l’encours de la dette y a été intégrée. Le ministère des Finances représente le Canada auprès de diverses institutions et tribunes à qui il incombe d’élaborer des politiques liées à l’allégement de la dette et de les mettre en œuvre (il s’agit notamment de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et du Club de Paris).
Le présent rapport d’évaluation est structuré comme suit : la section 2 décrit le contexte et le fondement législatif de la tenue de l’évaluation, la section 3 fournit l’historique du programme, les sections 4, 5 et 6 définissent l’approche et la méthodologie d’évaluation, présentent les questions et enjeux de l’évaluation et indiquent les limites de celleci, la section 7 traite des constatations de l’évaluation et la section 8 résume les conclusions et les recommandations.
Les annexes A et B contiennent un examen approfondi de l’historique et du contexte de l’allégement de la dette qui pourrait se révéler utile pour les lecteurs qui ne connaissent pas le programme. De plus, l’annexe C donne la définition de termes utilisés dans le présent document.
2. Contexte de l’évaluation
Objectif de l’évaluation : La présente évaluation visait à évaluer la pertinence, le rendement (incluant l’efficacité et l’efficience au plan du coût) et la mise en œuvre de la participation du Canada aux initiatives d’allégement de la dette. Elle a donc porté :
- sur la question de savoir si le programme d’allégement de la dette continuait d’être nécessaire, si des paiements de transfert devaient continuer d’être versés aux organismes canadiens et aux institutions financières internationales et si ces paiements étaient conformes aux priorités ministérielles et gouvernementales;
- sur la mesure dans laquelle les activités ministérielles réussissent à atteindre les objectifs et si des rajustements de la conception ou de la mise en œuvre s’imposent;
- sur la question de savoir si les objectifs de programme fixés étaient atteints;
- sur la mesure dans laquelle les initiatives d’allégement de la dette sont administrées de manière efficiente et économique et sur ce qui pourrait être fait pour accroître l’efficience et l’efficacité du programme.
L’information recueillie dans le cadre de l’évaluation devrait contribuer au processus décisionnel (afin d’aider les gestionnaires de programme et d’autres décideurs à améliorer au besoin la conception et l’exécution du programme) ainsi qu’au respect des exigences en matière de reddition de comptes.
Le Canada participe à nombre d’initiatives distinctes en matière d’allégement de la dette, qui sont néanmoins liées les unes aux autres. L’information disponible sur ces initiatives internationales est souvent fragmentée, de sorte que le rôle du Canada dans le processus n’est pas bien énoncé. Nous avons l’intention de combler cet écart et de présenter un document autonome qui fournit des renseignements sur l’historique et le rendement des initiatives internationales d’allégement de la dette et sur la contribution du Canada. Le présent rapport d’évaluation aidera à accroître la transparence du programme.
Portée et échéancier de l’évaluation : La présente évaluation porte uniquement sur la participation du Canada aux initiatives d’allégement de la dette multilatérale et bilatérale1 pour la période comprise entre 1996 et aujourd’hui.
Justification et fondement législatif : Le paiement de transfert au titre des initiatives internationales d’allégement de la dette est classé à titre de programme de subventions et de contributions. L’article 42.1 de la Loi fédérale sur la responsabilité adoptée en 2006 prévoit un examen quinquennal de la pertinence et de l’efficacité de l’ensemble des programmes de subventions et de contributions2. De plus, la valeur en dollars appréciable des paiements de transfert (199 millions de dollars en 20092010) et l’absence de vérifications antérieures du programme par le ministère des Finances rendent cette évaluation très prioritaire dans le Plan d’évaluation du ministère des Finances. C’est pourquoi, lors de sa réunion du 25 septembre 2007, le Comité ministériel de la vérification et de l’évaluation a autorisé le secteur de la Vérification interne et de l’évaluation (VIE) à mener cette évaluation; il a confirmé sa décision lors de sa réunion du 16 octobre 2008.
3. Historique
La définition que les ouvrages sur le sujet donnent à l’expression « allégement de la dette » est vaste. Elle désigne l’annulation partielle ou totale de la dette, ce qui comprend le rééchelonnement de la dette, le ralentissement ou l’arrêt de l’accumulation de la dette due par les pays en développement envers les pays développés riches. Il importe cependant de signaler qu’avant les initiatives de 1996, les initiatives liées à la dette portaient principalement sur le rééchelonnement de la dette ou la modification des modalités de la dette, par exemple, la réduction des taux d’intérêt ou la prolongation de la période de remboursement afin de maximiser les rendements des pays créanciers. Depuis 1996, les initiatives procurent surtout une annulation partielle ou totale de l’intérêt et du capital. La controverse entourant l’allégement de la dette dont il est question dans les différents ouvrages sur le sujet portait sur les mécanismes de rééchelonnement de la dette antérieurs à 1996 qui étaient offerts à répétition à ces pays endettés. Le rééchelonnement de la dette est souvent qualifié de mécanisme « traditionnel d’allégement de la dette » dans les documents de la Banque mondiale. Par souci de précision, dans le présent rapport, l’allégement de la dette désigne l’annulation partielle ou complète de la dette.
Pour comprendre l’origine récente des initiatives d’allégement de la dette, il faut examiner le contexte politique, historique et international, qui a exacerbé la dette contractée par les pays en développement, de même que les efforts internationaux qui ont été déployés pour y donner suite. L’annexe A contient des renseignements détaillés, mais un résumé est présenté ci‑après pour fournir le contexte général.
La crise de l’endettement dans les pays en développement provient à la fois du côté de la demande (pays débiteurs) et du côté de l’offre (pays créanciers). Dans un premier temps, les pays en développement ont contracté la dette à une époque où les conditions étaient généralement favorables, c’est‑à‑dire, une époque caractérisée par une croissance économique forte, de faibles taux d’intérêt et la dévaluation du dollar américain. Les économistes réputés de l’époque encourageaient la pratique d’emprunter de vastes sommes auprès de pays créanciers (pour soutenir l’industrialisation par substitution aux importations), sommes qui étaient investies dans l’industrie et l’infrastructure. Par la suite, cependant, une série d’événements ont changé dramatiquement la relation unissant les pays débiteurs et les pays créanciers.
L’accroissement de la masse monétaire en Occident au cours des années 1970 (pour compenser la progression du taux de chômage) et le choc imprévu du prix du pétrole ont fait augmenter les coûts de production et entraîné une spirale inflationniste. Les pays riches en pétrole ont déposé leur richesse nouvellement acquise auprès des banques occidentales, entraînant un surplus de liquidité dans ces dernières. Par conséquent, les taux d’intérêt internationaux sont demeurés faibles, et les banques ont consenti des prêts à faible prime de risque et à forte concentration dans certains pays. De vastes sommes d’argent ont donc été prêtées à des pays qui ne seraient normalement pas en mesure de les rembourser. Les pays en développement ont également tiré parti des faibles taux d’intérêt et contracté passablement d’emprunts.
Avec le temps, toutefois, pour contrôler la progression de l’inflation intérieure, les gouvernements des banques créancières ont instauré des politiques restrictives. Les conditions des prêteurs avaient donc changé, les taux d’intérêt étant passablement supérieurs, la valeur du dollar américain s’étant appréciée et la croissance ayant ralenti. En raison de l’intérêt composé, le service de la dette de certains des pays pauvres a progressé rapidement, atteignant le double ou plus de la valeur initiale du prêt et, dans le cas de certains de ces pays, dépassant la valeur de la totalité de leurs exportations (leur revenu en devise), ce qui a considérablement nui à leur capacité de rembourser l’intérêt voire qui leur a empêché de le faire. La baisse du revenu en devise attribuable à la réduction des termes de l’échange et à la conjoncture de récession en Occident ont aggravé le problème. La valeur nominale de ces dettes a donc grimpé, de sorte que nombre de pays en développement ont dû consacrer des sommes supérieures pour payer l’intérêt qu’ils n’en ont consacrées aux investissements profitant à leur propre pays et susceptibles d’y enrayer la pauvreté.
La crise de la dette au Mexique en 1982 a été un signe avant‑coureur de l’impossibilité pour nombre de pays en développement de rembourser la totalité de leur endettement. On reconnaissait également que la réussite des éventuels traitements de dette reposait sur un effort de collaboration internationale. C’est ainsi que, grâce aux institutions internationales comme le Club de Paris, le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et le Fonds africain de développement (FAfD), divers traitements de dette ont été établis, y compris les initiatives d’allégement de la dette en faveur des PPTE, dans le dessein d’alléger le fardeau du remboursement de la dette des pays débiteurs et de les rendre mieux en mesure de favoriser la croissance.
3.1 Participation du Canada à l’allégement de la dette internationale
La participation du Canada aux diverses initiatives d’allégement de la dette remonte à 1956, lorsque le Club de Paris, un groupe informel de créanciers officiels, a été mis sur pied pour trouver des solutions coordonnées et viables aux problèmes de remboursement qu’éprouvaient les pays débiteurs. Depuis, le Canada participe activement aux discussions concernant les traitements de dette et les politiques de viabilité de l’endettement qui ont lieu dans divers organismes et institutions internationaux, dont le Club de Paris, le Commonwealth britannique des nations, les sommets du G7 et du G8, le FMI et la Banque mondiale. Pour atteindre ses objectifs, le Canada participe aux initiatives interreliées suivantes :
- les traitements de dette bilatérale par l’entremise du Club de Paris;
- l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (IPPTE);
- l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM),
- l’Initiative canadienne d’allégement de la dette (ICAD).
Traitements de la dette bilatérale par l’entremise du Club de Paris : Le Canada est l’un des membres originaux du Club de Paris (qui compte 19 membres permanents, dont le Canada). Depuis sa création en 1956, les pays créanciers membres du Club de Paris ont conclu plus de 380 reconnaissances de dette avec près de 80 pays débiteurs. Au cours des deux dernières décennies, ces reconnaissances ont dépassé les 425 milliards de dollars américains.
Par l’entremise du Club de Paris, le Canada a allégé la dette de pays qui croulaient sous un endettement intenable3 et avaient des dettes bilatérales officielles envers le Canada. En tout, le Canada a fourni des traitements de la dette (incluant des allégements) à 48 pays et, dans le cas de nombre d’entre eux, à plus d’une reprise.
Avant 1996, le traitement de la dette bilatérale représentait le mécanisme principal de traitement des dettes, le rééchelonnement des paiements s’étalant sur la durée des échéances et réduisant les paiements au titre du service de la dette dans la plupart des cas. Avec le temps, on a constaté que cette méthode posait problème puisque de nombreux pays n’étaient pas en mesure de verser des paiements réguliers au titre du service de la dette.
L’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (IPPTE) : Comme le rééchelonnement de la dette ne semblait pas porter fruit, le FMI et la Banque mondiale ont lancé l’Initiative en faveur des PPTE en 1996 dans le dessein de réduire sensiblement l’endettement externe des pays les plus pauvres et les plus endettés du monde. La réduction globale supposait la mobilisation de la communauté financière internationale, incluant les organismes multilatéraux, les prêteurs commerciaux et les gouvernements, qui travaillerait de concert pour ramener à des niveaux viables le fardeau de la dette extérieure des pays pauvres les plus endettés4. L’Initiative en faveur des PPTE a été renforcée en 1999, afin de fournir un allégement de la dette plus rapide, plus profond et plus vaste et de renforcer davantage les liens unissant l’allégement de la dette, la réduction de la pauvreté et le développement social. Les initiatives en faveur des PPTE font intervenir les processus d’allégement de la dette tant bilatérale que multilatérale. Vous trouverez à la page suivante une illustration et une description détaillée des étapes de l’Initiative en faveur des PPTE.
L’Initiative canadienne d’allégement de la dette (ICAD) : Dans le cadre de l’Initiative canadienne d’allégement de la dette mise sur pied en 1999, le Canada s’est engagé à annuler la totalité de la dette de nombreux pays à son égard lorsqu’ils auront achevé toutes les étapes de l’Initiative en faveur des PPTE. En 2000, le programme a été élargi afin d’englober tous les pays ayant achevé les étapes de l’Initiative en faveur des PPTE et, en 2001, le Canada imposait un moratoire sur tous les remboursements des PPTE admissibles, y compris ceux en période intérimaire (qui visait uniquement les dettes contractées en vertu d’ententes bilatérales). En 2009, on a évalué à 1,3 milliard de dollars le coût total éventuel de l’ICAD5. Pour recevoir un allégement de la dette aux termes de l’ICAD, les pays doivent franchir deux étapes :
1. Lorsque le pays admissible à l’ICAD fait montre de la capacité d’utiliser efficacement les ressources pour réduire la pauvreté et qu’il a rempli la première série de conditions des étapes de l’Initiative en faveur des PPTE, il bénéficie immédiatement d’un moratoire sur le remboursement de la dette.
2. Lorsque le pays admissible à l’ICAD franchit toutes les étapes de l’Initiative en faveur des PPTE, sa dette est entièrement annulée.
L’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM) : De 1956 à 2005, des organismes multilatéraux comme le FMI et la Banque mondiale avaient la priorité en matière de remboursement de la dette. Les pays débiteurs devaient donc rembourser ces institutions financières avant d’effectuer tout autre remboursement de la dette bilatérale. Il n’était pas question d’annuler les paiements requis puisque ces institutions étaient toujours remboursées.
L’Initiative d’allégement de la dette multilatérale a été établie dans la foulée du sommet du G8 à Gleneagles en 2005 à titre de prolongement de l’Initiative en faveur des PPTE. On a alors reconnu que l’achèvement des étapes de l’Initiative renforcée en faveur des PPTE ne suffisait pas à réduire de façon marquée l’endettement. Le prochain objectif a dont été d’aider à accélérer les progrès en vue de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies6. Tous les pays qui avaient achevé les étapes de l’Initiative renforcée en faveur des PPTE et les PPTE dont le revenu annuel par habitant ne dépassait pas 380 $US et ayant des dettes impayées envers le Fonds à la fin de 2004 étaient réputés admissibles à l’IADM. Dans le cadre de cette initiative, un allégement intégral a été fourni à l’égard de la dette multilatérale admissible découlant de prêts détenus par la FMI, la Banque mondiale, le Fonds africain de développement (FAfD) et la Banque interaméricaine de développement (BID). Une enveloppe de financement constituée par les pays donateurs, dont la majorité sont membres du G8, sert à payer cet allégement. Jusqu’à maintenant, au moins 26 pays ayant achevé toutes les étapes de l’Initiative en faveur des PPTE ont bénéficié de l’IADM. Quatorze pays n’ayant pas encore terminé les étapes de l’Initiative en faveur des PPTE pourraient tirer parti de cette initiative. L’IADM devrait réussir à éliminer en tout 50 milliards de dollars américains en dettes des pays les plus pauvres du monde7.
Dans le cadre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM) qui vient d’être adoptée, le Canada s’est engagé à verser des paiements au FMI, à la Banque mondiale et au Fonds africain de développement au cours des 45 prochaines années afin de les indemniser de l’annulation de la dette à leur égard des pays pauvres très endettés. Les paiements sont groupés à ceux d’autres créanciers, de sorte qu’il est impossible de suivre l’incidence de la contribution particulière du Canada.
Description détaillée des étapes de l’Initiative en faveur des PPTE8 :
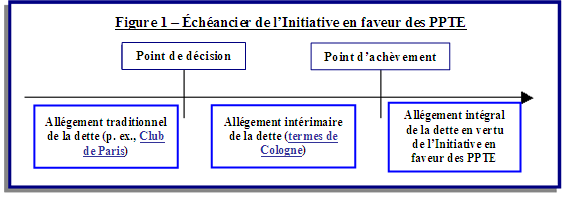
Première étape – Avant le point de décision : L’aide en vertu de l’Initiative en faveur des PPTE ne sera consentie que si le pays remplit des critères particuliers, a un endettement insoutenable, a déjà instauré des politiques acceptables par l’entremise du FMI et de la Banque mondiale et a élaboré un plan afin de se sortir de la pauvreté. À ce stade, les conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale (dont le Canada est membre) décident si le pays a rempli suffisamment de conditions, puis la communauté internationale (les pays appuyant l’Initiative en faveur des PPTE) s’engage à réduire sa dette. C’est ce qu’on appelle le point de décision.
Deuxième étape – Période intérimaire : Le pays peut immédiatement recevoir un allégement intérimaire de la dette, mais il ne touchera le montant intégral prévu par l’Initiative en faveur des PPTE que s’il continue de remplir les autres conditions dictées par le FMI et que s’il a un dossier de ce qui est réputé être un bon rendement. Le Club de Paris fournit au cas par cas l’allégement intérimaire qui réduit les paiements de la dette lorsque le pays aura atteint le point de décision. La période intérimaire peut durer quelque temps, peutêtre deux ans ou plus, selon le moment de la mise en œuvre des réformes clés des politiques indiquées à la première étape, ce qui comprend des éléments tels que le maintien de la stabilité macroéconomique et l’instauration d’une stratégie convenue de réduction de la pauvreté pendant un an. À ce stade, le pays aura atteint le point d’achèvement. L’Initiative canadienne d’allégement de la dette prévoit un moratoire sur le remboursement de la dette des pays à ce stade, qui sera suivi d’un allégement au titre des paiements de la dette que le pays doit faire. L’encours de la dette d’un pays admissible est annulé lorsqu’il atteint son point d’achèvement.
Troisième étape – Point d’achèvement : Les prêteurs fournissent l’allégement intégral promis au point de décision. Le Club de Paris réduit la dette d’au plus 90 % ou de plus encore, au besoin (sur la dette bilatérale). L’ICAD fournit un allégement intégral à ce stade (sur la dette bilatérale). L’IADM a été instaurée en 2005 et fournit également un allégement intégral de l’encours de la dette des PPTE à la fin de 2004. À ce stade, donc, l’allégement de la dette sert à réduire l’encours de la dette du pays.
Au 31 mars 2008, le Canada avait fourni plus de 965 millions de dollars d’allégement de la dette en vertu de l’Initiative en faveur des PPTE.
En 2009, 35 des 41 PPTE avaient atteint le point de décision. Le coût total de l’allégement de la dette en vertu de l’Initiative en faveur des PPTE pour les créanciers est évalué à 74 milliards de dollars américains, en termes de valeur actualisée nette (VAN) à la fin de 2008. Les créanciers multilatéraux et du Club de Paris supportent les parts les plus importantes du coût total de l’Initiative renforcée en faveur des PPTE. De tous les créanciers multilatéraux, c’est le groupe composé de la Banque mondiale, de l’Association internationale de développement (IDA), du FMI et du FAfD qui subit le coût le plus élevé. Le coût de l’IADM est évalué à 29 milliards de dollars américains, en termes de VAN à la fin de 2008. Environ 85 % de cette somme ont déjà été fournis aux 26 pays qui ont atteint leur point d’achèvement. L’aide que l’on s’est engagé à fournir aux 35 PPTE ayant franchi le point de décision totalise 40 % du PIB de ces pays. Une fois l’allégement intégral de la dette versé à ces pays, leur endettement devait être réduit de 80 %9.
Les entités débitrices et créancières ainsi que les genres d’ententes de remboursement de la dette internationale sont assez complexes. Ainsi, le tableau 1 montre les genres de dette souveraine que traitent le Club de Paris et le Club de Londres10 ou qui sont traités de manière ponctuelle.
| Débiteurs | Créanciers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMI | Banques multilatérales de développement | Organismes bilatéraux | Banques commerciales | Obligataires | Fournisseurs | |
| Souverains | Traitement préférentiel | Traitement préférentiel | Club de Paris | Club de Londres | Aucun système formel | Ponctuel |
| Entreprises du secteur public | Aucune dette du genre n’existe | Traitement spécial | Club de Paris | Club de Londres | Aucun système formel | Ponctuel |
| Banques | Aucune dette du genre n’existe | Traitement spécial | Aucune dette du genre n’existe | Traitement spécial | Aucun système formel | Aucune dette du genre n’existe |
| Sociétés privées | Aucune dette du genre n’existe | Régime national de faillite des sociétés | Régime national de faillite des sociétés | Régime national de faillite des sociétés | Régime national de faillite des sociétés | Régime national de faillite des sociétés |
| Source : Rieffel, 2003 | ||||||
3.2 Structure et partenaires l’allégement de la dette
La structure de l’allégement de la dette au Canada est complexe et exige des interactions et des communications entre plusieurs intervenants : le Club de Paris, le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, d’autres banques régionales, le ministère des Finances, l’Agence canadienne du développement international (ACDI), le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), Exportation et développement Canada (EDC), la Commission canadienne du blé (CCB) et certains organismes non gouvernementaux (ONG), comme l’Institut NordSud. Dans la plupart des cas, le FMI et la Banque mondiale, en se fondant sur l’information recueillie au sujet du pays débiteur, décident si ce dernier devrait ou non recevoir l’allégement de la dette, de même que des modalités de l’octroi de cet allégement. Le Canada, grâce à ses représentants au FMI, à la Banque mondiale et au Club de Paris, participe à ces négociations et fournit des commentaires sur les enjeux abordés par ces institutions. Lorsque les ententes globales ont été conclues et que les décisions ont été finalisées, elles sont transmises aux organismes créanciers au Canada, principalement la Commission canadienne du blé et Exportation et développement Canada. L’ACDI a également participé à la négociation des prêts plus anciens sous la classification Aide au développement officielle (ADO). Dans le cadre de ces ententes globales, les représentants de ces organismes négocient les modalités de l’allégement de la dette avec les pays débiteurs. L’annexe B contient une brève description des rôles et responsabilités de différents intervenants canadiens dans l’octroi de l’allégement
3.3 Structure de financement et montant
Au ministère des Finances, les paiements au titre de l’allégement de la dette se composent d’indemnisations au titre de l’allégement de la dette bilatérale et de la part des coûts subis pour l’IADM. Les deux sont classés sous la catégorie « Subventions et contributions » et s’inscrivent au crédit 5 du Budget principal des dépenses11. Les indemnisations au titre de l’allégement de la dette bilatérale peuvent varier considérablement d’année en année puisque, pour une année donnée, le montant intégral peut ne pas avoir été versé aux pays débiteurs. Ainsi, si un pays franchissant les étapes de l’Initiative renforcée en faveur des PPTE et devant atteindre son point d’achèvement à une année donnée connaît des retards, il pourrait ne pas être admissible à recevoir un allégement de la dette pour cette annéelà. De plus, les ententes que le Canada a conclues avec le FMI établissent le montant qu’il doit débloquer au titre de l’allégement de la dette. Par conséquent, le FMI fournit chaque année une estimation de la part prévue représentant les prêts du Canada. Le montant réel des prêts varie en fonction de la variation des taux de change, de la fluctuation de la demande des emprunteurs ainsi que des décisions de planification prises entre le FMI et d’autres prêteurs.
Dans le cas de l’allégement de la dette multilatérale, les indemnisations sont fondées sur une entente contractuelle couvrant plusieurs années et ne sont pas liées au rendement d’un quelconque pays. Par conséquent, plus de certitude existe quant au montant exact de financement exigé du ministère chaque année.
La somme de 370 millions de dollars est attribuée à l’allégement de la dette (programmes combinés de la dette bilatérale et de la dette multilatérale) dans le Budget principal des dépenses de 20082009, tandis que celle pour 20092010 s’établit à 199 millions. Les tableaux 2 et 3 fournissent des précisions sur l’allégement de la dette fourni par le Canada dans le cadre d’ententes bilatérales et de paiements multilatéraux12.
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 211 | 191 | 402 | 402 | ||||||
| Bolivie | 1 417 | 9 650 | 11 067 | 11 067 | ||||||
| Cameroun | 266 | 2 776 | 121 920 | 21 285 | 46 418 | 29 345 | 226 729 | 448 738 | 448 738 | |
| Congo | 25 135 | 2 378 | 870 | 28 383 | 28 383 | |||||
| RDC | 74 465 | 2 075 | 1 509 | 1 032 | 79 080 | 79 080 | ||||
| Éthiopie | 31 | 17 | 13 | 385 | 447 | 447 | ||||
| Ghana | 5 225 | 5 609 | 8 280 | 19 113 | 19 113 | |||||
| Guyana | 1 113 | 66 | 44 | 1 872 | 3 095 | 3 095 | ||||
| Haïti | 152 | 152 | ||||||||
| Honduras | 3 447 | 1 800 | 20 931 | 26 178 | 26 178 | |||||
| Iraq | 427 948 | 427 948 | ||||||||
| Côte d’Ivoire | 116 491 | 12 011 | 128 503 | 128 503 | ||||||
| Madagascar | 2 967 | 4 725 | 4 107 | 2 406 | 21 471 | 35 676 | 35 676 | |||
| Pologne | 169 652 | 105 208 | 81 326 | 63 638 | 65 669 | 70 236 | 54 912 | 610 640 | ||
| Rwanda | 265 | 732 | 437 | 66 | 53 | 3 084 | 4 637 | 4 637 | ||
| Sénégal | 445 | 691 | 289 | 3 968 | 5 392 | 5 392 | ||||
| Tanzanie | 8 110 | 59 033 | 137 | 12 842 | 80 122 | 80 122 | ||||
| Yougoslavie | 158 356 | 47 272 | 205 628 | |||||||
| Zambie | 7 090 | 9 917 | 10 708 | 11 713 | 11 743 | 43 022 | 94 192 | 94 192 | ||
| Total | 18 696 | 258 723 | 529 777 | 222 069 | 159 903 | 616 642 | 347 648 | 55 933 | 2 209 391 | 965 024 |
| Institution | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAfD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 6 900 | 107 900 | 0 | |
| IDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 400 | 20 500 | 41 400 | 51 200 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 600 | 25 800 | 27 400 | 149 300 | 51 200 |
| Total cumulatif nominal | 270 300 | ||||||||||
| Source : Division des finances internationales et du développement, Direction des finances et des échanges internationaux, ministère | |||||||||||
4. Approche et méthode d’évaluation
Comme nous l’avons déjà indiqué, la présente évaluation vise à mesurer la pertinence et le rendement de la participation du Canada aux initiatives internationales d’allégement de la dette relevant de la responsabilité du ministère des Finances. Les initiatives d’allégement de la dette (tant bilatérale que multilatérale) sont menées en collaboration avec des organisations internationales. Comme c’est le cas de la plupart des programmes d’envergure internationale, le Canada n’est qu’un intervenant parmi tant d’autres, bien qu’il soit assez influent13. L’étude d’évaluation se penche sur la participation du Canada aux initiatives d’allégement de la dette. Le Canada prend part aux processus d’élaboration des politiques et aux décisions concernant la mise en œuvre des programmes au FMI et à la Banque mondiale qui débouchent sur le transfert de fonds canadiens conformément à ces politiques. Par conséquent, par souci de transparence, la pertinence et le rendement des initiatives dans leur ensemble ont été évaluées, mais les recommandations proposées ciblent les activités relevant directement de la responsabilité du ministère des Finances.
Quatre éléments de preuve ont été utilisés pour répondre aux questions de l’évaluation : des entrevues auprès d’informateurs, une recension d’études de vérification, d’évaluation et de surveillance du FMI et de la Banque mondiale, une recension d’ouvrages publiés par de tierces parties et une recension de documents et de rapports internes.
La recension de la littérature, dont celle des ouvrages de tierces parties, a été menée essentiellement par des consultants de l’extérieur, tandis que celle des ouvrages sur la mise en œuvre et les entrevues auprès des informateurs clés ont été exécutées par l’équipe d’évaluation du ministère des Finances. Le rapport d’évaluation final a également été préparé à l’interne par des analystes de l’évaluation du ministère des Finances.
4.1 Études de vérification et d’évaluation existantes du FMI et de la Banque mondiale
Il incombe au FMI et à la Banque mondiale de surveiller et d’évaluer les initiatives d’allégement de la dette, puis de présenter des rapports sur le sujet. Les études d’évaluation sont menées périodiquement par les divisions de l’évaluation de la Banque mondiale et du FMI. Les rapports qui en découlent examinent en profondeur l’incidence des initiatives sur chaque pays et sont donc détaillés et informateurs. Les divisions de l’évaluation du FMI et de la Banque mondiale relèvent directement du conseil d’administration de chacune de ces institutions et sont, partant, réputées indépendantes. Il convient en outre de signaler que la plupart des employés de la division de l’évaluation FMI sont recrutés à l’extérieur du FMI14.
De plus, le FMI et la Banque mondiale produisent un rapport de surveillance annuel intitulé « Rapport d’étape sur la mise en œuvre » qui fournit des précisions sur les progrès réalisés par les initiatives et traite des tendances en matière de croissance des pays en développement. Les renseignements recueillis grâce à ces rapports et aux études d’évaluation du FMI et de la Banque mondiale ont servi à préparer les questions de l’évaluation utilisées dans la présente étude15.
4.2 Recension des ouvrages de tierces parties
Les évaluateurs du ministère des Finances ont exécuté une recension approfondie des « études de tierces parties » menées par des universitaires et des ONG qui ne sont pas affiliés aux gouvernements ni aux institutions internationales participants. Cette recension visait à recueillir de l’information sur l’historique et le rendement des initiatives d’allégement de la dette selon un éventail de points de vue. Plusieurs méthodes de recherches ont été utilisées pour trouver ces études, notamment une recherche sur Internet de même qu’une recherche dans plusieurs catalogues et bases de données électroniques disponibles à la bibliothèque du ministère des Finances. À ces recherches s’est greffée une méthode dite de la « boule de neige » en vertu de laquelle les références contenues dans les livres et articles pertinents ont été numérisées afin de trouver d’autres études applicables.
Même si aucune étude de tierces parties sur les initiatives canadiennes n’a pu être trouvée, 26 études sur les initiatives d’allégement de la dette dans leur ensemble ont été examinées, dont 18 qui traitaient de problèmes liés soit à la pertinence, soit au rendement, soit à ces deux éléments; elles ont été intégrées à la présente évaluation.
4.3 Entrevues auprès d’informateurs clés
En tout, 13 experts chevronnés ont été interviewés afin d’obtenir des renseignements détaillés sur la mise en œuvre, le rendement et l’incidence des initiatives liés à l’allégement de la dette. Les renseignements recueillis ont servi à combler les écarts ainsi qu’à compléter et à justifier les constatations obtenues par d’autres méthodes.
Les personnes interviewées ont été choisies de manière à obtenir le plus d’information possible sur le sujet provenant de différents points de vue :
| Catégorie | Nombre |
|---|---|
| Représentants du gouvernement du Canada, y compris du ministère des Finances et de l’ACDI | 4 |
| Représentants de la Commission canadienne du blé et d’Exportation et développement Canada | 3 |
| Représentants de la Banque mondiale et du FMI | 2 |
| Organismes non gouvernementaux | 2 |
| Experts universitaires reconnus en allégement de la dette | 2 |
4.4 Recension des dossiers et des documents internes
Cet élément de preuve comprend la recension de présentations au Conseil du Trésor, de notes de service à l’intention de la haute direction, d’autres articles de correspondance ainsi que des dossiers d’opérations financières. Les Rapports sur les plans et les priorités (RPP), les Rapports ministériels sur le rendement (RMR) et les rapports sur les institutions de BrettonWoods que le ministère des Finances soumet au Parlement ont également été examinés.
5. Questions de l’évaluation et enjeux
Les questions de l’évaluation reposent sur les exigences de la Politique sur l’évaluation de 2009 du Conseil du Trésor et traitent, certaines en profondeur, de la pertinence et du rendement. Le tableau qui suit dresse la liste des éléments de preuve qui ont servi à donner suite à chaque enjeu de l’évaluation – il montre clairement comment l’évaluation a intégré les résultats de plus d’un élément de preuve pour chaque enjeu.
| Question de l’évaluation | Source | |||
|---|---|---|---|---|
| Recension des documents du FMI et de la Banque mondiale | Recension des ouvrages de tierces parties | Entrevues | Recension des dossiers et des documents internes | |
| Pertinence | ||||
| Enjeu 1(a) : Quel est le fondement théorique et stratégique de l’octroi de l’allégement de la dette? | X | X | X | X |
| Enjeu 1(b) : Le mandat et les objectifs stratégiques de la participation du Canada aux initiatives d’allégement de la dette demeurentils pertinents? | X | X | X | X |
| Enjeu 1(c) : Estil encore nécessaire d’indemniser des organismes canadiens (p. ex., EDC et la CCB) de la prestation de services d’allégement de la dette? | X | √ | ||
| Conformité aux priorités du gouvernement | ||||
| Enjeu 2 : La participation du Canada aux initiatives d’allégement de la dette demeuretelle conforme aux priorités du gouvernement? | X | X | ||
| Enjeu 3 : La participation du Canada aux initiatives d’allégement de la dette demeuretelle conforme aux rôles et responsabilités du gouvernement fédéral? | X | X | ||
| Rendement : Réalisation des résultats escomptés | ||||
| Enjeu 4(a) : Les initiatives d’allégement de la dette atteignentelles leurs objectifs? | X | X | X | |
| Enjeu 4(b) : La fourniture d’un allégement de la dette atelle amélioré les conditions économiques et financières des pays bénéficiaires? | X | X | X | |
| Rendement : Conception, exécution et amélioration du programme | ||||
| Enjeu 4(c) : La mise en œuvre des initiatives atelle respecté la conception initiale? | X | X | ||
| Enjeu 4(d) : Existetil des problèmes de conception ou de mise en œuvre susceptibles de nuire à la capacité du Canada d’atteindre ses objectifs en matière d’allégement de la dette? | X | X | ||
| Rendement : Démonstration d’efficience et d’économie | ||||
| Enjeu 5(a) : Les avantages de l’allégement de la dette dépassentils les coûts? | X | X | X | |
| Enjeu 5(b) : La structure de financement de l’allégement de la dette représentetelle le mécanisme le mieux adapté à l’atteinte des objectifs? | X | X | ||
| X = Sources de données utilisées | ||||
6. Limites de l’étude
Comme c’est le cas de la plupart des études d’évaluation, la présente étude a été limitée en raison de contraintes au chapitre des ressources et du temps. Toutefois, ces limites devraient avoir une incidence minime sur les conclusions et les recommandations de la présente évaluation.
Les renseignements d’évaluation extraits de rapports internationaux sont fondés sur une analyse non directe et non expérimentale. L’analyse de l’incidence menée consiste essentiellement en une étude « avant » et « après » du programme dans le même pays puisqu’il est difficile de mener une analyse comparative significative ou de trouver des pays dûment comparables. En raison de la nature de l’analyse (analyse comparative de pays), cette limite n’a pu être corrigée sans consacrer considérablement de temps et de ressources16. Quelques études externes tentent de fait d’isoler les incidences du programme; elles ont été incluses dans la recension de la littérature.
La plupart des rapports d’évaluation consultés lors de la recension de la littérature sont préparés par des entités qui sont affiliées soit à la Banque mondiale, soit au FMI. Bien qu’elles soient réputées des organisations indépendantes, elles peuvent être considérées comme quelque peu partiales du fait même de leur affiliation. Il convient cependant de signaler à nouveau que le groupe d’évaluation du FMI recrute la plupart des membres de son effectif auprès de sources externes. Tant le groupe d’évaluation du FMI que celui de la Banque mondiale relèvent directement du conseil d’administration de ces organisations.
Le petit nombre de personnes interviewées pourrait aussi être considéré comme une limite. Cependant, nous n’avons trouvé que très peu d’experts indépendants qui connaissaient bien le fonctionnement et les opérations des initiatives canadiennes ainsi que le rendement du ministère des Finances à ce chapitre. En bout de ligne, nous sommes satisfaits que certaines des entrevues auprès de représentants d’ONG et d’autres experts ont été structurées afin de traiter de toutes les grandes préoccupations concernant le programme, y compris les différents points de vue. La recension des ouvrages de tierces parties a complété et soutenu les renseignements recueillis grâce à ces entrevues.
7. Résultats de l’évaluation
La présente section valide les éléments probants obtenus grâce aux différents éléments de preuve sur la pertinence et le rendement des initiatives canadiennes d’allégement de la dette qui ont servi à formuler les conclusions et les recommandations.
7.1 Pertinence
Principales constatations
1(a) : Quel est le fondement théorique et stratégique de l’octroi de l’allégement de la dette?
Le principal fondement est la théorie du surendettement, c’estàdire la théorie selon laquelle le niveau de l’encours de la dette de certains PPTE est tellement élevé qu’il est improbable que des remboursements se fassent à l’avenir en raison de la situation financière, économique et politique du pays. Cette situation réduit considérablement la possibilité d’obtenir des fonds de nouveaux investisseurs et, partant, nuit à la croissance du pays débiteur. La plupart des personnes interviewées et nombre des ouvrages consultés conviennent de la validité de la prémisse de base de cette théorie, surtout dans le cas des PPTE.
1(b) : Le mandat et les objectifs stratégiques de la participation du Canada aux initiatives d’allégement de la dette demeurentils pertinents?
Des éléments probants de toutes les sources montrent que le mandat et les objectifs stratégiques de la participation du Canada demeurent pertinents. Par exemple, 14 pays participants à l’Initiative en faveur des PPTE n’ont pas encore atteint le point d’achèvement. De plus, compte tenu de la situation financière mondiale actuelle, davantage de pays pourraient éprouver des difficultés financières et exiger l’annulation de leur dette.
Nous arrivons à la conclusion générale que le Canada devrait continuer de participer aux initiatives internationale d’allégement de la dette bilatérale et multilatérale.
1(c) : Estil encore nécessaire d’indemniser des organismes canadiens (p. ex., EDC et la CCB) de la prestation de services d’allégement de la dette?
Certaines de personnes interviewées se sont interrogées sur la nécessité de continuer de verser de telles indemnisations à EDC, compte tenu de la vigueur de sa situation financière actuelle et de la situation politique et économique de plusieurs des pays débiteurs qui restent. La situation politique et économique de nombre de ces pays est jugée précaire et ne devrait pas se stabiliser sous peu. Notre recension des documents internes nous a montré que les pénalités et les arrérages de ces pays continueraient de s’accumuler avec intérêt et que le gouvernement du Canada, selon les mécanismes en vigueur, continuerait d’indemniser EDC à cet égard. Si cette tendance d’accumulation croissante se maintient, il est raisonnable de conclure que les mécanismes en vigueur pourraient difficilement être soutenus au fil du temps. C’est pourquoi l’évaluation recommande un réexamen du mécanisme.
Recommandation 1 : Le ministère des Finances devrait songer à discuter de cet arrangement avec EDC afin de revoir la nécessité d’indemniser cette société d’État des pertes subies en raison des mesures d’allégement de la dette.
L’objectif visé par les initiatives d’allégement de la dette (tant bilatérale que multilatérale) est « de réduire le fardeau de la dette des pays très endettés pour qu’ils puissent appliquer des politiques de croissance et de développement »17. Dans l’ensemble, les éléments probants montrent que le mandat et les objectifs stratégiques de la participation du Canada aux initiatives d’allégement de la dette étaient pertinents au départ et qu’ils le demeurent aujourd’hui. On s’entend pour dire qu’un programme d’allégement intégral de la dette continue d’être nécessaire et que le Canada peut continuer de jouer un rôle à ce chapitre. Quelques informateurs ont signalé que, puisqu’il n’existait aucun tribunal international de la faillite pour les gouvernements nationaux, le Club de Paris et les initiatives en faveur des PPTE doivent s’acquitter de cette fonction. Certains prétendent que les programmes seront toujours nécessaires, tout comme une tribune internationale semblable à la présente pour régler les différends et atténuer les problèmes liés à l’allégement de la dette.
Le nombre de pays qui demandent l’allégement de la dette et qui y sont admissibles diminue. Avec le temps, le mandat de ces programmes devra être modifié afin qu’il cible davantage la gestion de la dette que l’allégement de cette dernière.
Fondement théorique et stratégique
La théorie qui soustend la fourniture d’un allégement de la dette est celle du surendettement, qui renvoie à une situation dans laquelle l’encours de la dette d’un pays dépasse sa capacité future de le rembourser18. Tel a été le cas de nombre des PPTE qui n’ont pu rembourser l’encours de leur dette et, dans bien des cas, le service de celleci, du seul fait des circonstances financières ou politiques sur leur territoire. Lorsque cela s’est produit, les éventuels investisseurs ont hésité à fournir de nouvelles ressources financières à ces pays ce qui, pour sa part, a limité la capacité de ces derniers à consacrer des sommes à l’éducation, à la santé et à l’infrastructure et les a placés dans une situation économique encore plus précaire. L’annulation de l’encours de la dette devait libérer des ressources et créer une marge de manœuvre financière permettant aux pays bénéficiaires de consacrer ces sommes au développement plutôt qu’au paiement de l’intérêt aux pays mieux nantis. Il importe de signaler que les pays bénéficiaires doivent, en contrepartie, instaurer des programmes et des politiques jugées bénéfiques au développement.
Dans les pays s’acquittant des frais de service de la dette, les paiements d’intérêt élevé auraient également tendance à « accaparer » des ressources éventuelles qu’il conviendrait mieux de consacrer au développement. L’allégement de la dette ou l’annulation de l’encours de la dette crée un marge de manœuvre financière permettant aux pays de consacrer les sommes au développement plutôt qu’au paiement de l’intérêt. La plupart des experts interviewés conviennent de la prémisse de base de la théorie, surtout ceux qui sont associés au programme. De plus les recensions des documents du gouvernement et de la littérature appuient ce point de vue.
Comme nous l’avons déjà indiqué au sujet des initiatives d’allégement de la dette en faveur des PPTE, le pays débiteur doit également remplir de nombreuses conditions imposées par le FMI qui ont principalement trait à la mise en œuvre de programmes macroéconomiques, structurels et sociaux et à l’élaboration de stratégies de réduction de la pauvreté. Pour leur part, ces conditions contribuent à l’établissement d’une conjoncture propice à la croissance à long terme. Certaines des personnes interviewées ont cependant fait savoir que les conditions actuelles sont trop nombreuses et ne se rapportent pas très souvent à la croissance.
En résumé, les résultats obtenus lors des entrevues et de la recension de la littérature nous permettent de constater que la marge de manœuvre financière que l’allégement de la dette crée pour le pays bénéficiaire comporte deux volets. Premièrement, les frais du service de la dette pour le pays débiteur sont réduits, ce qui libère des sommes qui pourraient être consacrées aux programmes sociaux et économiques. Si le pays ne s’acquitte pas du service de la dette parce qu’il est incapable de le faire, l’allégement de la dette ne procurera pas d’avantage financier immédiat. Deuxièmement, l’annulation de la dette plutôt que le rééchelonnement de cette dernière réduit l’encours de la dette ainsi que les frais de service de la dette, de sorte que le pays pourrait tenter d’obtenir du crédit sur les marchés ordinaires, un résultat souhaitable, ce qu’il n’aurait pas pu faire auparavant en raison de son surendettement.
Dans son Rapport d’évaluation de 2006, la Banque mondiale a constaté que, dans certains cas, l’allégement de la dette pouvait remplacer les subventions financières courantes offertes par d’autres programmes internationaux, comme ceux de l’Association internationale de développement (IDA). En général, on s’entend pour dire que l’avantage que présente l’allégement de la dette ne peut se concrétiser que si cet allégement s’ajoute aux subventions financières d’autres programmes de développement. Tant les personnes interviewées que les auteurs d’ouvrages de tierces parties s’inquiètent de ce point et du maintien de la continuité de l’allégement de la dette et des programmes de développement compte tenu de l’actuel ralentissement économique mondial.
Pertinence du mandat et des objectifs stratégiques
La gravité du problème d’endettement des pays en développement est abordée dans plusieurs documents de tierces parties, du FMI et de la Banque mondiale ainsi que dans le document que le gouvernement du Canada soumet au Parlement, le Rapport sur les opérations effectuées en vertu de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes. L’augmentation du fardeau de la dette dans la période ayant précédé la crise des années 1980 (essentiellement) était devenue insupportable pour nombre de pays pauvres, les paiements de la dette dépassant souvent le revenu total produit par les exportations vers l’étranger. Dans le cas du groupe de pays qui, selon la Banque mondiale, font partie de la catégorie des pays à faible revenu19, la dette impayée avait, selon les estimations de sources extérieures, grimpé de 430 % depuis 198020 et, en 2005, représentait 523 milliards de dollars américains. Le taux de croissance (793 %) de la dette envers les institutions multilatérales avait été plus rapide encore, cette dette atteignant 154 milliards de dollars américains. Le ratio du paiement de la dette au revenu d’exportation dépassait 150 % dans le cas des pays qui pensaient être admissibles aux initiatives en faveur des PPTE21. En 2003, 41 pays devaient y être admissibles; ils comptaient pour 14 % des pays en développement et pour 5 % du revenu national brut du monde en développement22.
En 2009, 26 pays avaient atteint le point d’achèvement, car ils avaient rempli toutes les conditions imposées par le FMI concernant les programmes sociaux et la gouvernance. Ces pays ont obtenu un allégement irrévocable de leur dette totalisant près de 39 milliards de dollars américains23. En octobre 2009, 16 des 41 PPTE admissibles continuent d’avoir des dettes impayées24.
Vu le sérieux de la situation de la dette, la majorité des personnes interviewées conviennent qu’il semble approprié de réduire ou d’éliminer la dette, surtout compte tenu du fait que le gros de la dette a été contracté pour payer des biens d’équipement et des services occidentaux pour combler les besoins en développement des pays pauvres. De plus, la justification du maintien de la pertinence du programme se trouve également dans les rapports d’évaluation et de surveillance publiés du FMI et de la Banque mondiale. Même si certains PPTE ont achevé avec succès le programme et améliorent leurs perspectives, de nombreux autres n’ont pas encore atteint le point d’achèvement. Surtout, 14 pays demeurent très endettés et n’ont pas encore obtenu l’allégement intégral de leur dette.
Selon les principaux informateurs et quelques ouvrages de tierces parties, le risque est considérable que certains des PPTE qui quittent le statut de « pays pauvres » croulent de nouveau sous le poids de dettes appréciables. Dans l’actuelle crise financière mondiale, on admet que certains PPTE ayant atteint le point d’achèvement puissent se retrouver de nouveau avec un fort niveau d’endettement. Par conséquent, le programme doit être modifié en fonction de l’évolution de l’environnement extérieur (p. ex., récession économique, créanciers émergents). Toutefois, l’allégement de la dette demeure nécessaire.
On s’inquiète surtout du fait qu’un pays débiteur donné, après avoir obtenu l’allégement de la dette et être redevenu solvable, puisse de nouveau encourir un niveau intenable de dette en empruntant auprès de pays ou de créanciers privés qui ne sont nullement intéressés à suivre les politiques en faveur des PPTE. Il pourrait s’ensuivre un cycle d’allégement de la dette et d’accroissement de la dette qu’il serait difficile et coûteux de rompre.
Puisque l’allégement de la dette est un engagement international que le gouvernement a pris dans le cadre des sommets du G8 et d’autres tribunes internationales, nombreuses sont les personnes interviewées qui estiment qu’il s’agit d’une obligation qui pourrait bien durer pendant les 50 prochaines années. Pour nombre d’entre elles, la principale question n’est pas de savoir si le Canada devrait participer au programme, mais plutôt comment le Canada pourrait faire jouer sa position et son influence sur la scène mondiale pour coordonner les efforts internationaux afin de convaincre les pays créanciers qui ne sont pas membres du Club de Paris de fournir un allégement de la dette. Tous les informateurs ont souligné l’importance de l’approche du Canada, sa participation active aux efforts internationaux d’allégement de la dette ainsi que son encouragement actif des membres plus récalcitrants du FMI, de la Banque mondiale et du G8 à lui emboîter le pas.
Par conséquent, la pertinence pour le Canada de poursuivre l’allégement de la dette semble bien étayée par les éléments probants. Le changement d’orientation des efforts futurs vers l’assurance qu’une nouvelle dette non soutenable ne soit pas contractée de nouveau semble également fondé.
Indemnisation d’EDC et de la CCB
Des entrevues ont été menées sur le sujet auprès de représentants du ministère des Finances du Canada, de la CCB et d’EDC. De plus, nous avons passé en revue un examen des transferts de fonds mené en 2007 et plusieurs autres documents internes. En règle générale, les transferts de fonds et les processus ont été jugés opportuns et exacts, tant par l’examen que par les entrevues.
Toutefois, certaines des personnes interviewées s’interrogent sur le maintien de la pertinence des paiements permanents que le gouvernement du Canada verse à EDC pour l’indemniser de la perte que la société a subie par suite de la participation du Canada aux initiatives d’allégement de la dette. Plusieurs motifs ont été invoqués à l’appui de cet argument.
Le gouvernement avait au départ accepté d’indemniser EDC de sa perte (intérêt et capital), parce qu’il ne savait pas alors si EDC serait en mesure d’acquérir la base de capital voulue pour s’acquitter de son mandat. À l’heure actuelle, les rentrées nettes annuelles d’EDC sont appréciables, et sa marge bénéficiaire est importante, même sans les indemnisations.
De plus, selon l’entente actuelle, lorsque les pays en développement tardent à achever les étapes de l’Initiative en faveur des PPTE, les indemnisations que le gouvernement verse à EDC augmentent au fil des ans, les montants dus légalement à EDC continuant d’augmenter à cause de l’accumulation des frais d’intérêt pour paiement en retard. Vu la précarité de la situation politique et économique de nombre des pays qui restent, situation qui ne devrait pas s’améliorer à court terme, le gouvernement du Canada serait donc obligé d’indemniser EDC de sommes de plus en plus considérables. Prenons l’exemple de la Côte d’Ivoire. Ce pays tarde à achever toutes les étapes de l’Initiative en faveur des PPTE, ce qui devrait faire augmenter de millions de dollars les indemnisations que le ministère des Finances (le gouvernement du Canada) verse à EDC. Le 1er mars 2007, le montant total (encours de la dette, incluant les arrérages et les frais d’intérêt pour paiement en retard) que devait la Côte d’Ivoire à EDC atteignait 146,4 millions de dollars américains, somme qui, le 1er janvier 2009, était passée à 166,2 millions en raison des pénalités et des frais d’intérêt pour paiement en retard25.
Certaines des personnes interviewées ont fait remarquer que la dette due légalement par les PPTE à EDC était passée de 1,1 milliard de dollars canadiens en mars 1999 à 247,7 millions de dollars canadiens en 2008. Cette diminution fait en sorte qu’EDC est considérablement moins exposée aux risques de défaut qu’avant. De nombreuses institutions financières du secteur privé ayant consenti des prêts à des pays très endettés ont accepté de respecter les modalités de l’allégement de la dette contenues dans des ententes du Club de Paris et d’absorber ellesmêmes le coût de ces dettes. Par conséquent, EDC sera l’un des rares créanciers à recevoir un remboursement intégral, incluant les intérêts moratoires, des prêts qu’elle a consentis à ces pays avant mars 2001.
En sa qualité de société d’État, EDC est tenue de verser des dividendes au gouvernement du Canada lorsque ses capitaux dépassent ses besoins prévus. Ces dernières années, EDC est devenue rentable et, par conséquent, verse au gouvernement du Canada des dividendes qui correspondent aux indemnisations reçues, voire qui les dépassent parfois. D’aucuns prétendent qu’à lui seul, ce fait explique pourquoi les indemnisations d’EDC ne sont plus nécessaires.
Le nombre de pays participant aux étapes de l’Initiative en faveur des PPTE qui ont des dettes envers la CCB a diminué sensiblement, de sorte que la situation pourrait soulever les mêmes préoccupations. Or, elle n’est pas jugée aussi importante. De plus, la structure de l’indemnisation de la CCB diffère de celle d’EDC. Ainsi, la CCB n’est pas tenue de remettre des paiements au gouvernement du Canada si elle devient rentable.
Compte tenu de tous ces éléments probants, l’évaluation propose un réexamen de l’entente actuelle d’indemnisation conclue entre le ministère des Finances et EDC.
Recommandation 1 : Le ministère des Finances devrait songer à discuter de cet arrangement avec EDC afin de revoir la nécessité d’indemniser cette société d’État des pertes subies en raison des mesures d’allégement de la dette.
7.2 Conformité aux priorités du gouvernement
Principales constatations
2. La participation du Canada aux initiatives d’allégement de la dette demeuretelle conforme aux priorités du gouvernement?
L’évaluation a constaté que les initiatives d’allégement de la dette étaient conformes aux priorités du gouvernement, en particulier la priorité 4, Présence efficace sur la scène internationale, figurant au Rapport sur les plans et les priorités du ministère des Finances.
3. La participation du Canada aux initiatives d’allégement de la dette demeuretelle conforme aux rôles et responsabilités du gouvernement fédéral?
L’allégement de la dette suppose la coopération à l’échelle internationale de pays créanciers et débiteurs. Il s’agit d’une affaire intergouvernementale qui ressort de la compétence du gouvernement fédéral.
Conformité aux priorités du gouvernement et aux rôles et responsabilités du gouvernement fédéral
Les initiatives d’allégement de la dette ont été jugées conformes aux priorités du gouvernement fédéral qui sont reproduites dans les publications gouvernementales officielles, les documents budgétaires et les documents relatifs aux obligations mondiales du Canada. À titre d’exemple, la présence efficace sur la scène internationale constitue la quatrième priorité dans le Rapport sur les plans et les priorités du ministère des Finances. Dans de nombreux ouvrages et dans toutes les entrevues, on prétend que l’allégement de la dette aide à promouvoir le développement ciblant la réduction de la pauvreté à l’échelle mondiale. Certaines des personnes interviewées ont laissé entendre que l’allégement de la dette est un engagement international que le gouvernement fédéral a pris et qui se poursuivra sur les 50 prochaines années. Le Canada s’acquitte de ses obligations internationales auprès du G8, du FMI et de la Banque mondiale.
L’allégement de la dette suppose la coopération à l’échelle internationale de pays créanciers et débiteurs, de sorte qu’il s’agit d’une affaire intergouvernementale. Même si d’autres ordres de gouvernement peuvent contribuer à ces efforts, c’est en bout de ligne au gouvernement fédéral qu’il incombe de diriger les initiatives du genre au Canada. Vu la clarté des secteurs de compétence, l’évaluation n’a trouvé aucun dédoublement des efforts à ce chapitre entre le gouvernement fédéral et les autres ordres de gouvernement.
Les pays du G8 dirigent les efforts les plus vastes de collaboration internationale en matière d’allégement de la dette de l’histoire. Quelques informateurs ont indiqué que le programme est conforme à la réputation de participant actif à l’établissement de politiques fondées sur l’éthique et la morale dont jouit le Canada à l’échelle internationale. Selon les informateurs et les recensions des ouvrages, l’allégement de la dette est considéré comme un transfert efficace de l’aide. Par conséquent, aucun autre ordre de gouvernement ni aucune autre institution n’est mieux placé que le gouvernement fédéral pour assumer ce rôle.
Quelques informateurs et études de tierces parties ont fait remarquer qu’étant donné les interrelations plus étroites à l’échelle mondiale, les incidences de la pauvreté et du désespoir massifs sur les autres continents peuvent se faire sentir sur le territoire canadien sous forme d’activités illégales, comme le trafic de la drogue, les activités terroristes, les réfugiés économiques, et ainsi de suite. D’aucuns pourront prétendre que la participation du gouvernement fédéral à l’allégement de la dette peut aider d’une certaine façon à améliorer les conditions dans ces pays pauvres et réduire la probabilité que cela se produise.
Certaines des personnes interviewées ont également signalé que les plans socioéconomiques d’amélioration de la situation du pays débiteur supposent parfois la satisfaction de besoins banals, mais nécessaires, comme le financement de l’approvisionnement en électricité des hôpitaux, plutôt que l’octroi d’une assistance plus visible, comme la fourniture de vaccins contre la polio. D’aucuns ont prétendu que, pour diverses raisons, les donateurs privés préfèrent participer à des activités à visibilité plus grande. La participation des gouvernements fédéraux veillerait donc à ce que ces besoins prétendument « banals » soient également comblés.
Solutions de rechange éventuelles et mesures complémentaires
Tous les éléments probants semblent montrer que les initiatives en vigueur constituent une approche raisonnable. Il ne semble pas exister d’autre solution de rechange viable et généralement acceptée aux programmes d’allégement de la dette en place.
La Facilité de réduction de la dette à la Banque mondiale26 a été proposée comme mécanisme complémentaire. Des créanciers privés vendraient à l’occasion la dette souveraine de PPTE pour quelques cents sur le dollar sur le marché secondaire afin d’obtenir de la liquidité. La Facilité octroie des subventions aux gouvernements admissibles pour qu’ils puissent acheter leur dette souveraine sur ce marché secondaire. Les personnes interviewées ont fait remarquer que le Canada et d’autres pays développés pouvaient aussi acheter la dette de pays très endettés et la leur remettre à la condition qu’ils établissent des projets de développement particuliers. Certains ont dit craindre que cette approche ne soient pas utilisée souvent et ne soit pas retenue par certains décideurs, car l’on pourrait alors avoir l’impression que le gouvernement récompense les créanciers privés en se servant de fonds publics. Bien qu’il s’agisse d’une interprétation possible, en remettant la dette souveraine au pays débiteur initial, le gouvernement pourrait réduire la proportion des dettes commerciales (portant un taux d’intérêt élevé) que doivent ces pays pauvres. Cette méthode permettrait également de réduire la possibilité que naissent des fonds de vautours, qui pourraient se révéler très coûteux pour les créanciers. Les fonds de vautours désignent des créanciers privés qui achètent la dette de pays pauvres sur le marché secondaire, comme nous venons de le décrire, puis entament des procédures judiciaires contre ces pays pour les contraindre à rembourser intégralement la dette, avec pénalités et arrérages. Le Canada, de concert avec la Banque mondiale et le FMI, a fourni de l’aide financière aux pays en développement pour lutter contre ce genre de poursuites et pour convaincre les créanciers privés et autres États souverains de soutenir les étapes de l’Initiative en faveur des PPTE.
Des solutions de rechange à l’allégement de la dette, notamment les swaps de créances, ont également été mentionnées, mais elles n’ont pas obtenu bonne presse auprès de la plupart des personnes interviewées ou dans la littérature, car leur conception semble beaucoup trop complexe et qu’elles semblent trop difficiles à mettre en œuvre. Nous n’avons pas réussi à trouver suffisamment d’ouvrages sur l’incidence intégrale des swaps de créances effectués par le passé. De plus, comme ils supposent souvent l’échange des services publics ou de l’infrastructure du pays débiteur contre la dette, l’incidence éventuelle des « swaps » devrait être bien comprise avant de songer à recourir à une telle solution de rechange.
Orientation du programme
Il est ressorti des entrevues et de la recension des ouvrages qu’en général, on s’entend pour dire que les problèmes de gestion ultérieure de la dette viennent compliquer les enjeux de l’allégement de la dette. Des institutions internationales ont entamé des recherches sur le sujet afin de mieux comprendre les résultats négatifs des initiatives en faveur des PPTE, y compris le fait que certains pays se servent de la marge de manœuvre financière accrue pour contracter d’autres dettes plus importantes auprès de créanciers privés, qui consentent rarement des prêts à des conditions très favorables. La situation est aggravée lorsque quelques pays nonmembres ne respectent pas le cadre de viabilité de l’endettement, intégré aux règles du Club de Paris, et sont prêts à prêter imprudemment aux PPTE, qui contractent à nouveau des niveaux dangereux d’endettement. Compte tenu de cette préoccupation et puisque de moins en moins de pays ont des niveaux d’endettement élevés, l’orientation à l’échelle internationale est passée de la fourniture d’un allégement de la dette à la fourniture de programmes de gestion de la dette. Ce changement d’orientation s’est, par conséquent, également opéré au ministère des Finances du Canada.
Dans certains cas, des « prêts odieux » (c.àd. des prêts consentis à des gouvernements qui mettent en œuvre des politiques qui nuisent à leur propre population, par exemple, qui servent à financer des guerres civiles et l’oppression générale) ont été consentis à des PPTE. Des organisations internationales, dont la Banque mondiale et des ONG, mènent des recherches pour cerner les caractéristiques des prêts odieux.
7.3 Rendement : Réalisation des résultats escomptés
L’objectif initial de l’allégement de la dette a été décrit dans de nombreux documents, mais jamais aussi clairement que dans un rapport de la Banque mondiale intitulé « Allégement de la dette des pays les plus démunis: Une mise à jour de l’évaluation de l’initiative PPTE »27. Le but visé est de réduire le niveau d’endettement des pays relativement pauvres de sorte que leurs gouvernements puissent instaurer des politiques de croissance économique et de développement. Au départ, l’objectif était de réduire la dette due par les PPTE, mais il a été élargi en 1999 afin d’englober le développement économique, la croissance, la réduction de la pauvreté et la cessation permanente du rééchelonnement
Depuis 1999, le FMI imposait des conditions préalables à l’octroi de l’allégement de la dette qui incluaient la préparation par les pays débiteurs de plans détaillés décrivant les améliorations qu’ils comptaient apporter à leurs programmes respectifs en matière sociale et en matière de santé ainsi que leurs mécanismes de réduction de la pauvreté. Il convient cependant de signaler que les évaluateurs n’ont pas été en mesure de trouver un lien direct de cause à effet entre l’allégement de la dette et la réduction de la dette, d’une part, et l’amélioration des résultats sociaux, dont la réduction de la pauvreté, d’autre part.
Principales constatations
4(a et b) Les initiatives d’allégement de la dette atteignentelles leurs objectifs? La fourniture d’un allégement de la dette atelle amélioré les conditions économiques et financières des pays bénéficiaires?
Objectif 1 : Le fardeau d’endettement des pays débiteurs sera réduit.
Les éléments de preuve montrent que des progrès appréciables ont été réalisés en vue de l’atteinte de ce but. Des 41 pays admissibles, 26 ont atteint leur point d’achèvement et ont bénéficié d’un allégement irrévocable de leur dette en vertu de l’IPPTE et de l’IADM. À court terme, le but principal de réduire la dette due par les PPTE a été atteint dans le cas des pays ayant franchi le point d’achèvement et dans celui de quelques pays au stade intérimaire. La question de savoir si la réduction du fardeau de la dette est viable à long terme a été débattue en profondeur dans la littérature et par les personnes interviewées.
Objectif élargi 2 : Des politiques de développement économique et de croissance seront mises en œuvre par les pays débiteurs.
Des politiques de développement économique ont été instaurées dans les pays débiteurs, nombre d’entre elles représentant des conditions essentielles que les PPTE doivent remplir avant de recevoir un allégement de la dette. On a signalé que les Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) élaborés sous la surveillance de représentants du FMI et de la Banque mondiale pour les étapes de l’Initiative en faveur des PPTE ne tiennent souvent pas compte des plans en matière sociale et économique qui sont déjà en vigueur dans le pays débiteur. Il pourrait s’ensuivre des solutions inefficientes pour le gouvernement débiteur. De plus, des éléments issus de la recension de la littérature et fournis par les informateurs clés laissent supposer que trop de conditions ont été imposées à certains pays, ce qui a nui à leur capacité d’obtenir un allégement intégral de la dette.
Recommandation 2 : Le ministère des Finances devrait faire valoir l’importance d’intégrer les plans économiques et de développement en vigueur des gouvernements débiteurs aux conditions économiques et financières que les ententes de l’initiative des PPTE exigent.
Objectif élargi 3: Les dépenses en matière d’éducation et de mesures de réduction de la pauvreté augmenteront après la réception de l’allégement de la dette.
On constate, dans les PPTE qui ont franchi le point de décision, une augmentation des dépenses au titre des mesures de réduction de la pauvreté et des programme sociaux comme l’éducation et la santé. Rien n’indique avec précision si ces dépenses sont supérieures à celles que ces pays auraient engagées en l’absence de mesures d’allégement de la dette. Peu d’éléments semblent indiquer que la hausse des dépenses de nature sociale s’est soldée par des améliorations directes dans les domaines de l’éducation et de la santé, par une augmentation des inscriptions dans les écoles ou par une baisse du taux de mortalité.
Objectif élargi 4 : La progression de la croissance, mesurée par la hausse du PIB, et d’autres indicateurs commencera à se faire voir.
Les PPTE ont connu une certaine croissance après avoir franchi le point d’achèvement. Les pays dont les gouvernements sont plus stables ont souvent signalé une certaine amélioration de la croissance. Toutefois, il est difficile de savoir si la progression de la croissance est tributaire des programmes d’allégement de la dette ou de conditions politiques favorables chez les pays débiteurs. Il n’est pas non plus évident si les conditions stratégiques liées à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de l’éducation ont entraîné des améliorations au chapitre de la croissance et du développement.
Les éléments probants laissent supposer un progrès appréciable en vue de l’atteinte du but principal (objectif 1). Des 41 pays admissibles, 26 ont atteint leur point d’achèvement et ont bénéficié d’un allégement irrévocable de leur dette en vertu de l’IPPTE et de l’IADM. De ces 41 pays, 35 ont atteint le point de décision et sont devenus admissibles à l’aide prévue par l’Initiative en faveur des PPTE. On constate qu’en général, les pays qui restent réalisent des progrès. Certains des pays n’ayant pas accompli de progrès appréciables sont habituellement confrontés à des obstacles importants (qui sont principalement liés à des problèmes de sécurité ou politiques) qui les ont empêchés de progresser. À court terme, donc, le but principal de la réduction de la dette due par les PPTE a été atteint dans le cas des pays qui ont franchi le point d’achèvement et par certains pays qui se trouvent en période intérimaire. Il s’en est suivi une réduction du fardeau financier pour ces pays et un accroissement de leur marge de manœuvre financière globale. Dans la littérature, on a débattu longtemps de la question de savoir si la réduction du fardeau de la dette est viable à long terme, et ce sujet a été repris par les personnes interviewées. De fait, il s’agit de la principale critique qui a été formulée à l’égard des programmes d’allégement de la dette puisque de nombreux pays ont de nouveau contracté des emprunts substantiels auprès de pays qui ne sont pas pauvres et lourdement endettés. Pour régler ce problème émergent, la Banque mondiale a lancé des programmes de gestion de la dette et de viabilité de l’endettement auxquels participe également le ministère des Finances du Canada.
Réduction de la dette
L’objectif de la réduction de la dette semble avoir été atteint à court terme, mais tel pourrait ne pas être le cas à long terme28. En juin 2009, l’Initiative renforcée en faveur des PPTE et l’IADM avaient réduit de 29 milliards de dollars la dette de 26 pays29. La série de rapports de la Banque mondiale pour 2009 montre que l’encours de la dette des pays à la veille d’atteindre le point d’achèvement a chuté, passant de 138 milliards de dollars américains, en termes de VAN à la fin de 2008, à 24 milliards de dollars américains. Les rapports d’étape sur la mise en œuvre et les rapports d’évaluation indiquent que, dans le cas des 35 PPTE ayant atteint le point de décision en 2008, les frais de service de la dette avaient été portés de 16,6 % des exportations en 2000 à 4,1 % en 2008. De 1999 à 2008, dans le cas des 35 pays ayant dépassé le point de décision et étant admissibles à l’allégement de la dette, les paiements moyens au titre du service de la dette s’établissaient à 1,1 % contre 4,6 % du PIB, en baisse d’environ 3,5 points de pourcentage.
La figure 2, extraite du Rapport d’étape sur la mise en œuvre de 2009 du FMI, montre la baisse de l’encours de la dette extérieure des PPTE aux différentes étapes du régime. Il convient de signaler que le tableau n’indique pas les niveaux de la dette intérieure pour les pays.
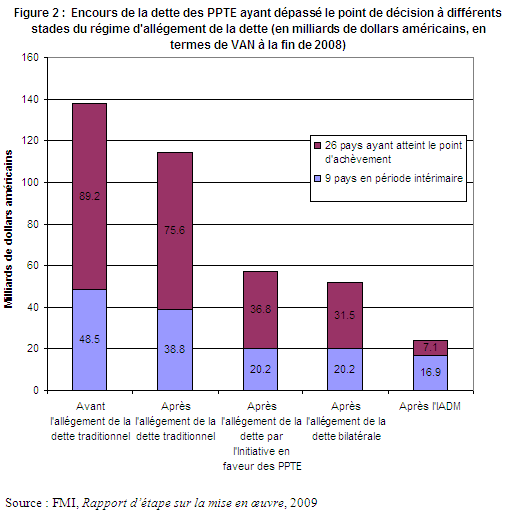
Les figures 3a et 3b montrent que les paiements au titre du service de la dette des pays ayant eu une dette bilatérale avec le Canada et continuant d’avoir une telle dette. La dette en pourcentage du PIB a chuté avec le temps pour les pays ayant dépassé le point de décision. La plupart des constatations issues des entrevues et de l’évaluation ont fourni le contexte de la chute de la dette et des paiements au titre du service de la dette. Par conséquent, les pays qui versaient des paiements au titre du service de la dette avant la mise en œuvre de l’Initiative en faveur des PPTE ont constaté de fait que l’allégement de la dette leur procurait une aide financière, surtout lorsqu’ils atteignaient le point d’achèvement. Les pays en développement qui ne faisaient aucun paiement au titre du service de la dette n’ont pas estimé que l’allégement de la dette était particulièrement utile puisque, dans leur cas, il n’a pas libéré de ressources financières. Cependant, la marge de manœuvre financière additionnelle leur a permis d’acquérir du crédit additionnel, a assoupli les contraintes budgétaires globales et a augmenté leur capacité d’acquérir des outils pour établir leur économie et assurer sa croissance grâce à l’amélioration de leur accès aux marchés internationaux.
La République centrafricaine est un exemple d’un pays ayant réussi à franchir toutes les étapes de l’Initiative en faveur des PPTE. Après avoir conclu une entente avec le FMI, les créanciers du Club de Paris se sont entendus le 20 avril 2007 avec la République centrafricaine au sujet de la restructuration de sa dette extérieure, qui a ramené à zéro les frais du service de la dette de ce pays pour les trois années suivantes30.
Les documents de tierces parties montrent également une amélioration de la valeur actualisée nette (VAN) du ratio de la dette aux exportations. L’annulation de la dette dans le cadre de l’Initiative en faveur des PPTE devrait porter ce ratio des pays participants à 140 %, ce qui est inférieur au seuil officiel de 150 % établi pour les PPTE. En tenant compte de la proposition intégrale concernant la dette multilatérale – autrement dit, la dette envers les institutions financières internationales (IFI) – faite par le G8 en 2005, la mise en œuvre proposée devait ramener ce ratio à un niveau considérablement inférieur, soit 52 %. Le ratio de nombreux pays a été réduit et demeure peu élevé depuis un certain temps. Dans l’intervalle, le ratio d’autres pays a été réduit, mais il montre des signes d’augmentation.
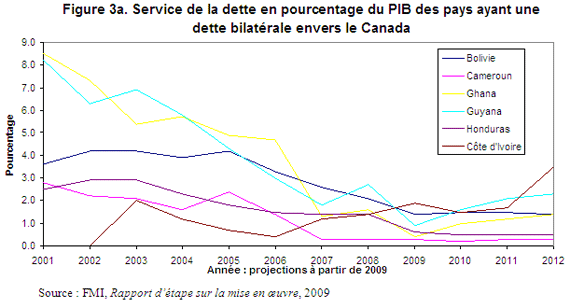
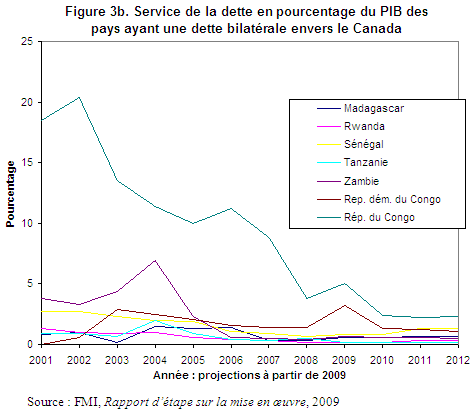
Réduction de la pauvreté et mesures sociales
Ni la recension des ouvrages ni les entrevues ne permettent de savoir clairement si la marge de manœuvre financière additionnelle créée par la réduction de la dette a amélioré les mesures liées à la réduction de la dette et au développement.
Les figures 4a, 4b, 4c et 4d montrent quelques tendances intéressantes pour les pays ayant une dette bilatérale envers le Canada. La figure 4a fait état de changements minimes des dépenses au titre de mesures de réduction de la pauvreté en proportion du PIB dans certains pays, alors que les figures 4b et 4c présentent des tendances positives pour les autres pays.
La plupart des informateurs clés ont prétendu que les améliorations étaient évidentes au chapitre tant de la planification des développements socioéconomiques que de leur mise en œuvre. Certains ont affirmé que les conditions de réduction de la pauvreté imposées par le FMI et la Banque mondiale ne cadraient pas bien avec les priorités du pays, surtout lorsqu’il avait déjà formulé son propre plan avant de conclure une entente dans le cadre de l’Initiative en faveur des PPTE.
Les rapports de surveillance du FMI et les rapports d’évaluation internationaux (FMI et Banque mondiale) suivent les dépenses en matière de réduction de la pauvreté. Ils font état d’une hausse des dépenses à vocation sociale. Selon les rapports du FMI, l’allégement de la dette avait précédé l’augmentation des dépenses en matière de réduction de la pauvreté d’environ 2 % du PIB du début des années 1990 à 2008. Les dépenses totales en matière de programmes sociaux et de réduction de la pauvreté ont progressé, passant de 6,7 % à 8,8 % du PIB entre 2001 et 2007.
La présente étude ne fait que signaler les tendances au fil des ans à partir de données extraites de rapports du FMI et, par conséquent, elle ne peut attribuer directement les tendances des dépenses en matière de programmes sociaux au programme d’allégement de la dette en soi. Pour montrer le lien de cause à effet, il faudrait mener un genre quelconque d’analyse comparative entre les pays afin d’isoler l’incidence de l’allégement de la dette des autres facteurs confusionnels, comme l’environnement économique, les améliorations politiques internes, ou l’absence de telles améliorations, ainsi que d’autres genres d’efforts d’aide coordonnés à l’échelle de la planète. Il s’agit d’une tâche impressionnante que peu d’études internationales ont entreprise. Une étude a tenté de le faire : en 2005, Chauvin et Kray ont conclu à l’absence d’effet clair notable de l’allégement de la dette sur les dépenses en matière de santé et d’éducation. De plus, le rapport d’évaluation de la Banque mondiale (2006) laisse supposer qu’il faut arriver à équilibrer la reprise de la croissance et les dépenses de nature sociale et en matière de réduction de la pauvreté. À l’heure actuelle, les initiatives accordent un peu moins d’importance à l’amélioration de la croissance.
Les éléments témoignent d’une amélioration des conditions sociales sont partagés. À titre d’exemple, ces efforts semblent n’avoir produit que des améliorations modérées des niveaux réels de pauvreté. Certains rapports attribuent la croissance améliorée aux conditions imposées lors des étapes de l’Initiative en faveur des PPTE et avant l’achèvement du régime. Toutefois, l’incidence de ces dépenses n’est pas bien comprise. Ainsi, la hausse des dépenses en matière de santé s’est accompagnée d’une baisse du taux de mortalité infantile. En revanche, les dépenses en matière d’éducation n’ont pas débouché sur des niveaux supérieurs d’inscription dans les écoles ni de scolarité. La série d’études de la Banque mondiale (2009) portait également sur de nombreux indicateurs, comme les taux d’immunisation, la mortalité infantile et le changement dans l’accès aux services d’hygiène et d’eau potable. Ces études montrent un lien positif, quoique légèrement indicatif, de cause à effet en ce qui concerne la mortalité infantile et les montants de la réduction des frais du service de la dette lorsque l’on compare les PPTE et les pays autres que des PPTE qui ont achevé le régime. Cependant, un tel lien positif de cause à effet pour les autres facteurs, dont les niveaux d’immunisation et le changement dans l’accès aux services d’hygiène et d’eau potable, n’a pas été observé, puisque les données montrent que, dans l’ensemble, les pays en développement qui sont des PPTE et autres que des PPTE se sont améliorés à ce chapitre.
Il importe de se rappeler que les initiatives en faveur des PPTE ne sont qu’à leur début – les premiers pays à avoir achevé les étapes de l’Initiative en faveur des PPTE l’ont fait en 2002. Il est donc possible que la pleine incidence de l’augmentation des dépenses consacrées aux programmes sociaux ne se fasse sentir qu’après quelles années de plus.
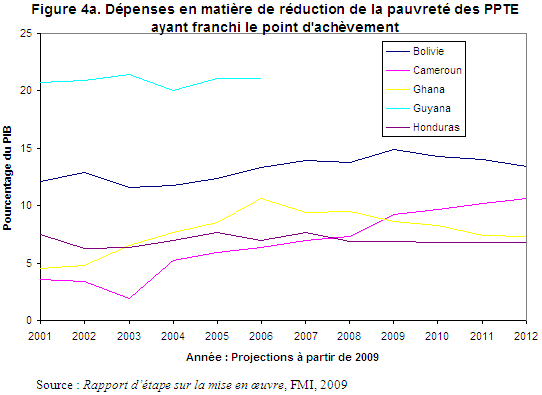
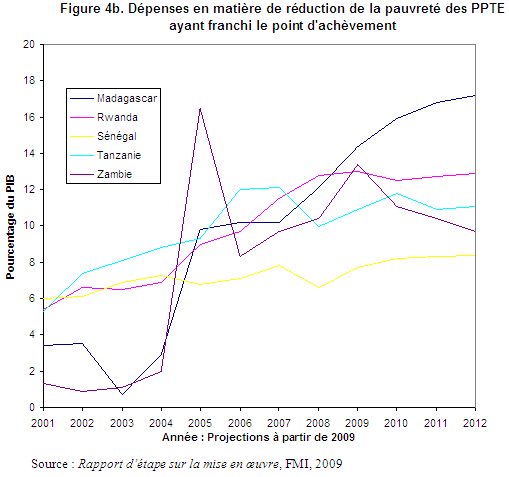
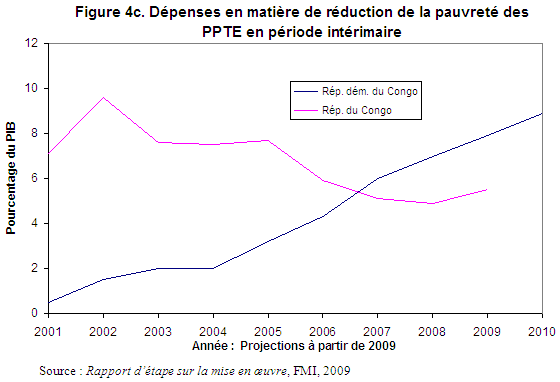
Croissance
Puisque l’allégement de la dette a précédé une croissance économique considérable dans la plupart des pays, il semble exister une corrélation entre les taux de croissance et l’achèvement des étapes de l’Initiative en faveur des PPTE. Les chiffres publiés en 2006 par la Banque mondiale montrent que les taux de croissance du PIB réel ont atteint une moyenne d’environ 4,3 % dans les pays ayant franchi le point d’achèvement sur la période comprise entre 1999 et 2004. Ces taux sont semblables à ceux enregistrés au début de la période entre 1994 et 1998, mais nettement plus élevés que ceux constatés pour la période entre 1980 et 1993, qui s’établissaient à 1,7 %. Ces taux sont également supérieurs aux taux plus récents des PPTE ayant atteint le point de décision, qui s’établit à 2,7 %31.
Les pays ayant franchi le point d’achèvement n’affichent pas encore d’amélioration de leurs revenus ou du rendement de leurs exportations. Diverses études ont surveillé l’ensemble des pays à faible revenu (PPTE et autres) et constaté qu’ils avaient amélioré leur gestion économique ainsi que leur gouvernance générale globale. Les PPTE ont amorcé le processus en situation quelque peu meilleure et ont connu l’amélioration la plus marquée après avoir franchi toutes les étapes de l’Initiative en faveur des PPTE. Cependant, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que la fourniture de l’allégement de la dette a amélioré les conditions financières et économiques des pays bénéficiaires à court ou à long terme.
Un rapport figurant parmi les documents de tierces parties que nous avons examinés laisse entendre que l’allégement de la dette est directement lié aux améliorations à long terme des conditions financières et économiques des PPTE. Par conséquent, sans allégement de la dette, les PPTE n’auraient pas été en mesure d’élargir leurs possibilités de production. Cependant, un autre rapport fait valoir que l’allégement de la dette n’a aucune incidence sur les pays participants puisque l’IDA réduit le montant d’aide accordé à ces pays du montant d’allégement de la dette qu’ils ont obtenu, ce qui donne lieu à un gain financier nul.
Certains ont fait remarquer que les plans de réduction de la pauvreté élaborés sous la supervision de représentants de l’Initiative en faveur des PPTE du FMI et de la Banque mondiale sont souvent élaborés sans qu’il ne soit tenu dûment compte des plans sociaux et économiques qui existent déjà dans le pays débiteur. Il pourrait s’ensuivre des solutions inefficientes pour le gouvernement débiteur. On a en outre proposé qu’une série de politiques en vigueur pourrait simplement avoir été remplacée par une autre série de politiques semblables pour régler des problèmes légèrement différents afin de remplir les conditions. C’est pourquoi certains informateurs et une récente analyse par des tierces parties suggèrent qu’il serait plus productif de travailler de concert avec le gouvernement débiteur que d’imposer des conditions aux pays pauvres. De plus, l’adhésion du pays participant lui fournit la possibilité de pousser plus loin les stratégies de réduction de la pauvreté en vigueur, ce qui se soldera vraisemblablement par des résultats plus efficaces. De même, une approche davantage axée sur la collaboration exigerait forcément plus d’efforts et de ressources des membres du FMI et de la Banque mondiale.
Recommandation 2 : Le ministère des Finances devrait faire valoir l’importance d’intégrer les plans économiques et de développement en vigueur des gouvernements débiteurs aux conditions économiques et financières que les ententes de l’initiative des PPTE exigent.
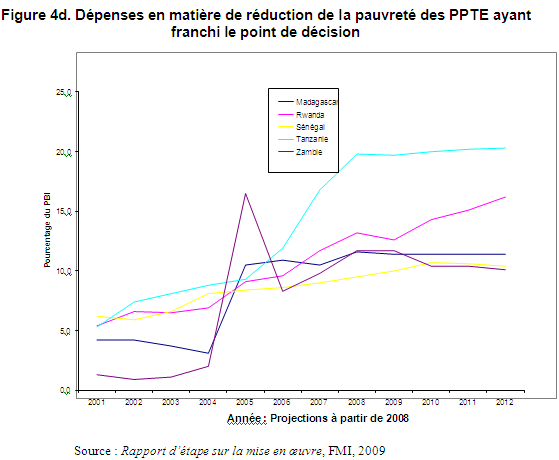
Mesures de la contribution du Canada
Les personnes interviewées s’entendent pour dire que le Canada ne pourrait, à lui seul, obtenir des résultats significatifs. Les efforts internationaux, dans le cadre de programmes tant bilatéraux que multilatéraux, sont la clé du succès. En raison du problème du « bénéficiaire sans contrepartie »32, la coopération entre les pays créanciers est primordiale.
Quoi qu’il en soit, puisqu’il est intéressant d’observer la contribution du Canada, le présent rapport tente d’isoler ses efforts. Les graphiques précédents montrent la tendance des dépenses en matière de réduction de la dette et de la pauvreté dans les pays auxquels le Canada a fourni directement un allégement de la dette de 1 million de dollars américains ou plus dans le cadre d’accords bilatéraux. Ces tendances sont semblables à celles de presque tous les PPTE.
L’Étude d’évaluation, 2008, de la Banque mondiale examine en profondeur quatre pays qui ont des dettes envers le Canada. Un seul d’entre eux, le Honduras, a réduit de façon marquée ses niveaux de pauvreté, tandis que les autres (le Ghana, le Sénégal et la Tanzanie) ont affiché des progrès mitigés seulement. Dans son Rapport d’étape sur la mise en œuvre de 2008, la Banque mondiale a signalé le progrès réalisé par des pays en vue de l’atteinte de leurs Objectifs de Millénaire. Le rapport montre que la plupart des huit pays débiteurs du Canada pourraient atteindre au moins un objectif, que trois pays pourraient en atteindre trois, tandis que deux pourraient atteindre la majorité de leurs objectifs. Toutefois, deux de ces pays n’atteindront vraisemblablement pas la majorité de leurs objectifs.
En 2009, la dette totale des pays pauvres que le Canada avait annulée s’établissait à 965 millions de dollars américains, ce qui comprend la dette des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Haïti est le dernier pays en date (le treizième) à remplir les exigences de l’Initiative canadienne d’allégement de la dette (ICAD). L’ICAD vise à annuler une dette totale de 1,3 milliard de dollars33. Le coût que subit le Canada en raison des accords conclus avec le Club de Paris atteint 209 millions de dollars américains pour ces pays. Le Canada s’est engagé à fournir au FMI, à la Banque mondiale et au Fonds africain de développement la somme de 2,5 milliards de dollars américains sur les 40 prochaines années afin de les indemniser des pertes qu’ils ont subies en raison de l’allégement de la dette international.
Viabilité de l’endettement
Depuis 2002, quelques PPTE ayant atteint le point d’achèvement ont maintenu des niveaux d’endettement viables. L’allégement de la dette fourni dans le cadre de l’Initiative en faveur des PPTE semble avoir eu un effet concret sur la viabilité de l’endettement des pays débiteurs visés. À titre d’exemple, les frais de service de la dette de 32 des PPTE ayant atteint le point de décision représentaient 5 % des exportations en 2007 contre 16,6 % en 2000; ils sont également passés de 651 millions de dollars américains en 2000 à 236 millions de dollars américains en 200734.
Il est impossible de généraliser l’incidence puisque la mesure dans laquelle les pays débiteurs réussissent à maintenir un niveau d’endettement peu élevé après avoir achevé le programme n’est pas encore entièrement connue à ce stade. Comme l’allégement de la dette intégral n’a été atteint qu’après 2002, pas assez de temps s’est écoulé pour nous permettre de savoir si les pays ayant franchi le point d’achèvement seront en mesure de gérer adéquatement leur niveau d’endettement. Des experts du secteur des programmes ainsi que des organisations de l’extérieur conviennent également qu’il est trop tôt pour faire des affirmations sur le sujet.
Par exemple, le Rapport d’évaluation de 2006 de la Banque mondiale indique que 18 pays ont signalé une réduction de 50 % de leur taux d’endettement. Toutefois, 11 des 13 pays ayant atteint le point d’achèvement ont par la suite constaté une détérioration à ce chapitre et 8 de ces 13 ont de nouveau dépassé les seuils de l’Initiative des PPTE (150 % des exportations). Cette situation découle en large part des nouveaux emprunts, bien que les taux de change pourraient également y avoir contribué.
Une étude du FMI35 utilisant des simulations informatiques montre que, en présumant des tendances de croissance et d’emprunt stables, les taux d’endettement avant et après l’IADM tendent à converger à long terme. Ainsi, l’allégement de la dette fourni par l’IADM réduit la VAN du ratio de la dette aux exportations d’en moyenne 40 % de 2006 à 2010 mais, en 2025, la différence entre les ratios de la dette avant et après l’IADM diminue pour atteindre un peu plus de 10 points de pourcentage. La simulation présume de l’existence d’une dette accumulée découlant de nouveaux emprunts. Ces résultats sont conformes à ceux de l’étude d’Easterly (2001) sur les tendances antérieures d’emprunt et de réduction de la dette des PPTE et des pays créanciers. Toutefois, l’hypothèse initiale – à savoir que ni les tendances de croissance, ni les tendances d’emprunt ne changeraient après la nette réduction du surendettement de ces pays – semble quelque peu rigide.
La plupart des observateurs estiment qu’il est trop tôt pour déterminer la viabilité de l’endettement et qu’il faudrait un horizon plus long, soit d’environ 20 ans. D’autres sont d’avis que le meilleur indice de la viabilité de l’endettement est l’analyse sur la viabilité de l’endettement que le FMI a effectuée avant de venir en aide aux pays dans le cadre de l’Initiative en faveur des PPTE. Les PPTE continuent d’avoir de la difficulté à assurer la viabilité de l’endettement, puisque, d’une part, ils continueront vraisemblablement d’emprunter pour combler leurs besoins en développement et que, d’autre part, leur base d’exportations est étroite et leurs gains sont trop incertains. En outre, la récente tourmente économique internationale de 2007 à 2009 pourrait avoir joué sur les buts des pays en développement ainsi que sur ceux des pays créanciers.
Le ministère des Finances du Canada a élargi la portée de ses programmes, passant de l’octroi d’un allégement de la dette à la promotion de politiques de collaboration avec le FMI et la Banque mondiale pour la mise en place d’initiatives de gestion de la dette et de viabilité de l’endettement pour ces pays, approche qui obtient l’aval de la plupart des personnes interviewées. En général, on s’entend pour dire que le changement d’orientation devrait figurer au tout premier rang des priorités, sinon il pourrait en découler des conséquences négatives, comme un fardeau de la dette passablement plus lourd et des coûts nettement plus élevés pour les pays créanciers, comme le Canada.
Effets inattendus
De nombreux effets imprévus et inattendus se sont fait sentir depuis l’instauration de l’allégement de la dette, certains étant positifs et d’autres, quelque peu négatifs.
Les éléments pointant vers l’incidence sur la production de revenus fiscaux nationaux ne sont pas clairs, mais certaines des personnes interviewées et certains des ouvrages recensés36 laissent entendre que l’allégement de la dette pourrait de fait avoir eu une incidence négative sur cette production. La disponibilité des fonds provenant de l’Initiative en faveur des PPTE pourrait faire en sorte que les dirigeants gouvernementaux hésitent à relever les impôts en raison des tensions politiques qui s’exercent sur eux pour les faire baisser.
Il est ressorti des entrevues avec les informateurs clés et de quelquesunes des études d’évaluation que les pays pauvres qui ne sont pas très endettés n’ont pas accès aux mêmes ressources consenties à des conditions favorables37 que les PPTE. Les pays qui se sont bien gérés et qui remboursent leurs dettes ne sont pas considérés comme faisant partie de la catégorie des PPTE et, à la fin des étapes de l’Initiative en faveur des PPTE, ils sont, en un sens, pénalisés pour avoir bien gérer leurs affaires. On propose que les donateurs s’assurent de ne pas favoriser les PPTE au détriment des pays à faible revenu qui ont un bon rendement. Le Bangladesh est un exemple de pays pauvre dont l’encours de la dette est important mais qui, parce qu’il n’a jamais cessé de rembourser ses dettes, n’est pas jugé admissible à l’aide offerte aux PPTE. En 1999, le Canada a décidé unilatéralement, en dehors de l’Initiative en faveur des PPTE, d’annuler l’ensemble des prêts à rembourser du Bangladesh en raison de son bon dossier en matière de réforme économique.
Les conditions imposées pour obtenir l’aide en vertu de l’Initiative en faveur des PPTE sont souvent nombreuses, et certains pays ont de la difficulté à les remplir. Le nombre et la gravité des conditions varient également selon les pays bien que les buts finals semblent être les mêmes. Les conditions peuvent entraîner de longs retards et créer de nombreux obstacles en vue de l’obtention de l’allégement de la dette requis, ce qui inquiète certaines personnes interviewées et certains auteurs d’ouvrages et les porte à dire que l’allégement de la dette n’est pas un processus objectif puisqu’il est sujet aux partis pris38.
D’autres ouvrages de tierces parties39 et d’autres informateurs clés signalent que les sommes fournies par le FMI et la Banque mondiale au titre de l’allégement de la dette pourraient ne pas débloquer plus de fonds à consacrer aux perspectives de croissance. La fourniture de cet allégement de la dette s’assortit d’un certain risque « moral ». Ces pays pourraient officiellement accepter des mesures de réduction de la pauvreté afin d’obtenir des réductions considérables de leur encours de la dette ainsi que des subventions de pays créanciers membres et, après avoir obtenu ces sommes, ces mêmes pays pourraient revenir aux pratiques génératrices d’endettements intenables en supposant que d’autres allégements de la dette leur seront fournis au besoin.
En revanche, pour que les dirigeants puissent prévoir d’utiliser à mauvais escient les fonds obtenus grâce à l’allégement de la dette, le gouvernement du pays débiteur doit exercer ses choix de manière rationnelle en songeant au long terme. En effet, l’obtention de ces fonds s’inscrit habituellement dans un long processus en vertu de l’Initiative en faveur des PPTE. Certains prétendent qu’une telle situation ne se produira vraisemblablement pas puisque les échéanciers des dirigeants politiques se limitent habituellement aux périodes entre deux élections.
Nombre des personnes interviewées et certains des ouvrages recensés signalent que le problème du risque moral existe en théorie mais que, dans la pratique, les pays doivent faire montre d’efforts de mise en œuvre de politiques de croissance et de réduction de la pauvreté avant de recevoir l’allégement de la dette. Même si certains pays, à différentes étapes de l’Initiative en faveur des PPTE, retournent vers des politiques encourageant le gaspillage40, il s’agit d’une situation à laquelle on pourrait s’attendre de tout programme ou de toute politique consentant des subventions ou une autre forme d’aide financière. On peut s’attendre à ce qu’une certaine proportion de bénéficiaires réagissent de la sorte. D’aucuns ont également fait valoir que cette situation explique pourquoi il ne faut pas envisager l’allégement de la dette en vase clos, mais qu’il faut plutôt l’inscrire dans un cadre d’aide, de politiques macroéconomiques et de renforcement de la capacité dans le pays qui est constitué de manière à gérer dûment la dette.
Le problème des bénéficiaires sans contrepartie attire lui aussi l’attention. Il survient lorsque des pays créanciers participants (ceux participant à l’Initiative en faveur des PPTE et ceux qui sont membres du Club de Paris) fournissent un allégement de la dette pour améliorer la situation financière des pays en développement alors que d’autres créanciers éventuels qui ne sont pas membres de ces organisations, comme la Chine et l’Inde, profitent de la marge de manœuvre financière ainsi créée en consentant des prêts non soutenables à ces pays.
Comme nous l’avons mentionné dans la section précédente, le problème des fonds de vautours a été observé récemment. Une entreprise privée peut acheter la dette de pays en développement de créanciers privés à des taux relativement bas puis, lorsque la situation financière du pays est plus solide (grâce à l’Initiative en faveur des PPTE), elle peut déclencher des procédures judiciaires contre le pays en développement pour le contraindre à rembourser la dette. De nombreuses poursuites ont été entamées en 2008 contre le Sierra Leone, la Zambie et la République démocratique du Congo. Certains pays créanciers ont commencé à adopter des lois qui limitent la portée des poursuites contre les PPTE.
Le problème de l’antisélection par les créanciers est un autre effet inattendu de l’allégement de la dette41. Les pays visés par l’Initiative en faveur des PPTE ont beaucoup plus de chance de recevoir de l’aide non liée à la dette qui s’ajoute à l’allégement de la dette que ceux qui ne reçoivent aucune forme de rééchelonnement ou d’annulation de la dette. Par conséquent, l’effet de l’allégement de la dette est amplifié par l’aide additionnelle. Cela suppose, dans le cas des pays donateurs ayant un budget fixe au titre de l’aide internationale, que les pays qui ne sont pas des PPTE (il pourrait s’agir de pays pauvres mieux gérés) recevraient moins d’aide que les PPTE. Chauvin et Kray (2006) ont constaté que les pays dont les politiques gouvernementales étaient faibles recevaient plus d’aide et un montant supérieur d’allégement de la dette les premières années (de 1989 à 1993), mais que cette situation se renversait les années ultérieures (de 1999 à 2003), ce qui indique que le problème de sélection s’est atténué dans les années ultérieures.
La majorité des informateurs clés reconnaissent que ces problèmes existent et méritent que l’on s’y attarde, mais une solution de rechange à l’allégement de la dette qui serait transparente et qui réduirait les distorsions ne saute pas aux yeux.
7.4 Rendement : Conception et exécution du programme
Principales constatations
4(c) La mise en œuvre des initiatives atelle respecté la conception initiale?
En général, le but principal et la conception globale des initiatives n’ont pas changé, bien que le mandat et la portée aient été élargis au fil des ans. Ces changements ont été apportés pour accroître la souplesse et pour permettre aux pays débiteurs de participer davantage à la conception de l’allégement de la dette.
4(d) Existetil des problèmes de conception ou de mise en œuvre susceptibles de nuire à la capacité du Canada d’atteindre ses objectifs en matière d’allégement de la dette?
Au Canada :
On signale que les voies de communication entre les différents partenaires au Canada, surtout entre le ministère des Finances et l’ACDI, devront être solides, surtout maintenant, en raison du changement d’orientation de la politique (à l’échelle internationale) en faveur de la gestion de la dette ainsi que de la prestation de certains services liés à la gestion de la dette par les deux ministères.
Certaines des personnes interviewées ont fait remarquer que le gouvernement du Canada ne fait pas clairement connaître au public ses contributions en matière d’allégement de la dette et le rôle qu’il a assumé à l’échelle internationale pour faire progresser ces initiatives, surtout en ce qui concerne l’Initiative canadienne d’allégement de la dette. Par exemple, la dernière mise à jour du site Web sur les initiatives d’allégement de la dette remonte à 2005.
Recommandation 3 : Le ministère des Finances devrait améliorer l’information fournie sur les initiatives d’allégement de la dette, de sorte que l’information présentée aux Canadiennes et aux Canadiens soit d’actualité et décrive clairement le rôle du Canada, ses contributions à l’allégement de la dette bilatérale et multilatérale ainsi que le rendement des initiatives d’allégement de la dette.
À l’étranger :
Les conditions imposées par le FMI sont jugées insatisfaisantes par certaines des personnes interviewées et par une étude menée par le Groupe d’évaluation indépendant du FMI. Les conditions sont imposées à l’externe, elles sont souvent trop nombreuses et ne cherchent pas directement à encourager la croissance et à réduire la dette. Cependant, l’on s’entend en général pour dire qu’il est nécessaire d’appliquer certaines conditions pour faciliter la croissance.
Recommandation 4 : Le ministère des Finances devrait veiller à instaurer un mécanisme de réexamen périodique du processus de l’Initiative en faveur des PPTE prévoyant l’établissement des conditions et l’examen périodique de ces dernières de sorte qu’elles soient réalisables et essentielles à la croissance et au développement du pays bénéficiaire.
La conception et l’exécution du programme ont été abordées essentiellement dans le cadre des entrevues et de la recension des documents internes, bien que certains ouvrages traitent d’éléments de la conception du programme à l’échelle internationale.
Le but ultime de l’allégement de la dette n’a pas changé en principe et la conception globale est demeurée la même. Des rajustements ont été apportés au fil des ans pour corriger ou diminuer les problèmes de conception et d’exécution du programme à mesure qu’ils surgissaient. Certaines des personnes interviewées font état d’un assouplissement constant des règles et des conditions et précisent qu’elles ciblent maintenant davantage les stratégies de réduction de la pauvreté. De plus, au niveau opérationnel, le système est réputé plus souple maintenant puisque les pays débiteurs participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de leurs propres stratégies. La conception est en voie d’être modifiée afin d’y intégrer les stratégies de gestion de la dette avec les pays débiteurs.
Il ne reste maintenant que quelques PPTE ayant un encours de la dette élevé, et les travaux en matière de politiques portant sur les initiatives de la dette multilatérale au ministère des Finances sont en voie d’être élargis afin d’englober l’établissement de programmes pour aider les PPTE à élaborer des cadres stratégiques de gestion de la dette viable ainsi que des outils de gouvernance efficaces comme la formulation de budgets, entre autres. Le ministère des Finances et l’ACDI, de concert avec la Banque mondiale et des ONG, se penchent sur différents programmes et stratégies ciblant ce but et les élaborent.
Le FMI applique également de nombreuses conditions préalables dans le cadre des étapes de l’Initiative en faveur des PPTE. Ainsi, il a demandé que soit effectuée une évaluation plus rigoureuse de la viabilité future de l’endettement du pays débiteur, ce qui devrait fournir des renseignements sur l’éventuelle capacité du pays de maintenir la dette à un niveau soutenable. Il convient en outre de signaler que l’analyse se fonde sur des prédictions à hypothèses très fixes concernant la croissance future du pays et que, partant, elle fournit au mieux une estimation sommaire de la viabilité. Au nombre des autres conditions, mentionnons la surveillance du budget du pays bénéficiaire pour y déceler les éventuelles dépenses imprévues et frivoles.
Au Canada
Passablement de politiques et de programmes en matière d’allégement de la dette et, dernièrement, en matière de viabilité de l’endettement et de gestion de la dette, ont été élaborés de manière indépendante tant au ministère des Finances du Canada qu’à l’ACDI. Il est primordial que les communications entre les ministères soient régulières et éclairées parce que l’orientation des travaux au ministère des Finance passe à la gestion de la dette et à la viabilité de l’endettement, deux sujets qui ont longtemps été un élément important des travaux de développement de l’ACDI. On peut s’attendre à ce que le ministère des Finances accroisse ses efforts à ce chapitre compte tenu de l’orientation actuelle de la Banque mondiale et d’autres organisations internationales.
Certaines des personnes interviewées ont fait remarquer que le gouvernement du Canada ne fournit pas de précisions sur ses contributions en matière d’allégement de la dette ni sur le rôle qu’il a assumé sur la scène internationale pour faire progresser cette initiative. Surtout, il existe peu d’information sur l’Initiative canadienne d’allégement de la dette, même si le rapport Bretton Woods est déposé périodiquement au Parlement. Quant à lui, le bureau des comptes du gouvernement américain soumet des rapports périodiques sur les paiements particuliers – bilatéraux et multilatéraux – cumulatifs qui ont été versés au titre de l’allégement de la dette. Des renseignements du genre serviraient à informer le public et les parlementaires des progrès réalisés jusqu’à présent et alimenteraient la discussion et l’analyse plus approfondie de l’étendue de la participation internationale du Canada. On trouve parmi les ouvrages recensés dans le cadre de la présente évaluation très peu de documents publics qui résument la contribution particulière actuelle du Canada aux initiatives bilatérales et multilatérales ou le rendement des initiatives en faveur des PPTE, comme la réussite en matière de réduction de la dette et ainsi de suite. À titre d’exemple, le site Web du ministère des Finances décrivant le programme d’allégement de la dette n’a pas été mis à jour depuis 2005 et comporte peu de renseignements sur les contributions canadiennes.
Recommandation 3 : Le ministère des Finances devrait améliorer l’information fournie sur les initiatives d’allégement de la dette, de sorte que l'information présentée aux Canadiennes et aux Canadiens soit d’actualité et décrive clairement le rôle du Canada, ses contributions à l’allégement de la dette bilatérale et multilatérale ainsi que le rendement des initiatives d’allégement de la dette.
À l’étranger
Il ressort des entrevues que le maintien de voies diplomatiques claires et de communications régulières est un défi constant lorsqu’il s’agit d’encourager les créanciers publics à poursuivre leurs efforts de coopération pour le financement des prêts à des conditions de faveur et des subventions aux PPTE. On s’inquiète en particulier des marchés émergents qui veulent favoriser la croissance dans leurs pays en fournissant du crédit à des pays à faible revenu. Ces créanciers ne font pas partie des créanciers initiaux de l’Initiative en faveur des PPTE et comptent pour environ 7 % du coût total de l’Initiative en faveur des PPTE. Vingt de ces créanciers ont accepté de participer à l’Initiative en faveur des PPTE, tandis que les huit autres ne l’ont pas encore fait. Par suite de communications avec les créanciers privés, certains d’entre eux ont accepté de se conformer aux étapes de l’Initiative en faveur des PPTE et d’offrir aux PPTE des prêts à des conditions favorables.
L’économie mondiale s’étant aggravée l’an dernier, il pourrait aussi être difficile d’assurer le financement de l’IPPTE et de l’IADM. Le nouveau climat économique mondial et la situation financière du gouvernement ont porté certaines des personnes interviewées à craindre que le gouvernement ne soit tenté de s’éloigner de ses engagements liés à l’allégement de la dette. Il semble que les partenaires européens ne soient pas portés à changer de cap puisqu’ils sont plus étroitement liés aux pays débiteurs par des liens historiques, financiers et géographiques. La majorité des personnes interviewées espèrent que le Canada, à l’instar de ses partenaires européens, maintiendra le cap.
Même si nombre des personnes interviewées conviennent de la nécessité des conditions imposées aux PPTE, certaines ont proposé qu’il serait préférable de travailler directement avec le pays afin d’établir les mécanismes qui conviennent le mieux pour assurer la réussite de la croissance au lieu d’imposer des conditions. Dans un communiqué de 2009, la Banque mondiale indique que, dans nombre de ces pays, les conditions fondamentales qui ont mené à l’accumulation de dettes, comme les bases étroites de production et d’exportation, perdurent. Cela laisse entendre qu’il pourrait être nécessaire de travailler directement avec les gouvernements débiteurs afin que ces conditions fondamentales puissent s’améliorer. D’autres personnes interviewées jugeaient inadéquates les conditions du FMI puisqu’elles ne tiennent pas compte du plan de croissance économique antérieur à l’adhésion à l’Initiative des PPTE du pays et ne tentent pas de l’intégrer. Cet avis est soutenu par l’étude que le Groupe d’évaluation indépendant du FMI a menée en 200742 et qui porte que nombre des conditions du FMI sont excessives et qu’elles ne sont pas toujours centrées sur le but visé, à savoir établir une économie saine au fonctionnement indépendant.
Enfin, certaines des personnes interviewées ont laissé entendre que le succès repose sur le sentiment d’appartenance du programme de réforme que ressent le pays bénéficiaire. Bien que certains informateurs conviennent de cette constatation, d’autres ont affirmé que le FMI semblait tenter d’atteindre des objectifs idéologiques plutôt que d’instaurer une approche pratique. On a surtout critiqué la promotion de la privatisation des ressources naturelles comme l’eau ou le gaz naturel. Dans l’ensemble, cependant, on s’entend pour dire que certaines conditions sont nécessaires, ne seraitce que pour veiller à que les fonds ne soient pas utilisés par des dirigeants corrompus à des fins inadéquates (allégement de la dette odieuse).
Recommandation 4 : Le ministère des Finances devrait veiller à instaurer un mécanisme de réexamen périodique du processus de l’Initiative en faveur des PPTE prévoyant l’établissement des conditions et l’examen périodique de ces dernières de sorte qu’elles soient réalisables et essentielles à la croissance et au développement du pays bénéficiaire.
7.5 Rendement : Efficience et économie du programme
Principales constatations
5(a) Les avantages de l’allégement de la dette dépassentils les coûts?
Toutes les personnes interviewées s’entendent pour dire que, de fait, les avantages des initiatives d’allégement de la dette dépassent les coûts. La valeur en dollars du coût total de l’allégement de la dette, incluant les coûts administratifs, est relativement très faible. De plus, de nombreux pays bénéficiaires n’auraient probablement jamais pu rembourser le Canada. La souplesse financière compte parmi les avantages de l’allégement de la dette. D’autres avantages sont décrits à la section « pertinence » ci‑dessus, notamment l’importance de coopérer avec les partenaires du G8 à un programme international de grande envergure.
L’administration du programme a été jugée efficace, le petit nombre d’employés faisant en sorte que ses coûts sont relativement peu élevés.
5(b) La structure de financement de l’allégement de la dette représentetelle le mécanisme le mieux adapté à atteinte des objectifs?
L’évaluation a constaté que l’actuelle structure de financement en vertu du crédit 5 pourrait ne pas être le mécanisme le mieux adapté puisqu’elle manque de la souplesse qui permettrait aux administrateurs de rajuster les montants au besoin.
Recommandation 5 : Le ministère des Finances devrait examiner la structure de financement de l’allégement de la dette multilatérale afin de trouver le mécanisme de financement le mieux adapté et le plus efficient qui fournirait aux gestionnaires de programmes la marge de manœuvre voulue pour donner suite en temps opportun à l’évolution des besoins, qui est principalement le fait de facteurs extérieurs.
Coûts des initiatives d’allégement de la dette par rapport aux avantages
Toutes les personnes interviewées, dont les représentants des ONG, du FMI et de la Banque mondiale, conviennent que, de fait, les avantages de l’allégement de la dette en dépassent les coûts. Le montant en dollars du coût total pour le Canada au titre de l’allégement de la dette, incluant les coûts administratifs, est relativement faible par rapport au budget fédéral annuel du Canada. En outre, plusieurs informateurs ont signalé que le Canada ne subirait pas de réduction réelle du revenu en fournissant un allégement de la dette étant donné que, de toute façon, nombre des PPTE n’avaient pas versé de paiements au titre du service de la dette.
Essentiellement, la majorité convient que l’annulation de la dette rendait tout simplement officielle une situation qui existe déjà. Un seul des informateurs n’était pas d’accord avec cette conclusion, que de nombreuses personnes estiment être un argument en faveur du maintien du cap. D’autres encore, surtout des auteurs d’études universitaires ou de recherches menées par des ONG, laissent entendre que le Canada pourrait en faire davantage en matière d’allégement de la dette. Par exemple, certains ont proposé que l’assouplissement des conditions d’admissibilité pendant les étapes de l’Initiative en faveur des PPTE viendrait probablement en aide à plus de pays.
L’administration du programme et le recours au système de paiements de transfert aux fins de l’allégement de la dette internationale sont jugés efficaces et présentent peu de dédoublement, ce qui se traduit par des coûts relativement peu élevés. Un petit nombre de personnes du ministère gèrent et traitent des sommes assez considérables sans que des problèmes importants n’aient été signalés concernant ce processus.
En 2007, la Division de la vérification et de l’évaluation a mené un examen interne du processus de paiements de transfert, de la rapidité et de l’exactitude des échanges de paiements entre le ministère des Finances, d’une part, et EDC, la CCB, le FMI et la Banque mondiale, d’autre part. Elle a constaté que les paiements étaient calculés avec exactitude et versés en temps opportun. Les entrevues auprès de représentants du secteur de programmes, d’EDC et de la CCB qui ont été menées dans le cadre de la présente évaluation étayent cette constatation. Toutefois, on a également fait remarquer qu’aucune vérification officielle des mécanismes de contrôle et des processus des initiatives d’allégement de la dette au ministère des Finances n’avait été exécutée. Le caractère satisfaisant des mécanismes de contrôle et des processus pourrait devoir faire l’objet d’une vérification périodique, compte tenu des montants des paiements de transfert.
Structure de financement
Le ministère des Finances classe les initiatives d’allégement de la dette dans la catégorie des subventions et des contributions et les énumèrent au crédit 5 dans le Budget principal des dépenses de 2009201043. L’allégement de la dette bilatérale est une indemnisation versée à la Commission canadienne du blé et à Exportation et développement Canada au titre des pertes subies en raison de l’annulation de la dette des PPTE. L’allégement de la dette multilatérale désigne l’indemnisation versée aux institutions financières internationales, comme la Banque mondiale et le FMI, au titre des pertes subies lorsqu’elles ont annulé la dette des PPTE à leur égard. Il conviendrait de distinguer clairement la provenance des fonds au titre de la dette bilatérale de celle des fonds au titre de la dette multilatérale. Le financement de l’allégement de la dette multilatérale provient intégralement de l’enveloppe de l’aide internationale44 et, par conséquent, il doit être établi à titre de nouveaux paiements chaque année. Le financement de l’allégement de la dette bilatérale ne provient pas de cette enveloppe, mais plutôt de fonds provisoires ou de « réserves pour éventualités » qui ont été mis de côté en 1990 afin de protéger le Canada contre les risques liés à la dette internationale.
Les personnes interviewées ont fait savoir que l’actuelle structure de financement prévue au crédit 5 pourrait ne pas être la structure la mieux adaptée puisqu’elle n’est pas assez souple pour permettre de rajuster les montants au besoin. De plus, elle ne garantit pas que les fonds seront disponibles lorsqu’ils seront requis. On a proposé qu’il serait préférable de transformer le financement en paiement législatif, relevant de la catégorie des « autres paiements de transfert », surtout dans le cas de l’IADM, ce qui faciliterait les rajustements. En outre, comme les paiements peuvent varier d’une année sur l’autre, il est difficile de prévoir le montant exact requis. En effet, la décision d’annuler la dette est fonction de la capacité du pays de remplir les conditions fixées et d’obtenir l’approbation des membres des conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale. Selon certaines des personnes interviewées, puisqu’il s’agit d’un engagement international, il ne semble pas approprié que le gouvernement canadien soit contraint de retarder le financement pour de simples problèmes administratifs45.
Recommandation 5 : Le ministère des Finances devrait examiner la structure de financement de l’allégement de la dette multilatérale afin de trouver le mécanisme de financement le mieux adapté et le plus efficient qui fournirait aux gestionnaires de programmes la marge de manœuvre voulue pour donner suite en temps opportun à l’évolution des besoins, qui est principalement le fait de facteurs extérieurs.
8. Conclusions
Dans l’ensemble, tout semble indiquer que les initiatives d’allégement de la dette atteignent (du moins à court terme) leurs objectifs initiaux. Elles ont aidé les pays bénéficiaires à réduire nettement leur fardeau de la dette, surtout dans le cas des 26 pays qui ont franchi le point d’achèvement, comme le Cameroun. L’allégement de la dette est considéré comme la forme la plus simple et la plus pure d’aide. Toutes les autres solutions de rechange, comme les swaps de créances et autres mécanismes, sont généralement plus complexes et plus difficiles à instaurer par le pays débiteur. En outre, les éventuelles incidences des autres mécanismes ne sont pas toujours bien comprises.
De nombreuses possibilités d’améliorer les programmes d’allégement de la dette ont été signalées dans le présent rapport d’évaluation, dont l’assurance de l’existence d’un mécanisme d’examen du nombre et du genre de conditions imposées aux PPTE afin d’établir une saine gouvernance, l’examen de la structure de financement des paiements au titre de l’allégement de la dette multilatérale afin de trouver un système plus souple et l’amélioration de l’information transmise au public concernant les initiatives.
D’aucuns prétendent que l’allégement de la dette ne devrait pas être considéré comme une panacée pour le pays débiteur, mais plutôt comme un outil d’aide parmi tant d’autres qui peut servir à atténuer la pauvreté et à améliorer les conditions sociales dans le pays. La mise en œuvre efficace de l’allégement de la dette dans un contexte multilatéral ne peut s’effectuer qu’avec le maximum de coopération entre les pays créanciers et les pays débiteurs. Même si le niveau actuel de coopération entre les créanciers multilatéraux est très bon, des améliorations sont encore possibles. En outre, il faut faire participer certains des pays créanciers nouveaux et émergents, comme la Chine et l’Inde, ainsi que des créanciers privés pour prévenir les problèmes des « bénéficiaires sans contrepartie » et pour maximiser les avantages. L’efficacité de l’allégement de la dette est également tributaire en large part du genre de gouvernance que pratiquent les pays débiteurs. Si leur gouvernance est faible, il est davantage probable que l’allégement de la dette ne soit pas efficace. En revanche, si elle est solide, des résultats positifs seront obtenus.
Références
Addison, T., Mavrotas, G. et M. McGillivray. Aid, Debt Relief and New Sources of Finance for Meeting the Millennium Development Goals,Helsinki (Finlande), Institut mondial de recherche sur l’économie du développement de l’Université des Nations Unies, 2005.
Arslanalp, Serkan et Peter Blair Henry, « Is Debt Relief Efficient? » The Journal of Science, LX (2), 2005, p. 1017-1051.
Arslanalp, Serkan et Peter Blair Henry, « Debt Relief » (document de travail numéro 12187) », National Bureau of Economic Research, Cambridge (MA), 2006, (10 avril 2009).
Burnside, Craig et Domenica Fanizza. « Hiccups for HIPCs? Implications of Debt Relief for Fiscal Sustainability and Monetary Policy », Berkeley Electronic Journal of Macroeconomics, volume 5, numéro 1, 2005, (6 avril 2009).
Chauvin, Nicolas Depetris et Aart Kraay. « What Has 100 Billion Dollars Worth of Debt Relief Done for Low-Income Countries? » Banque mars 2009).
Dessy, Sylvain E. et Désiré Vencatachellum. « Debt Relief and Social Services Expenditure: The African Experience 1989–2003 », African Development Review, 2007, p. 200-216.
Djistrika, A. Geske. The Impact of International Debt Relief, Routledge, New York (NY) et Abingdon, Oxon, 2008.
Easterly, William, « How did Highly Indebted Poor Countries become Highly Indebted: Reviewing Two Decades of Debt Relief » (document avril 2009).
Easterly, William, « Debt Relief », Foreign Policy, novembre/décembre, 2001, p. 20-26.
Ministère des Finances du Canada, « Venir en aide aux pays les plus pauvres – Le point sur les efforts du Canada en matière d’allégement de la dette », Ministère des Finances du Canada, 2005, (6 mars 2009).
Ministère des Finances du Canada, « Le Canada annule la totalité de la dette d’Haïti », Ministère des Finances du Canada, 2 juillet 2009, (10 octobre 2009).
Gautam, Madhur, « Debt Relief for the Poorest: An OED Review of HIPC Initiative », 2003, Banque mondiale, 2003, (14 avril 2009).
Fonds monétaire international et Association internationale de développement (FMI), « Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) – Status of Implementation Report », FMI, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, (16 avril 2009).
Association internationale de développement, Mobilisation des ressources (GRF). « IDA’s Implementation of the Multilateral Debt Relief Initiative », Banque mondiale, 14 mars 2006, (18 mars 2009).
Association internationale de développement, Mobilisation des ressources (GRF),
« Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI): Second Update on Debt Relief Costs and Donor Financing as of September 30, 2007 », Banque mondiale.
Fonds monétaire international et Banque mondiale, « Review of Low-Income Country Debt Sustainability Framework and Implications of the MDRI », FMI, 24 mars 2009. (3 avril 2009).
Fonds monétaire international – Bureau indépendant d’évaluation (BIE), « IEO Evaluation of Structural Conditionality in IMF-Supported Programs2007 », BIE-FMI, 2007, (10 mars 2009).
Fonds monétaire international, « Allégement de la dette au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) – Fiche technique », 2008, FMI, septembre 2008,
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/hipcf.htm (10 mars 2009).
Fonds monétaire international et Banque mondiale, « Review of Low-Income Country Debt Sustainability Framework and Implications the MDRI », FMI, 24 mars 2006/17, (17 mars 2009).
Jubilee USA Network, « Deadly Delays: How FMI and World Bank Economic Conditions Undermine Debt Cancellation », Jubilee USA Network, 30 novembre 2005, (5 avril 2009).
Kapoor, Sonya. « Paying for 100% Multilateral Debt Cancellation », Réseau européen sur la dette et le développement, janvier 2005, www.eurodad.org (8 mars 2009).
Krugman, Paul et Maurice Obstfeld, International economics: theory and policy, Boston, Addison Wesley, 2003.
Martin, Matthew, « Allégement des dettes et réduction de la pauvreté : Avons-nous besoin d’une III PPTE? », Rapport sur l’Afrique : Une évaluation du Nouveau Partenariat, Institut Nord-Sud (mars 2002 / 77-92, (20 mars 2009).
Michael, Marie, « Food or Debt », Dollars and Sense: Real World Economics, numéro 230 (2000), p. 15-16, 39.
Moss, Todd, « Will Debt Relief Make a Difference? Impact and Expectations of the Multilateral Debt Relief Initiative », document de travail numéro 88, DC, Centre for Global Development Washington, 2006, (10 mars 2009)
Neumayer, Eric, « Is Good Governance Rewarded? A Cross-national Analysis of Debt Forgiveness », World Development, 30 (6), (2002), p. 913–930 (10 mars 2009).
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), « Results of International Debt Relief 1990-99 », IOB Evaluations NR 292, Département de l’évaluation des politiques et des opérations, OCDE, mai 2003, (10 avril 2009).
Club de Paris. « Rapport annuel du Club de Paris, 2007 », Club de Paris, 2007. (11 2009).
Rieffel, Lex, Restructuring Sovereign Debt. The Case for Ad Hoc Machinery, Washington (D.C.), Brooking Institutions Press, 2003.
Serieux, John E, « Reducing the Debt of the Poorest: Challenges and Opportunities », Institut Nord-Sud, novembre 2005. (11 mars 2009).
Thomas, M. A, « Getting Debt Relief Right », Foreign Affairs, 80 (5) (2001), p. 36-45.
États-Unis. General Accounting Office (GAO). Report to Congressional Committees: Developing Countries: Debt Relief Initiative for Poor Countries Faces Challenges, GAO/NSIAD-00-161 Debt Relief Initiative, 2000, www.gao.gov/new.items/ns00161.pdf.
Banque mondiale – Groupe d’évaluation indépendante (IEG), « Debt Relief for the Poorest: An Evaluation Update of the HIPC Initiative », Banque mondiale – IEG, 11 avril 2006, (2 avril 2009).
Banque mondiale. FAQ sur l’allégement de la dette, Banque mondiale, mars 2007, (March 4, 2009).
Banque mondiale, Département de la politique économique et de la dette « The Enhanced HIPC Initiative – Overview », Banque mondiale, 2006, (3 mars 2009).
Banque mondiale, Actualités / Médias : Allégement de la dette – Aperçu 2008, Banque mondiale, (3 mars 2009).
Banque mondiale. Debt Relief and Beyond, Carlos A. Prima Braga et Doerte Dümeland, rédacteurs, Washington, octobre 2009.
Annexe A : Contexte de l’allégement de la dette
En quoi consiste l’allégement de la dette? L’allégement de la dette désigne la remise totale ou partielle de la dette ou le ralentissement ou l’arrêt de la croissance de la dette que les pays en développement pauvres admissibles ont à l’égard des pays développés riches. Pour comprendre l’origine récente des initiatives d’allégement de la dette, il faut examiner le contexte politique, historique et international qui a exacerbé la dette contractée par les pays en développement de même que les efforts internationaux qui ont été déployés pour y donner suite.
Une partie de la dette extérieure trouve son origine, du moins pour certains pays en développement, à la période ayant précédé leur indépendance, lorsqu’ils étaient des colonies de pays européens. Toutefois, la plupart des universitaires s’entendent pour dire qu’une bonne part des niveaux actuels d’endettement ont été accumulés après la crise du pétrole de 1973. Les experts en économie du développement estiment que le degré d’accumulation de la dette extérieure de ces pays et les besoins financiers des pays débiteurs sont imbriqués avec les conditions financières des pays avancés (créanciers). Avant les années 1970, la dette extérieure des pays en développement était relativement petite. De 1970 à 2000, elle est passée de 68 milliards à plus de 2 billions de dollars46. Les politiques d’industrialisation par substitution aux importations en vigueur avant et pendant les années 1970 représentaient les démarches préconisées par d’éminents économistes, et les pays en développement empruntaient des pays occidentaux pour combler leurs besoins en développement. À cette époque, les modalités des prêts étaient bonnes et on s’attendait raisonnablement à un rendement élevé de l’investissement. De nombreux événements ont aggravé le problème de la dette. Une des personnes interviewées a résumé la situation en disant que les pays en développement ont été confrontés à une série de problèmes interreliés au cours des années 1970. Les ÉtatsUnis, un importateur clé de marchandises des pays en développement, étaient impliqués dans la guerre au Vietnam, mais tentaient d’isoler leur économie des retombées de cette guerre en augmentant la masse monétaire. À cette même époque, le prix du pétrole a monté en flèche, à tel point que les pays importateurs de pétrole, dont les pays d’Europe et le Japon, ont dû payer de cinq à six fois de plus pour le même baril de pétrole qu’auparavant. La plupart des fonds produits par suite de cette hausse des cours ont été dirigés vers quelques pays producteurs de pétrole qui ont principalement transformé leurs nouvelles liquidités en investissements financiers aux ÉtatsUnis. Ce fait, combiné à la liquidité excédentaire provenant de l’impression de billets de banque par le Trésor américain, a fait en sorte que les banques possédaient des liquidités et étaient disposées à prêter.
Entretemps, de nombreux pays en développement avaient réussi à instaurer des stratégies d’investissement et nombre d’entre eux avaient été en mesure d’augmenter leurs exportations. Grâce à la liquidité excédentaire, les acheteurs (les pays développés) étaient mieux en mesure d’importer ces produits, ce qui a encouragé les stratégies de croissance de ces pays en développement, malgré la hausse du coût de production attribuable à l’augmentation du prix du pétrole. Pour composer avec l’incidence de cette augmentation, nombre de pays en développement n’ont eu d’autre choix, pour acheter les articles essentiels et financer les programmes d’infrastructure et de développement économique, que de contracter de lourds emprunts dans l’espoir que le rendement obtenu des marchandises produites défraierait ces coûts supplémentaires. De plus, certains des pays ayant emprunté lourdement avaient à leur tête des dirigeants corrompus de sorte que, même si ces derniers ont profité de ces prêts, tel n’était pas vraiment le cas du pays en soi. Les banques et autres institutions financières ont commencé à prêter ouvertement à ces pays sans avoir au préalable examiné avec soin leur solvabilité (il existe un certain parallèle entre cette situation et l’approche adoptée par certaines des institutions financières et certains des événements qui ont précipité l’actuelle crise financière aux ÉtatsUnis et ailleurs dans le monde).
Comme il fallait s’y attendre, la liquidité excessive a débouché sur un taux élevé d’inflation. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, le taux préférentiel a été majoré pour contrôler l’inflation, ce qui s’est traduit par l’appréciation de la valeur du dollar américain. Des politiques monétaires serrées ont par la suite été mises en œuvre pour contrôler l’inflation et ont contraint les banques à adopter des politiques restrictives, comprenant la demande de remboursement de leurs prêts à des taux d’intérêt plus élevés. Les pays en développement devaient alors effectuer des paiements plus élevés et plus rapides pour rembourser leurs prêts. Même si la valeur du revenu provenant des exportations a progressé de pair avec la valeur supérieure du dollar américain, cette progression a été annulée par une baisse des termes de l’échange (la tendance à la baisse avait commencé à l’échelle mondiale pour les matières brutes et les marchandises fabriquées de base, soit les exportations des pays en développement parmi les plus pauvres). L’appréciation plus forte du dollar américain a fait augmenter dramatiquement le fardeau d’endettement.
Initiatives canadiennes d’allégement de la dette
1) Allégement de la dette bilatérale : Le Canada procure un tel allégement aux pays endettés dans le cadre des ententes sur le sujet qu’il a conclues avec le Club de Paris et des engagements qu’il a pris en vertu de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de l’Initiative canadienne d’allégement de la dette (ICAD). Le ministère des Finances met en œuvre l’allégement de la dette bilatérale requis en application de ces initiatives internationales en réduisant les paiements prévus des pays débiteurs aux organismes créanciers officiels, comme la Commission canadienne du blé (CCB) et Exportation et développement Canada (EDC). Le gouvernement est tenu par la loi d’indemniser la CCB des pertes sur des prêts souverains; les indemnisations qu’il verse à EDC ont été prévues dans une décision que le Cabinet a prise en 2001.
2) Allégement de la dette multilatérale : Cet allégement (c.àd., la remise de la dette des pays pauvres envers les institutions financières internationales) vise un objectif semblable à celui de l’allégement de la dette bilatérale. Aux termes de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM) qui vient d’être adoptée, le Canada s’est engagé à verser des paiements au FMI, à la Banque mondiale et au Fonds africain de développement au cours des 45 prochaines années pour les indemniser de l’annulation de la dette à leur égard des pays pauvres très endettés.
Annexe B : Description des rôles et responsabilités des partenaires de l’allégement de la dette
Ministère des Finances du Canada
Le ministre des Finances est chargé de l’allégement de la dette bilatérale et multilatérale. À cette fin, le ministère des Finances coordonne les efforts du Canada en matière d’allégement de la dette, ce qui comprend la prestation de conseils stratégiques et la mise en œuvre de politiques. Le ministère consulte de près ses partenaires, dont l’Agence canadienne de développement international et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Le ministre des Finances représente également le Canada au Conseil des gouverneurs du FMI et de la Banque mondiale47.
Au ministère des Finances du Canada, c’est à la Direction des finances et des échanges internationaux qu’il incombe de coordonner et d’administrer les engagements internationaux du Canada. La Division des finances internationales et de la politique de développement gère les relations du Canada avec le FMI, la Banque mondiale et le Club de Paris, fournit des commentaires sur les questions de politiques générales ainsi que sur les programmes d’aide financière que ces organisations offrent aux pays particuliers. Elle coordonne en outre les intérêts du ministère dans les volets financiers des exportations, ce qui comprend la surveillance des activités de financement de la société d’État fédérale, Exportation et développement Canada, et de la Commission canadienne du blé. La Division dirige la participation du Canada au Club de Paris et entretient des rapports avec des banques commerciales concernant la dette des pays en développement.
Exportation et développement Canada (EDC) et la Commission canadienne du blé (CCB)
Exportation et développement Canada et la Commission canadienne du blé sont des organismes qui consentent au besoin des prêts canadiens à divers pays. EDC est une société d’État et, par conséquent, fait partie des comptes publics consolidés. Les indemnisations d’EDC ne sont pas prévues par la loi. En revanche, une loi porte l’obligation légale d’indemniser la CCB; ainsi, si elle subit des pertes sur des prêts extérieurs, le ministre des Finances est tenu de lui verser une indemnisation. La CCB fournit du crédit et des prêts principalement à des États souverains qui veulent importer du blé canadien. EDC en fait de même avec les États souverains et les sociétés étrangères qui veulent financer l’achat d’exportations canadiennes. En leur qualité de participants aux initiatives canadiennes d’allégement de la dette, EDC et la CCB ont convenu de radier tous les prêts consentis avant 2001 aux pays admissibles à l’allégement de la dette En échange, le gouvernement du Canada indemnise la CCB et EDC de ces prêts et des autres pertes qu’elles auraient subies. Il convient de signaler que, dans le cas des nouveaux prêts, la CCB et EDC doivent au préalable obtenir l’approbation du ministère des Finances pour veiller à ce qu’ils soient garantis. Habituellement, dès que les pays ont obtenu l’allégement de leur dette, ils deviennent solvables et peuvent demander d’euxmêmes des emprunts à EDC et à la CCB. En pareil cas, toutefois, les emprunts ne sont pas garantis par le gouvernement. On s’attend à ce qu’EDC et la CCB participent de moins en moins aux initiatives de la dette à mesure que les prêts en cours seront remboursés.
Agence canadienne du développement international (ACDI)
La participation de l’ACDI à l’allégement de la dette prend deux formes. D’abord, elle gère les prétendus anciens prêts au titre de l’aide au développement officielle au nom du gouvernement du Canada. L’ACDI a consenti des prêts au titre des dettes contractées par les pays débiteurs pauvres jusqu’en 1986. Ensuite, l’ACDI participe à divers projets liés à l’allégement de la dette, dont un projet assez pertinent qui vise à renforcer la capacité de gestion de la dette. Dans le cadre de ce projet, l’ACDI travaille de concert avec des ONG, dont Debt Relief International (DRI), un ONG du RoyaumeUni composé de quatre organisations régionales qui aide les pays débiteurs à mieux comprendre la gestion de la dette et à renforcer leur capacité à cet égard. DRI travaille avec au moins 33 PPTE pour les aider à mieux comprendre l’Initiative en faveur des PPTE et d’autres options d’allégement de la dette qui leur sont offertes. Cet ONG aide également ces pays à élaborer des stratégies, des cadres de gestion de la dette et d’autres outils de même qu’à acquérir la capacité institutionnelle d’établissement de budgets et de projections financières; il a lancé cette initiative en 1997. L’ACDI (Canada) y participe depuis 2002.
L’ACDI assiste aux rencontres du Club de Paris et du FMI à titre d’observateur et veille à ce que de l’information de base soit fournie à ces institutions et intégrée à leurs politiques et autres décisions en matière d’allégement de la dette.
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI)
Le rôle du MAECI est essentiellement de fournir de l’information et des conseils sur la politique étrangère du Canada, ce qui comprend l’état des relations diplomatiques du Canada avec les pays dont il est question au Club de Paris et dans d’autres tribunes ou les intérêts commerciaux du Canada dans ces pays. Les représentants du MAECI qui travaillent dans les ambassades des pays à l’étude fournissent aussi de l’information « sur le terrain » concernant les progrès réalisés par le pays, information qui permet de vérifier les évaluations générales fournies par le FMI et la Banque mondiale et qui facilite la prise de décisions.
Organismes non gouvernementaux (ONG)
Les organismes non gouvernementaux jouent un rôle important en matière d’allégement de la dette. Certains d’entre eux travaillent en étroite collaboration avec les organismes canadiens pour la fourniture de l’allégement en soi et d’autres formes d’aide en sensibilisant les gens et en influant sur l’élaboration des politiques. Habituellement, les ONG font connaître leurs préoccupations par l’entremise de l’ACDI ou d’autres mécanismes formels et informels, comme les sommets du G7 et du G8. Le ministère des Finances du Canada tenait jadis une consultation bisannuelle dans le cadre de laquelle le ministre des Finances et plusieurs ONG échangeaient de l’information et discutaient de dossiers liés à l’allégement de la dette. En 2009, le ministère a amorcé un processus de consultations sur le Web qui vise à mettre sur pied une tribune en ligne où les ONG intéressés et le grand public peuvent exprimer leurs avis concernant la prestation, par le Canada, de l’aide étrangère en général et de l’allégement de la dette en particulier. Cette tribune prévoit également un sondage en ligne qui sera mené annuellement afin d’obtenir de la rétroaction.
Annexe C : Définitions de termes et expressions communs
Subventions et contributions (Grants & Contributions) : Aussi appelées « crédit 5 », elles sont utilisées lorsque les dépenses correspondent au moins à 5 millions de dollars. Il convient de signaler que l’inclusion d’un poste au titre d’une subvention, d’une contribution ou d’un autre paiement de transfert dans le Budget des dépenses n’impose aucune exigence de verser le paiement ni ne donne au bénéficiaire prospectif un droit aux fonds.
Contribution : Transfert conditionnel à un particulier ou à un organisme à une fin précise qui peut faire l’objet d’un compte rendu ou d’une vérification conformément à l’entente à son sujet. Le particulier ou l’organisme qui utilise le transfert aux fins établies dans l’entente n’a pas à fournir directement des biens ou des services en contrepartie, à rembourser la contribution ou à présenter un compte rendu au gouvernement.
Subvention (Grant) : Paiement de transfert effectué en fonction de critères préétablis d’éligibilité et d’admissibilité. Une subvention n’est ni assujettie à une reddition ni sujette à vérification par le ministère. Il se peut que le bénéficiaire doive fournir des rapports sur les résultats obtenus.
Surendettement (Debt Overhang) : Situation dans le cadre de laquelle les créanciers prévoient que la dette ne sera pas remboursée intégralement. Les montants de remboursement seront moins élevés que la valeur nominale actualisée de la dette. Cet encours de la dette étrangère impayée pourrait constituer un obstacle économique de taille même lorsque le débiteur ne le rembourse pas. Selon la théorie, l’encours de la dette doit être ramené à des niveaux viables avant que la croissance et le développement ne puissent reprendre.
Fonds de vautours (Vulture Fund) : Organisation financière privée se spécialisant dans l’achat de titres de créances dans un environnement économique en difficulté. Ces titres peuvent être des créances à fort rendement que les débiteurs ont du mal à rembourser. Le fonds de vautours vise à réaliser des bénéfices en achetant à faible coût les dettes de pays très endettés du Tiers Monde qui éprouvent de la difficulté à rembourser. Ces organisations sont une métaphore pour les vautours qui survolent un débiteur qui faiblit rapidement et attendent patiemment d’en ramasser les restes. Plus tard, elles entameront des poursuites pour exiger du débiteur qu’il leur rembourse sa dette à des taux d’intérêt très élevés. À l’heure actuelle, au moins 40 poursuites ont été intentées par des fonds de vautours contre des pays pauvres.
Bénéficiaire sans contrepartie (Free Rider Problem) : Situation dans le cadre de laquelle un pays créancier veut tirer avantage de l’allégement de la dette qu’un autre pays créancier a offert à un pays débiteur en augmentant l’encours de la dette du débiteur en relevant son taux d’intérêt ou en lui consentant davantage de prêts. Cela pourrait procurer des avantages à quelques pays créanciers aux dépens des autres, et le pays pauvre ne serait pas mieux nanti, voire sa situation pourrait être pire, ce qui anéantirait le but initial de l’allégement de la dette. Par exemple, les membres du Club de Paris respectent les lignes directrices fournies par le FMI lorsqu’ils octroient des subventions et des prêts à des conditions de faveur aux PPTE, tandis que les pays qui n’en sont pas membres ne sont pas tenus de les respecter et pourraient, de nouveau, consentir des prêts insoutenables aux PPTE.
Genres de dettes contractées (Types of Debt Incurred) : La liste qui suit contient les différents genres de dettes que les pays peuvent habituellement contracter48 :
1. L’aide au développement officielle, ou aide officielle, peut prendre la forme d’une subvention ou d’un prêt comportant un volet de subvention d’au moins 25 % pour la promotion du développement économique ou les besoins humanitaires de base. Le volet du prêt est offert à faible taux d’intérêt et pour une longue période de remboursement.
2. Les autres prêts à des conditions de faveur sont offerts à des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché.
3. Les prêts consentis par d’autres institutions financières multilatérales (sans condition de faveur).
4. Les crédits à l’exportation sont des prêts à des fins d’échanges commerciaux qu’un gouvernement ou le secteur privé peut consentir. S’ils sont consentis par le secteur privé, ils peuvent jouir de la garantie du gouvernement. Par exemple, Exportation et développement Canada finance les exportations de biens manufacturés canadiens grâce à des crédits d’acheteurs, aux finances de projets, à des crédits de fournisseurs et à des crédits aux petites entreprises.
5. Les prêts commerciaux sont consentis par le secteur privé (p. ex., des banques) aux taux du marché.
6. Le crédit à court terme désigne des capitaux de financement commercial dont l’échéance ne dépasse pas un an.
Différence entre la dette multilatérale et la dette bilatérale (Difference Between Multilateral Debt and Bilateral Debt) : Le service de la dette multilatérale s’effectue presque toujours puisque les institutions financières internationales ont le statut de « créancier privilégié ». Le pays qui manque à ses obligations concernant la dette multilatérale se verra vraisemblablement refuser toute autre forme de crédit international de source officielle ou privée. Pour sa part, la dette due aux créanciers bilatéraux et aux créanciers du secteur privé n’est pas aussi critique, ce qui explique qu’elle accuse souvent d’importants arrérages. L’annulation de la dette bilatérale et de la dette envers le secteur privé peut donc représenter une simple opération sur papier qui suppose l’annulation d’une dette qui, de toute façon, n’est pas remboursée. Une telle opération, bien qu’elle réussisse à réduire le surendettement global, pourrait de fait ne pas libérer de ressources en vue d’investissements dans les mesures de réduction de la pauvreté et l’infrastructure d’un pays.
La plupart des réductions de l’encours de la dette des PPTE jusqu’à présent ont pris la forme d’une radiation de la dette déjà en souffrance. L’annulation de la dette multilatérale en revanche signifie presque toujours que les sommes qui auraient par ailleurs servi au service de la dette sont libérées et consacrées plutôt au développement. Elle réduit en même temps le surendettement. Les travaux de recherche ont montré qu’il s’agit également de la forme la plus efficiente de fourniture de ressources aux pays dans le besoin49.
Risque moral (Moral Hazard) : Risque qu’une partie à une transaction n’agisse pas de bonne foi. Par exemple, la partie peut avoir fourni des renseignements trompeurs concernant ses actifs, ses passifs ou sa capacité de crédit ou peut être encouragée à prendre des risques inhabituels dans une tentative désespérée de gagner des bénéfices avant que le contrat ne soit réglé. Le risque moral peut exister lorsque deux parties arrivent à une entente. Chaque partie à un contrat peut avoir la possibilité d’obtenir des gains en agissant d’une manière contraire aux principes énoncés dans l’entente. Le risque moral peut être quelque peu réduit lorsque des responsabilités sont conférées aux deux parties au contrat50.
Dans la littérature, le risque moral est utilisé pour désigner une situation où des pays débiteurs reçoivent de l’allégement de la dette qui leur accorde un certain répit financier mais qui leur procure également la possibilité d’emprunter davantage de manière irresponsable, ce qui de nouveau augmente leurs emprunts qu’ils ne peuvent rembourser. Les pays débiteurs pourraient avoir ce comportement parce qu’ils estiment qu’ils auront de nouveau accès à l’allégement de la dette s’ils en ont besoin à l’avenir.
Poursuites contre les PPTE (Litigation Against HIPC) : Les poursuites que les créanciers commerciaux intentent contre les PPTE représentent un défi croissant pour la mise en œuvre de l’Initiative en faveur des PPTE. Pour corriger la situation, la communauté internationale a intensifié ses efforts de dissuasion des poursuites contre les PPTE, et la Banque mondiale et le FMI ont poursuivi leurs efforts intensifs pour encourager la participation globale et équitable de tous les créanciers à l’Initiative en faveur des PPTE.51
Dette odieuse (Odious debt) : Dette contractée par un pays qui sert les intérêts du dirigeant ou du régime en place (qui n’est habituellement pas démocratique) plutôt que le pays dans son ensemble et la population. Advenant le renversement ou le remplacement du dirigeant ou du régime qui a contracté la dette, la question qui se pose immédiatement est de savoir si le pays devrait être tenu responsable de la dette à l’égard de laquelle il n’a obtenu aucun avantage. De plus, les ONG et les universitaires soulèvent la question de savoir si les créanciers devraient assumer une part des responsabilités en matière de présélection et de refus initial de tels prêts.
Annexe D : Organigramme de la Banque mondiale, du FMI, du ministère des Finances du Canada et de l’ACDI
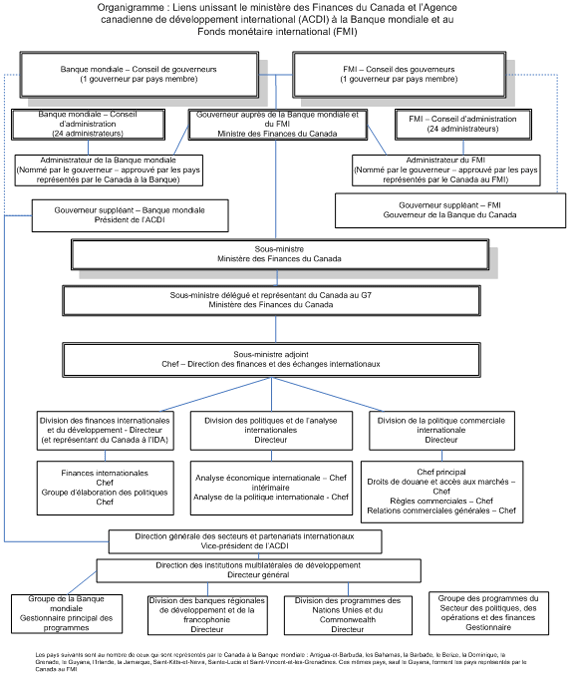
Annexe E : Évaluation des initiatives canadiennes d’allégement de la dette internationale
| Recommandation | Réponse de la direction | Mesure prévue | Responsable | Date cible |
|---|---|---|---|---|
| 1 – Le ministère des Finances devrait envisager de discuter de ces modalités avec EDC afin de réévaluer la question de savoir s’il y a lieu d’accorder des fonds à EDC en contrepartie des pertes imputables aux mesures d’allégement de la dette. | Nous acceptons cette recommandation. Il y a déjà eu des discussions concernant l’à‑propos de fournir des fonds à EDC pour contrebalancer les pertes imputables à la participation du Canada à des initiatives d’allégement de la dette, par suite de l’approbation donnée par le Cabinet en juin 2001. Ces discussions ont confirmé le fait que l’entente en vigueur demeure appropriée. Aux termes de cette entente, EDC assume de plus grandes responsabilités au titre des risques liés aux prêts que cet organisme accorde à même son compte courant à des pays très endettés; EDC n’obtient aucune compensation au titre des conventions multilatérales d’allégement de la dette dans le cas des prêts accordés après mars 2001. | Des fonds continueront d’être fournis à EDC en contrepartie des pertes attribuables à la participation du Canada à des initiatives d’allégement de la dette dans le cas de prêts accordés avant mars 2001. | Division des finances internationales et de la politique de développement (DFIPD) | Tâche achevée (le 22 février, 2010) |
| 2 – Le ministère des Finances devrait souligner l’importance qu’il y a à intégrer les plans économiques et les plans de développement des États débiteurs aux conditions économiques et financières prévues dans le cadre des ententes d’aide aux PPTE. | Nous acceptons cette recommandation. Il aurait toutefois été possible de mentionner à la suite de l’évaluation que le ministère des Finances appuie déjà l’inclusion des plans économiques et des plans de développement des pays débiteurs dans les ententes d’aide aux PPTE, puisqu’il soutient l’approche qui sous‑tend la stratégie de réduction de la pauvreté du FMI et de la Banque mondiale. Cette approche incite les pays débiteurs à élaborer des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté; à cette fin, on a recours à un processus comportant la participation des parties prenantes au sein des pays concernés. | Le ministère des Finances continuera de déployer des efforts à l’appui de l’amélioration de l’approche qui sous‑tend la stratégie de réduction de la pauvreté du FMI et de la Banque mondiale, par l’entremise de nos administrateurs au sein de ces institutions. | Division des finances internationales et de la politique de développement (DFIPD) | En cours* *Commentaire: Il convient de mentionner que l'une des conditions préalables à l'octroi d'une aide dans le cadre de l'Initiative en faveur des PPTE consiste pour les pays débiteurs à définir des priorités dans leur cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, puis à se consacrer à ces priorités. |
| 3 – Le ministère des Finance devrait améliorer le processus de communication d’information sur les initiatives d’allégement de la dette, de sorte que l’information communiquée aux Canadiennes et aux Canadiens soit à jour et décrive avec précision le rôle du Canada, son apport aux mesures d’allégement de la dette bilatérale et multilatérale et les résultats des initiatives d’allégement de la dette. | Nous acceptons cette recommandation.
Il aurait cependant pu être mentionné au terme de l’évaluation
que le ministère des Finances communique des renseignements
sur l’apport du Canada aux initiatives d’allégement
de la dette bilatérale et multilatérale dans les documents
suivants :
|
Le ministère des Finances mettra à jour la section de son site Web portant sur les mesures d’allégement de la dette, de manière à fournir une description plus actuelle de l’apport du Canada aux initiatives d’allégement de la dette bilatérale et multilatérale. Nous allons aussi continuer de fournir des mises à jour annuelles sur l’apport du Canada à partir des instruments de communication existants. | Division des finances internationales et de la politique de développement (DFIPD) | D’ici le troisième trimestre de 2010‑2011 (décembre 2010) |
| 4 – Le ministère des Finances devrait veiller à ce qu’il existe un mécanisme servant à réévaluer périodiquement le processus d’aide aux PPTE en ce qui touche la définition et le réexamen régulier des conditions applicables, de manière à s’assurer que ces conditions soient réalistes et se traduisent par un apport essentiel à la croissance et au développement des pays bénéficiaires. | Nous acceptons cette recommandation. Il aurait cependant été possible de souligner à la suite de l’évaluation qu’il existe déjà des mécanismes servant à examiner le choix et la pertinence des conditions fixées par les institutions financières internationales. Tant le FMI que la Banque mondiale procèdent périodiquement à des examens des conditions rattachées à leurs activités. Ce n’est pas le ministère des Finances qui établit les conditions associées aux activités des différentes institutions financières internationales dans des pays donnés. Par contre, Finances Canada veille, par l’entremise de nos administrateurs au sein de ces institutions, que les cadres de conditionnalité de ces dernières fassent l’objet d’un examen. | Par l’intermédiaire des administrateurs représentant le Canada au FMI et à la Banque mondiale, le ministère des Finances continuera de participer aux examens périodiques des cadres de conditionnalité de ces institutions. | Division des finances internationales et de la politique de développement (DFIPD) Division des politiques et de l’analyse internationales (DPAI) | En cours |
| 5 – Le ministère des Finances devrait examiner la structure de financement rattachée aux initiatives d’allégement de la dette multilatérale afin de déterminer les mécanismes de financement les plus adéquats et les plus efficients en vue de conférer aux gestionnaires de programmes la marge de manœuvre nécessaire pour intervenir rapidement lorsque les besoins évoluent, cette évolution tenant le plus souvent à des facteurs extérieurs. | Nous acceptons cette recommandation. Le ministère des Finances a déjà modifié le mécanisme de versement des contributions à l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM) afin d’accorder une telle marge de manœuvre. Plus précisément, les paiements du Canada au titre de l’IADM sont désormais prévus dans la loi au lieu de constituer un poste imputé au crédit 5 du Ministère (Subventions et contributions) dans le Budget principal des dépenses. Ce changement a été apporté au moyen du paragraphe 18(1) de la Loi sur la reprise économique (qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2009). | Aucune autre mesure n’est requise. | Division des finances internationales et de la politique de développement (DFIPD) | Tâche achevée (le 15 décembre 2009) |
1 Veuillez noter
qu’une évaluation de la participation du Canada à l’approche
d’Evian ne s’inscrivait pas dans la portée de cette évaluation
puisque cette initiative vient tout juste d’être instaurée
et que peu de renseignements existent sur son rendement. Annoncée
lors du sommet du G8 de 2003 et mise en œuvre par l’entremise
du Club de Paris, l’approche d’Evian vise à fournir
aux pays endettés, qui ne sont pas classés à titre
de pays pauvres très endettés, un régime qui leur
permet d’atteindre un endettement tolérable. Il convient de
signaler que l’approche d’Evian peut englober le rééchelonnement
de la dette, l’allégement de la dette, ou les deux. 5 octobre 2009,
(http://www.g8.fr/evian/francais/navigation/le_sommet_2003/documents_du_sommet/
conclusions_de_la_presidence.html).
2 Par suite de l’adoption de la Loi fédérale sur la responsabilité, le SCT a instauré de nouvelles politiques sur l’évaluation et sur les paiements de transfert en vertu desquelles les ministères sont tenus d’évaluer au moins aux cinq ans l’ensemble de leurs dépenses de programmes directes, de leurs subventions et contributions et de leurs paiements de transfert.
3 Le niveau d’endettement d’un pays est réputé intenable si les ratios de la dette aux exportations dépassent un ratio fixe de 150 %. Dans le cas des pays dont l’économie est très ouverte et pour lesquels le seul recours aux indicateurs externes ne permet pas de tenir dûment compte du fardeau financier de la dette extérieure, le niveau d’endettement est considéré intenable si le ratio de la dette aux revenus gouvernementaux dépasse 250 %.
4 FMI, 2008.
5 et 8 ministère des Ministère des Finances, Canada, 2009.
6 Établis en 2001, les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) désignent huit objectifs de développement international que 192 pays membres des Nations Unies et au moins 23 organismes internationaux ont convenu d’atteindre d’ici 2015. Il s’agit notamment de la réduction de la pauvreté extrême, de la réduction des taux de mortalité infantile, de la lutte contre les épidémies de maladies comme le SIDA et de la mise sur pied d’un partenariat mondial du développement.
7 Ministère des Finances, Canada, 2009.
8 Ministère des Finances, Canada, 2005.
9 FMI, Rapport sur l’état de mise en œuvre, 2009.
10 Le Club de Londres est un groupe de banques commerciales qui s’unissent pour élaborer des stratégies de gestion de leurs créances dans le Tiers Monde. Il n’existe aucun cadre officiel de restructuration des prêts de banques commerciales ni aucun groupe formel comptant des membres fixes.
11 Veuillez vous reporter à la définition des termes subvention et contribution qui est donnée à l’annexe C.
12 Vous constaterez que les données des tableaux 2 et 3 sont fournies à titre d’information générale seulement. Ces tableaux contiennent des données sur les chiffres réels (non encore publiés) de l’allégement de la dette qui a déjà été fourni aux pays débiteurs; elles ont été obtenues directement de la Division des finances internationales et du développement du ministère des Finances du Canada.
13 Ce point a été soulevé à plusieurs reprises par divers informateurs clés canadiens et étrangers lors des entrevues.
14 Bureau indépendant d’évaluation, FMI.
15 La tenue d’évaluations approfondies de première main des initiatives internationales d’allégement de la dette suppose de vastes ressources. En intégrant ces renseignements à l’étude d’évaluation, nous avons tenté de réduire le double emploi et de tirer parti des efforts qui ont déjà été déployés par les institutions internationales visées.
16 Si nous avions disposé de plus de temps et de passablement plus de ressources, nous aurions pu tenir compte des éventuelles incidences communes à l’échelle des différents pays, puis de vérifier leurs progrès. Par exemple, une comparaison de deux pays semblables sur une même période de temps devrait supprimer nombre des incidences exercées par le cycle économique. En comparant des pays disposant d’une structure de gouvernance et sociale semblable, on peut se faire une idée plus éclairée de l’éventuel caractère bénéfique des initiatives, ce qui, toutefois, ne prouverait pas le lien de cause à effet.
17 Banque mondiale, 2006.
18 INVESTOPEDIA (en anglais seulement).
19 Dans 61 pays, le revenu national brut (RNB) est inférieur à 765 $. Voir la liste complète de ces pays à l’adresse : http://www.worldbank.org/data/countryclass/classgroups.htm#Low_income.
20 Réseau européen sur la dette et le développement, 2005.
21 Banque mondiale, 2006.
22 Banque mondiale, 2003. Les pourcentages sont ceux de 2000.
23 FMI, 2009.
24 Ibidem.
25 Renseignements extraits de documents d’EDC qui ont vérifiés par le ministère des Finances du Canada.
26 La Facilité de réduction de la dette (FRD) a été lancée par les conseils d’administration de la BIRD et de l’IDA en juillet 1989. Elle a aidé 18 PPTE à réduire leur dette commerciale.
27 Banque mondiale, 2006.
28 Les éléments probants de la mesure de l’effet de l’allégement financier réel sur les PPTE participants (à moyen terme) sont extraits de la recension d’ouvrages de tierces parties, de rapports d’évaluation externes, des rapports d’étape sur la mise en œuvre ainsi que des impressions générales sur l’incidence qui se sont dégagées des entrevues auprès des principaux informateurs.
29 Banque mondiale, 2009.
30 Rapport annuel du Club de Paris, 2007.
31 Banque mondiale, 2006.
32 Si un pays créancier fournit de l’allégement de la dette à un pays débiteur, un autre pays créancier peut tirer parti de ce fait et augmenter l’endettement du pays débiteur en haussant son taux d’intérêt ou en consentant plus de prêts. Cela pourrait procurer des avantages à quelques pays créanciers aux dépens des autres, et le pays pauvre ne serait pas mieux nanti, voire sa situation pourrait être pire, ce qui anéantirait le but initial de l’allégement de la dette.
33 http://www.fin.gc.ca/n08/09-068-fra.asp.
34 FMI, 2008.
35 FMI 2006, p. 17.
36 Burnside et Fanizza, 2005.
37 Les ressources consenties à des conditions favorables englobent les subventions, les prêts à taux d’intérêt relativement faible ou les prêts dont l’échéance est prolongée pour garder les frais du service de la dette à un niveau inférieur. Habituellement, ces ressources sont offertes par des créditeurs souverains plutôt que par des institutions privées.
38 Un récent rapport d’évaluation préparé par l’équipe d’évaluation indépendante du FMI a montré que, souvent, de nombreuses conditions du FMI ne sont pas directement reliées à la croissance. FMI, 2007.
39 En voici quelques exemples : Thomas, 2001 et Easterly, 2001.
40 Certains gouvernements de PPTE débiteurs achètent des articles de luxe alors que les citoyens demeurent pauvres mais, habituellement, l’allégement intégral de la dette leur a été refusé. C’est le cas dernièrement d’un pays d’Afrique qui a respecté toutes les règles et dont le dirigeant a acheté un avion à réaction pour faciliter ses déplacements, tandis que le pays demeurait pauvre.
41 Dijkstra, 2008.
42 FMI, 2007.
43 L’annexe C contient une définition des termes subvention et contribution.
44 L’enveloppe de l’aide internationale comprend les affectations budgétaires du gouvernement fédéral aux programmes d’aide internationaux ainsi que les crédits à l’ACDI, à Affaires étrangères Canada, au ministère des Finances et à d’autres ministères.
45 Ce point vient d’être réglé par la haute direction.
46 Krugman et Obstfeld, 2003, International economics: theory and policy.
47 Pour un complément d’information concernant les contributions et les activités du Canada au FMI et à la Banque mondiale, veuillez consulter le rapport intitulé « Le Canada au FMI et à la Banque mondiale de 2007 : Rapport sur les opérations effectuées en vertu de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes », mars 2008 (10 juin 2009).
48 Rapport à la commission du Congrès, juin 2000, Debt Relief for poor Countries faces Challenges.
49 Réseau européen sur la dette et le développement, janvier 2005.
50 http://www.investopedia.com/terms/m/moralhazard.asp.
51 Rapport d’étape sur la mise en œuvre, 2007, FMI.
