2.2 Résultats porteurs : stratégies visant des résultats de développement durable
Par résultats porteurs, on entend le choix optimal de partenaires, de
priorités, de types de programme et de méthodes de collaboration. Il s'agit des stratégies qui aident l'ACDI à créer un programme de coopération au développement efficace et axé sur les résultats. Elles sont fondées sur
l'Énoncé de politique en faveur d'une aide internationale plus efficace
publié en 2002 par l'ACDI dont les principes sont la prise en charge locale, l'amélioration de la coordination
entre les donateurs, le renforcement des partenariats, la cohérence améliorée des politiques d'aide et de non-aide ainsi que l'adoption d'une approche axée sur les résultats. Ces principes sous-tendent de plus en plus la coopération au développement à l'échelle internationale.
Dans le RPP de 2004-2005, l'ACDI signalait qu'elle ciblerait huit stratégies porteuses au cours des trois prochaines années.
-
Nouvelles
approches-programmes et modalités de financement;
-
Réalisation des programmes axés sur les politiques et plus grande cohérence entre les politiques de l'ACDI et celles de ses partenaires canadiens;
-
Facilitation de la prise en charge locale;
-
Partenariats consensuels et menés en collaboration entre l'ACDI, d'autres donateurs, des pays bénéficiaires et des partenaires;
-
Convergence sectorielle et thématique
pertinente;
-
Convergence géographique pertinente;
-
Participation active des Canadiens;
-
Renforcement institutionnel des partenaires de l'ACDI.
L'Agence est également déterminée à atteindre un équilibre convenable entre les programmes directifs et réactifs
30
.
30
Les huit résultats porteurs précisés ci-dessus figuraient
dans le texte de base du RPP de 2004-2005. En revanche, la priorité accordée à l'atteinte d'un équilibre convenable entre les programmes directifs et réactifs figurait dans une annexe.
2.2.1 Orientation appropriée de la programmation
Nouvelles approches-programmes et modalités de financement
Dans son RPP de 2004-2005, l'ACDI a indiqué qu'au
cours des trois prochaines années elle :
-
Mettrait en œuvre de nouvelles approches-programmes, dans la mesure du possible;
-
Encouragerait les institutions multilatérales, notamment les banques de développement à utiliser davantage ces approches;
-
Continuerait de partager la recherche et les leçons tirées dans ce domaine.
À l'instar d'autres donateurs, l'ACDI a continué en 2004-2005 de
progresser dans la mise en application des approches-programmes. Ce type d'approche complète les investissements classiques de l'ACDI dans les projets autonomes avec un soutien pour les programmes plus globaux mis au point par des pays partenaires et bénéficiant de l'appui de plusieurs donateurs travaillant en coopération dans des pays choisis. Les approches-programmes permettent à l'ACDI de mieux financer les programmes et les priorités énoncés par les pays
partenaires dans leurs plans de développement national ou leurs stratégies de réduction de la pauvreté. Le recours accru aux approches-programmes est l'un des principaux éléments de la stratégie de l'aide efficace de l'ACDI.
En 2004-2005, l'ACDI a continué à travailler avec ses homologues en Afrique, en Asie et dans les Amériques afin de découvrir les mécanismes les plus efficaces de collaboration faisant appel aux
approches-programmes. À l'heure actuelle, l'Agence offre un soutien à plus de cinquante investissements reposant sur des approches-programmes, principalement en Afrique. En mars 2005, les partenaires du développement, les donateurs et les pays en développement du monde entier, y compris l'ACDI, ont adopté la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide qui promet d'augmenter l'utilisation des approches-programmes.
Pendant l'année faisant l'objet
de l'examen, l'ACDI a mis au point ou a commencé à mettre en œuvre plusieurs nouvelles initiatives. Il s'agissait entre autres de contributions aux approches sectorielles dans le domaine de la santé et de l'éducation au Mali, de contributions à l'éducation au Honduras, au Kenya et en Zambie, ainsi que d'une contribution à un fonds mis en commun de lutte contre le VIH/sida, et enfin d'aide budgétaire pour la réduction de la pauvreté
en Éthiopie et au Mozambique. En Tanzanie, le gouvernement a instauré un programme de collaboration regroupant le gouvernement et les donateurs visant à mettre au point une stratégie d'aide conjointe qui servira de cadre à tous les donateurs à l'appui de la coordination et de l'harmonisation de l'aide à la stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté. L'ACDI a l'intention de mettre à niveau ses programmes en
Tanzanie en se fondant sur la nouvelle stratégie
(voir
l'encadré 18
)
.
|
Encadré 14 : Notions élémentaires sur les nouvelles approches-programmes
|
Les approches-programmes constituent une façon différente pour l'ACDI de s'impliquer avec ses partenaires, comparativement avec les
approches projets plus traditionnelles. Une approche programme place une plus grande importance sur les quatre éléments clés qui suivent :
-
leadership du pays ou de l'organisation d'accueil;
-
cadre de programme et budgétaire unique pour l'ensemble des partenaires, y compris les donateurs;
-
coordination des donateurs et harmonisation des procédures;
-
efforts visant à augmenter au fil du temps le recours aux procédures
locales en ce qui a trait à la conception, à la mise en œuvre, à la gestion financière, au suivi et à l'évaluation de programme.
Une approche-programme est une façon de participer au développement sur la base des principes de la coordination de l'aide
31
pour un programme de développement pris en charge au niveau local. Lorsque les conditions le justifient, cette approche non seulement favorise l'apport d'une
aide plus efficace mais contribue aussi à renforcer les capacités locales, ce qui est un important facteur contributif du développement durable. De plus en plus, les approches-programmes sont financées par la mise en commun de fonds telle que le financement commun (c.-à-d. les donateurs rassemblent leurs fonds respectifs dans un fonds commun) et le soutien budgétaire direct (c.-à-d. les fonds sont transférés directement à un gouvernement
afin qu'ils soient investis dans le cadre de leur propre système de programmation); ce mode de financement requiert un partenariat en matière de gestion. L'ACDI participe également à des approches sectorielles dans lesquelles le soutien est axé sur des programmes d'ensemble pris en charge par le pays et qui couvrent un secteur entier.
|
31
Définis dans Harmoniser l'aide pour renforcer son
efficacité, Lignes directrices et ouvrages de référence du CAD, encadré 1.1, © OCDE, 2003,
www.oced.org/dac/effectiveness
.
Outre la collaboration avec les pays partenaires et les autres donateurs, l'ACDI a continué à prôner une plus grande utilisation des approches-programmes et du financement conjoint par les institutions régionales et multilatérales. Par
exemple, l'Agence a utilisé le Programme panafricain pour inciter les donateurs souhaitant offrir une aide à l'Union africaine à recourir au mécanisme du financement conjoint et à communiquer les principes communs d'engagement. Neuf donateurs ont signifié leur accord à cette approche. L'ACDI continue également à inciter des institutions financières, notamment des banques de développement régional, à participer à
un plus grand nombre d'activités faisant appel à plusieurs donateurs. Grâce à l'appui renforcé de l'ACDI, la Banque africaine de développement a augmenté l'aide budgétaire directe qui est passée de 5 p. 100 en 1989 à 25 p. 100 à l'heure actuelle. En 2004, la Banque a également adopté des directives concernant les approches-programmes.
Pour mettre en œuvre les approches-programmes, l'ACDI a toujours beaucoup
tenu compte des leçons du passé. L'Agence est l'un des membres les plus actifs du Réseau d'apprentissage sur les approches-programmes. Elle a contribué à l'organisation du troisième forum annuel du Réseau en juin 2004 à Tokyo et a continué à héberger le site extranet du Réseau, consacré aux échanges internationaux de recherches et d'expériences en matière d'approches-programmes. L'Agence est
également en train de renforcer sa capacité interne. Au cours de la dernière année, un groupe de travail interne a mis au point un nouvel outil de travail intitulé
Guide opérationnel sur le soutien budgétaire direct et les fonds mis en commun pour les pays bénéficiaires
. Ce Guide s'inscrit dans les nouvelles tendances observées en matière de programmes et correspond aux exigences du Conseil du Trésor qui souhaite que
l'on mette au point des instruments et des procédés qui aideront le personnel à planifier et à gérer les approches-programmes sur tous les angles.
Les approches-programmes accordent toujours une place importante à la gestion efficace du risque. En effet, ce type d'aide repose souvent sur les priorités et les systèmes administratifs du pays partenaire. C'est pourquoi toutes les initiatives comportent des exigences rigoureuses en matière de
responsabilisation et de gestion du risque, et sont souvent accompagnées d'une aide connexe au renforcement de la capacité. Par exemple, l'ACDI aide le gouvernement du Nicaragua à renforcer sa capacité d'administrer et de responsabiliser la prestation de programmes, à enrayer les craintes générées par la corruption et à améliorer l'équité et l'efficacité grâce à son Fonds de facilitation des
approches-programmes.
Réalisation des programmes axés sur les politiques et plus grande cohérence entre les politiques de l'ACDI et celles de ses partenaires canadiens
Dans son RPP de 2004-2005, l'ACDI a indiqué qu'au cours des trois prochaines années, elle participera activement :
-
aux comités interministériels réunissant d'autres partenaires gouvernementaux canadiens;
-
à des groupes de donateurs, des
organismes de réglementation et à des réunions internationales;
-
aux discussions en matière de politiques avec les institutions et les gouvernements de pays partenaires en développement.
L'aide au développement n'est qu'une faible partie des ressources dont bénéficient les pays en développement qui comptent également sur l'investissement, le commerce et les transferts de fonds de leurs citoyens travaillant
à l'étranger. Dans le cadre d'une aide au développement efficace, l'ACDI travaille étroitement avec d'autres ministères afin que les politiques adoptées par le gouvernement au Canada aient des résultats cohérents. L'Agence collabore également avec des institutions internationales, des donateurs et des pays partenaires en développement à l'appui des approches renforçant des objectifs communs.
En 2004-2005, la
coordination interministérielle a joué un rôle particulièrement important dans les programmes de l'ACDI destinés à des pays en proie à des conflits ou à des crises politiques, notamment le Zimbabwe, la Côte d'Ivoire, la Colombie, le Sri Lanka, l'Afghanistan, le Soudan et Haïti
(voir
encadré 15
)
. Le comité interministériel s'est réuni périodiquement pendant l'année pour traiter du
Soudan. La stratégie interministérielle visant la République démocratique du Congo a été mise au point par l'ACDI, les Affaires étrangères et l'envoyé spécial du Canada dans la région des Grands Lacs en collaboration avec le Bureau du Conseil privé, le ministère de la Défense, le ministère des Finances, le MAECI (Commerce international) ainsi que Citoyenneté et Immigration Canada. La collaboration
interministérielle a également joué un rôle clé dans les questions économiques. L'Agence a travaillé étroitement avec le ministère des Finances à l'Initiative canadienne d'allègement de la dette et à la réponse du Canada à la commission du Royaume-Uni pour l'Afrique. Grâce à l'Initiative du Corps canadien, l'ACDI est en mesure de travailler étroitement avec de nombreux ministères en
vue de définir une optique cohérente et globale en matière de programmes de renforcement de la gouvernance dans les pays en développement, les pays en transition et les États fragiles.
Pour travailler de façon efficace et cohérente avec les partenaires canadiens et autres, l'ACDI doit coordonner convenablement ses processus internes. Au sein de l'Agence, cette coordination est facilitée grâce à divers groupes de travail,
équipes de projet et comités réunissant des participants provenant de toutes les directions générales. Par exemple, des demandes de financement provenant de partenaires canadiens - organismes bénévoles, groupes du secteur privé et autres associations - font régulièrement l'objet d'une évaluation tenant compte des principales priorités de programme de l'ACDI. Celle-ci a également mis en place des mécanismes permettant de
vérifier si les propositions respectent les politiques transversales en matière d'égalité entre les sexes et de durabilité environnementale.
En 2004-05, la participation intensive de l'ACDI à l'Examen de la politique internationale a témoigné de son engagement à établir une politique cohérente et à travailler en étroite collaboration avec d'autres ministères. Dans le cadre de ce processus, elle a
réussi à mettre au point une approche politique " gouvernementale globale " cohérente à l'appui des initiatives de réduction de la pauvreté à l'échelle mondiale dont tient compte l'EPI de 2005.
|
Encadré 15 : Un rôle de premier plan particulier pour le Canada en Haïti
|
Après le
départ du président Aristide le 29 février 2004, le Conseil de sécurité de l'ONU a déployé une force multinationale intérimaire visant à rétablir l'ordre. Environ 530 membres des Forces armées canadiennes ont participé à cette force multinationale en 2004. Toutefois, la stabilité de cette force était menacée et les efforts de reconstruction compromis. Le 25 juin 2004, la mission des Nations Unies
pour la stabilisation en Haïti, une force constituée de plus de 1 600 policiers civils, sous le commandement d'un surintendant de la GRC, et environ 6 700 soldats brésiliens, a pris en charge la sécurité et les activités de reconstruction.
Les autorités civiles, en partenariat avec la communauté internationale, ont mis sur pied un Cadre de coopération intérimaire (CCI) pour couvrir la période de 2004 à 2006. Le Canada a
engagé 180 millions de dollars dans le soutien au CCI, ce qui comprend 26 millions de dollars destinés au déploiement de 100 policiers et 154 millions de dollars destinés à soutenir :
-
la gouvernance : sécurité, police, désarmement, justice, pénitenciers, droits de la personne, processus électoral et échanges de vue au niveau national;
-
l'économie : renforcement de la capacité institutionnelle,
développement local;
-
le redressement économique : électricité, création d'emploi rapide, microfinancement, agriculture, protection et remise en état de l'environnement;
-
l'accès aux services sociaux fondamentaux : eau et assainissement, santé, nutrition et éducation.
En outre, le Canada a contribué au paiement des arriérés auprès de la Banque mondiale et a acquitté
les droits d'adhésion d'Haïti à la Banque de développement des Caraïbes; l'ACDI et les Affaires étrangères sont en train d'élaborer des approches visant à mobiliser les Canadiens d'origine haïtienne pour seconder le CCI. Le Canada, grâce au rôle de premier plan de l'ACDI, est le chef de file du projet pilote de l'OCDE et du CAD en Haïti, destiné à appliquer les principes de l'aide internationale efficace dans les
états fragiles. Le Canada est un acteur important dans la coordination de la mise en œuvre du CCI. Le gouvernement a nommé un conseiller spécial pour Haïti, M. Denis Coderre, afin de diriger l'ensemble des efforts.
Le soutien du Canada à Haïti repose essentiellement sur la coopération et la cohérence des politiques entre l'ACDI, les partenaires canadiens et d'autres partenaires. L'approche du Canada dans le cadre de son programme d'aide exige
une coordination étroite entre les principaux partenaires, l'ACDI, les Affaires étrangères et la Défense. En tout, ce sont 50 ministères et organismes du gouvernement canadien qui coordonnent l'aide consentie.
|
La cohérence et la coopération en matière de politique prônées par l'ACDI sont des éléments clés non seulement au Canada, mais également à l'échelle
internationale et dans les relations avec les partenaires des pays en développement. L'ACDI participe activement à diverses institutions internationales, à des groupes de donateurs et à des forums consultatifs. Cette participation contribue à renforcer la capacité d'assurer l'efficacité de l'aide au développement.
Signalons par exemple qu'en 2004-2005, l'ACDI a contribué de façon importante au renforcement des institutions partenaires du
système de développement de l'ONU, tant par la participation du Canada au conseil d'administration des institutions dont il est actionnaire, que par le travail avec les institutions elles-mêmes pour améliorer leur degré de responsabilisation, leurs résultats, et les aider à mieux définir leurs priorités et leur rendement. Elle a entre autres travaillé directement avec le Secrétariat des Nations Unies ainsi qu'avec le Groupe des Nations
Unies pour le développement afin de renforcer les équipes de pays membres de l'ONU en améliorant la cohésion, la coordination et la capacité.
En octobre 2004, le Canada a accueilli à titre de président la deuxième Réunion internationale sur les bonnes pratiques d'action humanitaire à Ottawa. Elle mettait l'accent sur la sensibilisation aux principes et bonnes pratiques d'aide humanitaire dans le monde entier ainsi que sur la
promotion dans ce domaine. Grâce à l'appui politique et financier du Canada, on a intégré un cadre d'action humanitaire au mécanisme d'examen par les pairs en vigueur à l'OCDE/CAD pour un minimum d'au moins deux ans. Il s'agit d'un outil clé de responsabilisation permettant de mesurer les progrès réalisés par les donateurs en matière de principes et de bonnes pratiques d'action humanitaire.
L'ACDI s'est engagée à
travailler en étroite collaboration avec ses partenaires des pays en développement, notamment en se montrant plus ouverte aux échanges de vues et en prenant des mesures de décentralisation. Par exemple, pendant la période faisant l'objet de l'examen, les discussions avec des donateurs et le gouvernement éthiopien ont permis à l'Agence de contribuer grandement à l'élaboration de politiques communes en matière de dette, de sécurité
alimentaire, d'harmonisation de l'aide, de réforme du secteur public et autres. La participation au groupe consultatif et au forum de développement du Bangladesh a également donné au Canada la possibilité de favoriser les discussions sur des sujets sensibles, notamment la corruption et les droits de la personne. Au Honduras, le programme décentralisé des spécialistes sectoriels et du personnel technique, appelé Pro-Mesas, permet à l'ACDI
de participer activement à la diffusion de l'information et aux programmes conjoints avec le gouvernement du Honduras, d'autres donateurs et des spécialistes. L'ACDI appuie également ses partenaires canadiens lorsque les discussions sur les politiques font partie de projets plus importants mis en œuvre avec leurs homologues des pays en développement
(voir
l'encadré 16
)
.
|
Encadré 16 : Association des infirmières et des infirmiers du Canada : un dialogue sur les politiques avec les gouvernements
|
Le programme de partenariat de l'Association des infirmières et des infirmiers du Canada vise à valoriser la profession d'infirmier et les associations de personnel infirmier en vue de promouvoir la santé et l'équité sur le plan mondial. Le personnel
infirmier dans les pays en développement (majoritairement des femmes dispensant la majeure partie des services de santé) a été en grande partie ignoré en ce qui concerne l'élaboration des politiques sur les questions de santé.
Grâce aussi au partenariat de l'Association des infirmières et des infirmiers du Canada, le personnel infirmier prend une part active dans l'orientation des politiques en vue d'améliorer les conditions
d'exercice professionnel ainsi que les résultats en matière de santé. En Éthiopie et au Vietnam, où les associations n'ont jusqu'alors pas contribué à l'élaboration des politiques, des représentants de l'Association des infirmières et des infirmiers du Canada sont désormais conviés à participer aux exercices de planification du secteur national de la santé. Les partenaires indonésiens rendent compte d'une
collaboration étroite avec les ministères de santé et d'éducation en matière d'élaboration des politiques. Par ailleurs, les partenaires d'Amérique latine participent également activement à la formulation de stratégies nationales en matière de santé.
|
Facilitation de la prise en charge locale et déliement de l'aide
Dans son RPP de 2004-2005, l'ACDI a indiqué
qu'au cours des trois prochaines années elle continuerait :
-
d'appuyer le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) des pays partenaires ainsi que les plans nationaux de développement;
-
d'appuyer les approches communautaires renforçant la capacité locale;
-
d'appuyer la décentralisation pour favoriser une plus grande participation en matière de gouvernance au niveau local;
-
de délier l'aide
canadienne.
Un développement ne reposant pas sur des priorités définies localement ne peut être durable; par conséquent, la prise en charge locale constitue un élément clé de tous les programmes de l'ACDI. L'objectif des pays en développement est de définir des stratégies nationales de développement, notamment des CSLP, dirigées par les pays, axées sur les résultats, ciblant les
méthodes pour répondre aux besoins des pauvres, reposant sur le partenariat et faisant appel à une participation populaire d'envergure. L'Agence met à niveau ses stratégies de programme en fonction de ces plans afin que l'aide canadienne repose sur les besoins et priorités exprimés par les pays en développement eux-mêmes.
L'ACDI offre souvent de l'aide aux gouvernements nationaux en vue d'élaborer leurs plans nationaux de
développement. Par exemple, en 2004-2005, l'Agence a fourni une assistance technique à l'appui de consultations publiques en Indonésie, qui ont guidé et aidé à définir le plan de développement national. Dans un contexte différent, l'ACDI appuie la prise en charge locale en renforçant la capacité locale. En Égypte, au Ghana et au Sénégal, le Canada a considérablement aidé les gouvernements à
intégrer la notion d'égalité entre les sexes dans les principales politiques et lois nationales. En Afrique, le soutien continu de l'ACDI au processus lié au NEPAD, un plan conçu en Afrique visant à mettre fin à la marginalisation de ce continent et à le placer sur la voie du développement durable, permet à l'aide canadienne de répondre aux priorités africaines, tout en appuyant les programmes et les institutions du continent noir.
En 2004-2005, l'appui aux programmes de décentralisation des pays partenaires était toujours l'un des principaux moyens utilisés par l'ACDI pour favoriser la prise en charge locale. Par exemple, au Honduras, l'Agence a appuyé le projet Mamuca visant cinq municipalités du centre de l'Atlantida dans le nord du pays. Ce projet ciblait le renforcement de la capacité de gestion locale, garantissant ainsi la participation de la société civile aux affaires
municipales et appuyant les mesures de décentralisation de la gestion des ressources naturelles, de la santé et de l'éducation. Dans le même ordre d'idée, l'ACDI aide le Ghana à instaurer un plan d'action national de décentralisation en améliorant la mise en œuvre des plans de développement de district par les assemblées de district du nord du Ghana. Ce projet vise à réduire la pauvreté dans les 24 districts du
Nord du Ghana qui sont les plus pauvres du pays.
|
Encadré 17 : L'élément multiplicateur : renforcer les capacités au niveau de la collectivité
|
L'ACDI admet qu'une prise en charge locale exige souvent d'investir dans des approches communautaires et dans le renforcement des capacités, et ce, au niveau de la
collectivité. En 2004-2005, l'ACDI a soutenu les efforts de ses partenaires afin de renforcer cette capacité, au sein du gouvernement ainsi que dans les organisations de la société civile. Parmi les exemples de ce soutien, mentionnons :
-
en Zambie
, les programmes de coopération de l'ACDI, notamment en matière de santé et d'éducation, qui entraînent un fort engagement avec la collectivité locale. Le cadre d'ensemble des
programmes est rattaché à la Stratégie de réduction de la pauvreté en Zambie et les efforts se concentrent sur les secteurs clés désignés comme priorités locales. Ce cadre encourage également une gestion et une responsabilité budgétaire prudentes;
-
au Cambodge
, le projet relatif au VIH/sida appuyé par l'ACDI qui est en cours de mise en œuvre grâce à des partenariats entre
Vision mondiale, différents échelons du ministère de la Santé et les organisations de lutte contre le VIH/sida. La collaboration suppose une participation du personnel du ministère de la Santé, l'adoption des lignes directrices du ministère de la Santé et, lorsque cette composante du projet est terminée, le transfert d'activités de projet au gouvernement et à d'autres partenaires;
-
en Équateur
,
le Fonds de développement Canada-Équateur, qui a permis la réalisation de la majorité des programmes bilatéraux de l'ACDI depuis presque 15 ans, a atteint un tel niveau de professionnalisme et d'expertise qu'il peut offrir plus de programmes que l'ACDI ne peut en financer. Ce fonds, qui était un projet bilatéral de l'ACDI, est en train de devenir un organisme sans but lucratif légalement constitué, lui permettant ainsi de recueillir des fonds de
toute une variété de donateurs;
-
dans les Balkans
, les demandeurs qui souhaitent obtenir un financement d'un Fonds de développement local de l'ACDI associé à la phase II du projet de coopération avec les administrations cantonales et locales en Bosnie, qui est financée par l'ACDI, reçoivent une formation et de l'aide pour réaliser leur proposition. Les partenariats constitués dans le cadre de ces projets
permettent aux participants de partager leurs compétences fraîchement acquises au niveau municipal et au sein de l'université locale.
|
Fidèle au principe de la prise en charge locale, le Canada demeure résolu à délier davantage son aide en 2004-2005. On considère que le fait d'exiger que les fonds versés au titre de l'aide soient utilisés pour s'approvisionner dans les pays donateurs a pour
effet de miner l'efficacité de l'aide. L'aide liée est souvent plus coûteuse et ne favorise pas le développement des capacités locales.
En 2002, le Canada a adopté une nouvelle politique sur le déliement de l'APD qui était conforme à l'accord international conclu au sein du CAD de l'OCDE sur le déliement obligatoire de la majorité de l'aide aux pays les moins avancés (PMA). Les responsables des programmes d'aide pour les
pays autres que les PMA fondent maintenant les décisions concernant le recours à l'aide liée ou déliée sur les principes de l'efficacité de l'aide et des considérations stratégiques spécifiques. La politique adoptée par le Canada en 2002 devrait aboutir à un plus grand déliement de l'aide au fil du temps. Le taux de déliement du Canada a considérablement augmenté entre 2000 et 2004 (voir le tableau 6). Il
faudra attendre plusieurs années avant de pouvoir évaluer l'effet général de cette politique. Ceci dit, il convient de signaler que les pratiques de l'ACDI dans le cadre des programmes géographiques ont changé et qu'elles favorisent un plus grand déliement de l'aide, en raison des principes de l'efficacité de l'aide qui privilégient les approches-programmes. En 2004-2005, plus de 64 p. 100 des décaissements de la Direction
générale de l'Afrique, à l'exclusion du FCA, visaient des volets d'aide non liée.
Tableau 6 : Taux de déliement de l'APD du Canada
|
Pourcentage de l'aide canadienne non liée
|
24,9 %
|
31,7 %
|
61,4 %
|
52,6 %
|
57 %
|
Établissement de partenariats consensuels et de collaboration entre l'ACDI, d'autres donateurs, des pays bénéficiaires et des partenaires
Dans son RPP de 2004-2005, l'ACDI a indiqué qu'elle entendait au cours des trois prochaines années :
-
Mettre en œuvre son nouveau Plan d'action sur l'harmonisation, en collaboration avec des partenaires des pays en
développement, d'autres donateurs et des intervenants au sein même de l'Agence;
-
Continuer à rechercher des possibilités d'harmoniser les procédures, les préoccupations et les mécanismes;
-
Continuer à entreprendre des activités régionales de coopération;
-
Continuer à instaurer de nouveaux types de partenariats, notamment des activités de coopération
déléguée.
L'approche de l'ACDI à l'égard du développement durable repose fondamentalement sur le concept du partenariat. De plus en plus, les donateurs - notamment l'ACDI - s'efforcent en priorité de renforcer la capacité des pays en développement à exercer un plus grand contrôle sur leur propre développement, et endossent le rôle de partenaires plutôt que d'exécuteurs des programmes et des projets. Un aspect
essentiel de cette approche réside dans l'importance accordée à l'harmonisation de l'aide, laquelle contribue à réduire les carences, à renforcer les capacités des pays partenaires et à optimiser l'effet de l'aide.
L'ACDI contribue beaucoup à l'harmonisation de l'aide au sein de la communauté de donateurs. Dans son
Énoncé de politique en faveur d'une aide internationale plus efficace
de 2002, elle s'est
engagée à resserrer la coordination avec d'autres donateurs, engagement repris dans le cadre de la Déclaration de Rome sur l'harmonisation en 2003 et concrétisé dans le
Plan d'action sur l'harmonisation
de l'ACDI, qui a été approuvé en septembre 2004. En mars 2005, d'autres avancées ont été réalisées par l'entremise de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement, dans le
cadre de laquelle l'Agence a pris des engagements précis, ainsi que d'autres donateurs et des partenaires des pays en développement dans des domaines tels que la gestion des résultats, l'acheminement des fonds par les budgets et les systèmes des pays partenaires, l'utilisation de l'aide-programme, la réalisation de missions conjointes et l'alignement de l'assistance technique.
En dépit de la nouveauté relative du
Plan d'action sur l'harmonisation
de l'ACDI, l'Agence a déjà réalisé des progrès notables, notamment en désignant des agents de coordination et des services de soutien technique au sein de l'Agence; en obtenant l'approbation du Conseil du Trésor sur les procédures nécessaires pour participer à des mécanismes de mise en commun des fonds; en renforçant sa présence sur le terrain pour accroître les possibilités de programmation conjointe;
en participant à des analyses et à des évaluations conjointes; ainsi qu'en harmonisant de plus en plus ses décaissements sur les systèmes des gouvernements partenaires une fois que toutes les exigences relatives à la diligence raisonnable sont rencontrée. Bien que l'on ne puisse éliminer totalement les défis et les risques des efforts déployés au chapitre de l'harmonisation, l'ACDI continue d'intégrer les leçons
retenues à ses propres approches et à communiquer ces dernières à ses partenaires.
En plus de renforcer ses propres approches, l'ACDI a collaboré activement en 2004-2005 avec tout un éventail de partenaires issus de pays en développement, pour les aider à renforcer leur capacité à harmoniser leurs programmes. Par exemple, en Jamaïque - où a été mis en œuvre à titre pilote un programme
d'harmonisation parrainé par la Banque mondiale - l'ACDI a mis en place une approche harmonisée pour fournir une aide en matière de reconstruction par le truchement du Bureau de la reconstruction nationale. L'Agence tente également de s'associer à d'autres partenaires pour mettre en œuvre la nouvelle programmation de la Jamaïque, axée sur la réforme juridique et judiciaire. En Éthiopie, l'ACDI a joué un rôle important pour aider le
gouvernement à élaborer son Plan d'action sur l'harmonisation. Elle collabore également avec des organisations régionales, telles que le partenariat spécial pour l'Afrique, pour appuyer les efforts relatifs à l'aide budgétaire et sectorielle, ainsi que pour examiner le rôle des fonds mondiaux dans la mobilisation des ressources. L'ACDI a offert un soutien supplémentaire aux efforts d'harmonisation déployés dans des pays aussi variés
que le Vietnam, le Kenya, le Nicaragua, Haïti, le Mozambique et la Tanzanie, où l'ACDI entend participer au Programme d'aide conjointe, actuellement en cours d'élaboration.
L'ACDI a continué à mettre sur pied de nouveaux types de partenariats et de nouvelles approches pour le financement de l'appui à une programmation efficace en matière d'aide. L'Agence a coopéré avec d'autres donateurs dans le cadre d'ententes novatrices très
variées, notamment grâce au mécanisme de la " coopération déléguée " où un donateur bilatéral achemine les fonds en se servant du programme d'un autre. Par exemple, l'ACDI gère actuellement des fonds suédois en appui au Fonds de renforcement de l'autonomie des femmes au Guatemala et, au Malawi, le Royaume-Uni a investi dans deux projets de l'ACDI portant sur l'égalité entre les sexes et la formation
économique, en doublant le financement de ces deux projets.
Les partenariats formés par l'ACDI peuvent également offrir des possibilités d'action catalytique importantes que l'Agence continuera à dégager et à favoriser. Par exemple, en sa qualité de premier partenaire bilatéral à avoir fourni des subventions pluriannuelles pour les programmes à l'OSCE, l'ACDI pu jouer un rôle de catalyseur conduisant au versement de 3 millions de
dollars américains supplémentaires à son initiative sur l'environnement et la sécurité au cours de 2004. Des possibilités similaires peuvent également s'offrir aux programmes de l'ACDI, par exemple, dans des cas où des initiatives conçues par des ONG canadiennes peuvent servir de pilotes à des programmes de plus vaste envergure. En 2004-2005, la Direction générale de l'Afrique a choisi le Projet de formation en renouvellement
de la santé au Mozambique de l'Université de la Saskatchewan, qui est un programme financé par la Direction générale du partenariat canadien, comme bénéficiaire d'un financement bilatéral. De 1998 à 2005, la Direction générale du partenariat canadien a versé 4,3 millions de dollars à ce projet.
Enfin, l'établissement de partenariats de collaboration avec des partenaires canadiens est clairement un
aspect clé du travail de l'ACDI. En 2004-2005, l'Agence a continué à déployer des efforts importants dans ce domaine, entre autres, en menant toute une série d'activités de sensibilisation auprès de partenaires des secteurs privé et volontaire, sur son cadre de gestion des programmes du secteur volontaire et sa politique de partage des coûts. L'ACDI participe également régulièrement à des assemblées
générales annuelles d'organisations canadiennes partenaires ainsi qu'à des rencontres destinées à diffuser les connaissances avec des organisations telles que le Conseil canadien pour la coopération internationale.
Parallèlement, l'ACDI et ses partenaires canadiens ont été, en 2004-2005, confrontés à certains problèmes. Le lancement d'un appel de propositions pour le Mécanisme de projets ONG et le Programme pour l'environnement
et le développement durable a été reporté jusqu'à ce que l'évaluation de ces programmes ait été menée à bien. Bon nombre de partenaires de l'ACDI ont interprété ce report comme un signe de désintérêt de l'Agence à leur égard. L'évaluation a fourni à l'ACDI des informations précieuses concernant la contribution des ONG de petite et moyenne taille à l'atteinte de
l'objectif général de réduction de la pauvreté de l'Agence. Cette évaluation a confirmé que les petites ONG partenaires, en particulier, offrent de nombreuses occasions aux Canadiens de participer au développement international. Les responsables de l'évaluation ont conclu que des modifications devaient être apportées tant au Mécanisme de projets ONG qu'au Programme pour l'environnement et le développement durable. À la
lumière de cette évaluation, et des nouvelles orientations définies dans l'EPI rendu public en avril 2005, l'ACDI réexaminera ses programmes de partenariat afin de promouvoir l'excellence et l'innovation dans la coopération au développement.
32
Le pourcentage d'aide déliée en 2002 se distingue puisqu'il reflète le montant considérable de remise de dette alloué sous l'initiative
en faveur des pays pauvres les plus endettés cette année.
|
Encadré 18 : Étude de cas sur l'harmonisation - Tanzanie
|
La Tanzanie a été un des premiers pays à mettre au point une stratégie de réduction de la pauvreté en 2000. Cette stratégie a permis
aux donateurs de participer à plusieurs niveaux, notamment à la création d'un mécanisme de soutien budgétaire, qui offre des ressources flexibles et prévisibles destinées aux secteurs désignés par la stratégie, ainsi qu'un financement de plusieurs approches sectorielles dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la réforme de l'administration locale. Des progrès considérables ont
été accomplis en matière d'harmonisation des programmes et des procédures; toutefois, des difficultés persistent lorsqu'il s'agit d'affecter des ressources en dehors du système financier gouvernemental, ce qui compromet la transparence et la responsabilisation. De nombreux systèmes de donateurs parallèles existent en permanence dans des domaines tels que l'approvisionnement, l'établissement de rapports, le suivi et la gestion de projet, et représentent
également un lourd fardeau pour le gouvernement de Tanzanie.
En janvier 2005, la Tanzanie publie sa deuxième stratégie de réduction de la pauvreté pour la période de 2005 à 2010, la Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Le gouvernement a l'intention de prendre en main la coordination de l'aide octroyée par les donateurs dans le cadre de la stratégie grâce à une
stratégie d'aide conjointe. Celle-ci va tenter d'intensifier l'harmonisation en rationalisant les mécanismes de consultation, de suivi et de mise en œuvre, et en encourageant les donateurs à rationaliser leurs activités. L'ACDI appuie complètement les efforts déployés par le gouvernement de Tanzanie et adaptera ses propres programmes d'aide en conséquence.
L'ACDI est un participant actif aux discussions sur l'harmonisation en Tanzanie, notamment par
l'intermédiaire du forum du Groupe des partenaires du développement. L'organisme a pris la tête de certains programmes au sein de la communauté des donateurs, notamment en qualité de président du groupe des donateurs participants au Programme de développement de l'enseignement primaire. L'ACDI prépare son propre programme d'aide afin d'appuyer davantage l'harmonisation de l'aide en Tanzanie en supprimant progressivement la plupart des projets à
ce chapitre et en investissant davantage dans les fonds communs, l'aide budgétaire ou les mécanismes exécutés par les gouvernements tels que :
-
le Programme de développement de l'enseignement primaire (approche sectorielle);
-
le Programme de renforcement du secteur financier (fonds commun);
-
l'initiative de Soutien budgétaire pour la réduction de la pauvreté;
-
le programme à démarrage rapide
contre le VIH/sida (exécuté par le gouvernement).
Ces approches visent à accroître la prise en charge locale, à diminuer les coûts de transaction et à maximiser les effets durables. Toutefois, une dépendance plus étroite aux institutions et aux systèmes locaux - notamment dans la gestion fiduciaire - comporte des risques. L'ACDI a récemment achevé une analyse complète des risques inhérents au
soutien budgétaire à la Tanzanie et intégrera les résultats de cette analyse dans sa stratégie de gestion de programme.
|
2.2.2 Concentration sectorielle et thématique appropriée
Dans son RPP de 2004-2005, l'ACDI a indiqué qu'au cours des trois prochaines années elle entendait :
-
Réduire le nombre de secteurs et de thèmes constituant son champ
d'action;
-
Mettre en œuvre les priorités de développement social;
-
Mettre en œuvre de nouvelles politiques sur l'agriculture et le développement rural ainsi que sur le développement d'un secteur privé favorable aux pauvres.
Depuis l'entrée en vigueur de
l'Énoncé de politique en faveur d'une aide internationale plus efficace
, l'Agence s'emploie à réduire le nombre de secteurs et
de thèmes dans lesquels s'inscrivent ses interventions. La plupart des programmes-pays ont concentré leurs efforts. Par exemple, le programme en faveur de la Zambie a resserré ses secteurs d'intervention prioritaires, passant de huit secteurs à deux, et le programme en faveur de l'Égypte se concentre désormais sur l'éducation de base et le développement de l'emploi et des petites entreprises. En outre, le champ d'action de la programmation dans
certains pays est maintenant plus restreint. Au Zimbabwe, tous les fonds d'aide canadiens versés au gouvernement ont été suspendus mais l'ACDI continue à appuyer des organisations de la société civile qui luttent contre le VIH/sida et défendent l'égalité entre les sexes, la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire, les droits de la personne, la démocratie et la bonne gouvernance. L'agitation sociale en Côte
d'ivoire a également conduit l'ACDI à concentrer ses efforts sur le soutien à la primauté du droit, à la démocratie et aux droits de la personne.
En 2000, l'ACDI a annoncé son intention de se concentrer sur les quatre priorités de développement social que sont l'éducation de base, la santé et la nutrition, la lutte contre le VIH/sida et la protection de l'enfant, l'égalité entre les sexes étant
intégrée à titre de thème transversal. L'Agence a pris l'engagement de doubler ses dépenses dans ce secteur d'ici 2005. Le graphique 5 illustre la manière dont cet engagement a été honoré et démontre que l'ACDI a en fait dépassé son objectif de dépense original de 2,8 milliards de dollars, pour atteindre un investissement total de 3,2 milliards.
Graphique 5 : Décaissements réels au titre des
priorités de développement social de l'ACDI
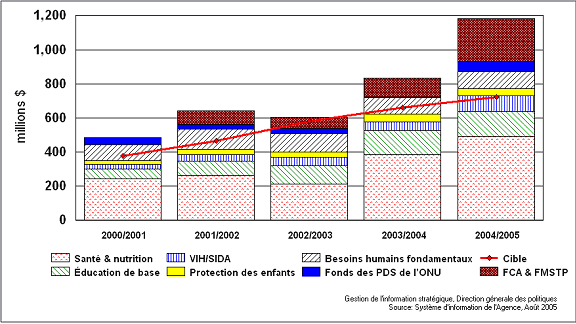
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
En plus de se concentrer sur les priorités de développement social, l'Agence a continué à réaliser des progrès importants dans d'autres secteurs. L'exercice 2004-2005 a été la première année complète de mise en œuvre
des politiques de l'ACDI sur l'agriculture et le développement rural, ainsi que sur le développement d'un secteur privé favorable aux pauvres. Les dépenses globales pour l'agriculture ont continué d'augmenter (voir le graphique 6), ce qui témoigne de l'importance du secteur au regard de la réduction de la pauvreté et du développement économique. Parallèlement, tel qu'indiqué précédemment, un
rééquilibrage des priorités à l'Agence a fait que celle-ci n'a pas atteint l'objectif de dépense initialement fixé dans son énoncé de politique en matière d'agriculture rendu public en 2003, L'agriculture au service du développement rural durable. Toutefois, les nouvelles orientations du programme d'aide canadien définies dans le cadre de l'examen de la politique internationale et de l'EPI fournissent un cadre permettant à l'Agence de
continuer à investir tant dans l'agriculture et le développement durable que dans des initiatives de développement du secteur privé.
Graphique 6 : Décaissements réels de l'ACDI au titre de l'Agriculture

Cliquez sur l'image pour l'agrandir
L'ACDI continuera à concentrer son aide dans des secteurs clés. En 2004-2005, elle a participé à
l'Examen de la politique internationale et réaffirmé son intention de continuer à concentrer le programme d'aide du Canada dans un nombre limité de secteurs, afin de mieux répondre aux priorités des pays partenaires et d'optimiser l'effet de l'aide canadienne. Tel qu'il est mentionné dans l'EPI d'avril 2005, le programme d'aide du Canada se concentrera particulièrement dans les 5 secteurs clés, à savoir : la bonne gouvernance, la santé (y
compris la lutte contre le VIH/sida), l'éducation de base, le développement du secteur privé et la durabilité de l'environnement. En ce qui concerne la concentration thématique, l'Agence continuera à accorder une haute importance à l'égalité entre les sexes, qui sera intégrée explicitement et systématiquement à tous ses programmes. La viabilité de l'environnement est un des secteurs d'intervention prioritaires
ainsi qu'un thème transversal qui sera pris en compte dans le processus décisionnel concernant toutes les activités de coopération au développement du Canada.
2.2.3 Concentration géographique appropriée
Dans son RPP de 2004-2005, l'ACDI a indiqué qu'au cours des trois prochaines années elle :
-
Concentrerait de nouvelles ressources dans un groupe restreint de pays pauvres choisis
comme pays de concentration;
-
Accroîtrait sa présence dans un petit nombre de pays et d'institutions en Europe centrale et orientale;
-
Rechercherait de nouvelles possibilités de concentrer sa programmation par un examen de ses relations au chapitre du développement avec des pays arrivant à maturité, en tenant compte des relations économiques, stratégiques et sociales plus globales que le Canada entretient avec chaque pays.
En 2004-2005, l'ACDI a continué de concentrer sa programmation en fonction des besoins et de la capacité des pays partenaires à utiliser l'aide efficacement. En 2002, la ministre de la Coopération internationale a dressé une liste initiale de neuf pays de concentration devant bénéficier d'une plus grande part des fonds additionnels consentis à l'enveloppe de l'aide internationale (EAI). Il s'agit du Bangladesh, de la Bolivie, du Ghana,
de l'Éthiopie, du Honduras, du Mali, du Mozambique, du Sénégal et de la Tanzanie. L'année suivante, les ressources ont commencé à être dirigées vers ces pays, aussi bien en provenance du programme bilatéral que de propositions de projet soumises par des partenaires canadiens de l'ACDI. En 2004-2005, les dépenses ont continué d'être concentrées dans ces neuf pays
(voir le
graphique 7
)
.
En 2004-05, la Direction générale de l'Europe centrale et de l'Est a continué de réduire le nombre de pays dans lesquels elle concentrait ses dépenses, se limitant à six pays de concentration. Elle a affecté 70 p. 100 de son aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Géorgie, à la Russie, à la Serbie-Monténégro, à l'Ukraine et au Tadjikistan. Plusieurs pays se sont également affranchis du
programme d'aide de l'ACDI. En mai 2004, huit pays de cette région ont adhéré à l'Union européenne. L'ACDI mettait en œuvre des programmes d'aide dans sept de ces huit pays
33
, auxquels elle a mis fin le 1er avril 2005, à l'exception du programme-phare
Aide publique au développement en Europe centrale
(APDEC). Ce programme a aidé ces pays à établir leurs propres unités nationales d'aide publique au
développement. Ce volet développement des capacités a pris fin en mai 2005. Par le biais de la coopération trilatérale, dans le cadre du deuxième volet du programme qui a été amorcé en 2004-2005, l'ACDI verse des fonds de contrepartie et apporte une aide sous diverses formes, dont le suivi et l'évaluation, à quatre des huit pays partenaires de l'Europe centrale et de l'Est afin d'appuyer leurs projets de développement en Asie, en Afrique
et en Europe de l'Est. Les programmes d'aide du Canada en Thaïlande et en Malaisie se sont également terminés en 2004-2005. L'expérience du Canada au chapitre des " stratégies de reclassement " a également permis de dégager des leçons utiles que l'ACDI prendra en compte dans les mesures qu'elle adoptera pour concentrer le programme d'aide du Canada
(voir
l'encadré 19
)
.
33
La République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie. L'ACDI met en œuvre des programmes d'aide dans ces huit pays., sauf la Slovénie. Elle fournit des fonds par le biais de son programme APDEC aux huit pays susmentionnés.
|
Encadré
19 : Concentrer l'aide canadienne : mise en application des leçons apprises
|
Poursuivant dans sa lancée, l'ACDI va continuer de s'efforcer d'accentuer la concentration de ses programmes en examinant ses relations de développement avec certains pays qui font des progrès intéressants avec ceux à revenu intermédiaire.
Par exemple, l'ACDI mettra fin en mars 2006 à son aide bilatérale en Inde. Dans l'intervalle,
la grande réussite du renforcement institutionnel dans le cadre du projet de protection de l'environnement constitue la base pour établir des relations suivies entre le ministère de l'Environnement du Canada et le ministère de l'Environnement et des forêts de l'Inde. En janvier 2005, une déclaration commune des premiers ministres canadien et indien annonçait la création d'un forum permanent sur l'environnement entre le Canada et l'Inde.
On
prépare également des stratégies de transition pour un certain nombre de programmes en Asie, en Europe centrale et orientale, en Afrique et dans les Amériques. L'expérience de l'ACDI quant au reclassement de plusieurs pays du programme d'aide en 2004-2005 a permis de tirer les enseignements qui aideront à guider d'autres initiatives similaires à l'avenir. L'expérience de l'ACDI a montré que la clôture d'un programme d'aide technique ou au
développement, tout en assurant la pérennité de l'héritage canadien, pose des défis particuliers. Le programme pour l'Europe centrale et orientale a montré qu'une stratégie de reclassement efficace nécessite une planification consciencieuse : l'administration locale doit être avertie suffisamment à l'avance (au moins deux ans) que les programmes de l'ACDI vont être progressivement supprimés. Il est important de prêter
attention aux délais et aux demandes en matière de ressources à l'occasion de la clôture du programme, ainsi que de réorienter le personnel et les ressources.
|
L'engagement du Canada à améliorer l'efficacité de l'aide canadienne, notamment par l'entremise de sa concentration géographique, a été confirmé par l'examen de la politique internationale de 2004-2005. Dans le cadre de ce processus, l'ACDI a
participé à la sélection des 25 pays partenaires du développement (c.-à-d., les neufs pays de concentration plus 16 autres) où le programme d'aide du Canada sera concentré. En 2004-2005, ce groupe de 25 pays a déjà représenté environ 41 p. 100 du budget d'aide bilatérale de l'Agence. Dans l'EPI, le Canada s'est engagé à affecter les deux tiers de l'aide bilatérale totale à ces pays d'ici 2010,
principalement en Afrique. Dans le budget de 2005 et l'EPI, le Canada s'est également engagé à doubler l'aide destinée à l'Afrique entre 2003-2004 et 2008-2009.
Graphique 7 : Répartition des décaissements au titre de l'aide de l'ACDI par direction générale bilatérale dans les pays de concentration (millions de dollars)
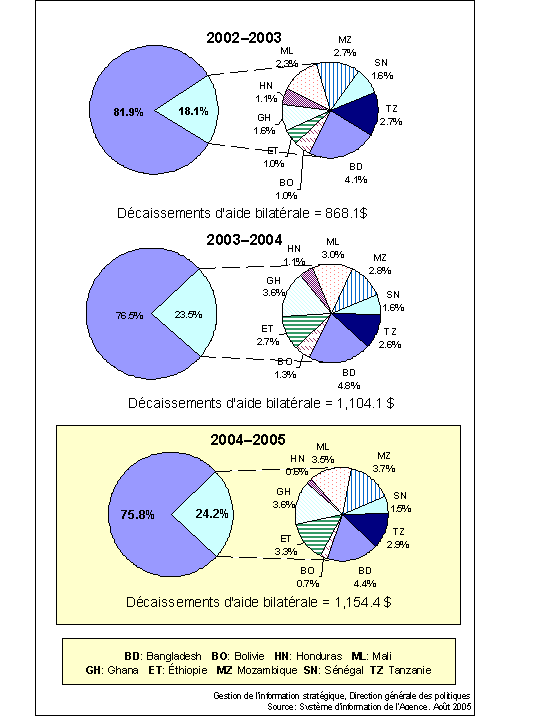
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2.2.4 Participation active des Canadiens
Dans son RPP de 2004-2005, l'ACDI a indiqué qu'au cours des trois prochaines années elle :
-
Accroîtrait ses efforts pour transmettre son message aux médias;
-
Élaborerait un plan de sensibilisation pour faire participer les décideurs;
-
Renouvellerait sa stratégie d'engagement du public et continuer à faire participer les Canadiens, surtout les jeunes;
-
Positionnerait le développement international comme un élément central des valeurs et de l'identité du Canada;
-
Continuerait à tenir des consultations publiques et à mettre des documents stratégiques et de planification à la disposition du public.
L'appui du
public est essentiel à la prestation du programme d'aide au développement du Canada. Les communications et les activités relatives à l'engagement du public sont destinées à améliorer la perception du public quant à la valeur, l'efficience et l'efficacité des programmes d'APD et d'AP du Canada. La Direction générale des communications et le Corps canadien travaillent en étroite collaboration pour sensibiliser le public et
encourager sa participation dans le cadre du programme d'aide
(voir
encadré 20
)
.
|
Encadré 20 : Mobiliser les Canadiens par l'entremise du Corps canadien
|
Le gouvernement a créé le Corps canadien en 2004, un nouveau mécanisme qui permet de renforcer la contribution mondiale du Canada aux droits de la
personne, à la démocratie et à la bonne gouvernance.
Le Corps canadien établira des partenariats de collaboration avec le gouvernement, des organisations non gouvernementales, le secteur privé et des citoyens canadiens afin de favoriser l'engagement, l'expertise, la cohérence et la reconnaissance relativement aux initiatives canadiennes de gouvernance à l'étranger.
Le Corps canadien veillera à mobiliser les Canadiens de tous
âges et de tous horizons, modifier la programmation existante, faire participer les Canadiens et communiquer avec eux, élargir les connaissances et à faire la promotion d'une identité commune pour l'excellence canadienne en matière de gouvernance.
En novembre 2004, la responsabilité du Corps canadien est passée du MAECI (Affaires étrangères) à l'ACDI. Le premier projet qu'il a entrepris, aider au déroulement des
élections en Ukraine en décembre 2004, a été couronné de succès. Depuis, l'ACDI n'a cessé d'enrichir le programme du Corps canadien. À ce jour, on compte parmi les principaux projets :
-
un partenariat avec l'Association des universités et collèges du Canada;
-
un partenariat avec Coalition Cyberjeunes, dans le cadre duquel les jeunes intègrent les TIC et la cybergouvernance aux groupes publics, parapublics et à la
société civile;
-
un fonds d'affectation spéciale destiné au maintien de la paix dans le cadre du Programme des volontaires des Nations Unies, pour le déploiement d'au moins 20 volontaires;
-
Solidarité Haïti, qui devrait rassembler au moins 250 volontaires, y compris des Canadiens d'origine haïtienne, afin d'œuvrer avec quatre organisations clés : le Centre canadien d'étude et de coopération
internationale, l'Entraide universitaire mondiale, la Fondation Paul-Gérin-Lajoie et le Service d'assistance canadienne aux organismes.
|
En 2004-2005, l'ACDI a continué à susciter la participation des médias. Outre les relations quotidiennes avec la presse, l'initiative Journalisme et développement du Programme d'information sur le développement a permis à 28 journalistes d'acquérir une expérience de
première main dans des pays en développement (majoritairement en Afrique), ce qui a eu pour effet d'assurer une importante couverture des enjeux liés au développement. Par exemple, un journaliste canadien a rédigé une série d'articles publiés dans le
Vancouver Sun
sur la lutte contre l'onchocercose, et un autre a rédigé 16 articles sur la situation en Afghanistan qui sont parus dans le
World Spectator
en Saskatchewan, lesquels
ont également été mis à la disposition de 700 journaux communautaires atteignant un public de 11 millions de lecteurs.
L'ACDI a également entrepris de sensibiliser les parlementaires afin d'accroître la compréhension et le soutien quant aux enjeux liés au développement lors d'activités à venir, telles que les comparutions devant les comités parlementaires, le lancement du Corps canadien et l'EPI. L'ACDI a répondu
aux demandes de renseignements des parlementaires, organisé des séances d'information, réinstauré un bulletin d'information et diffusé l'information par voie électronique. L'Agence a également été prévoyante en tenant les parlementaires informés de " dossiers chauds " comme l'intervention du Canada à la suite du tsunami. Les parlementaires ont continué à participer au programme d'annonces
régional, qui a permis d'annoncer des projets de développement et de discuter d'enjeux liés au développement avec des partenaires et des médias régionaux. Le Corps canadien, dans le cadre de sa stratégie d'engagement du public et de diffusion des connaissances, collabore avec le Centre parlementaire afin d'amener des membres du Parlement et des Canadiens à participer à une série de forums internationaux sur la gouvernance.
En 2004-2005, les
parlementaires canadiens se sont montrés particulièrement intéressés par l'Afrique et le Moyen-Orient. Des représentants de l'ACDI ont témoigné devant le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères en février 2005 pour expliquer la programmation en Afrique. Ils se sont aussi présentés devant le Sous-comité des droits de la personne et du développement international de la Chambre des communes
pour fournir des renseignements sur la situation au Zimbabwe.
Prenant appui sur les travaux entrepris en 2004-2005, l'ACDI met actuellement la dernière main à une nouvelle Stratégie d'engagement du public à l'échelle de l'Agence. Cette dernière décrira dans leurs grandes lignes un certain nombre d'initiatives que l'ACDI et ses partenaires devront lancer afin d'aider le public à mieux comprendre et à soutenir le programme d'aide
internationale du Canada.
Les activités visant à toucher les jeunes sont demeurées un important volet des activités de sensibilisation de l'ACDI. Par exemple, l'Initiative Le monde en classe (IMC) a permis l'introduction de 50 nouveaux projets et mis deux nouvelles ressources au service des enseignants canadiens. La première a été le centre de ressources Le monde en classe, qui est une base de données consultable de ressources de développement;
la seconde a été la
Zone des profs
sur le site Web de l'ACDI. Celle-ci avait pour objectif d'aider les éducateurs canadiens à sensibiliser les jeunes au développement international et à la participation du Canada dans ce domaine. Le Programme de stages internationaux pour les jeunes, qui relève de l'ACDI, a également continué d'offrir à de jeunes diplômés canadiens de niveau postsecondaire la possibilité
d'acquérir une expérience de travail internationale. En 2004-2005, 397 stages ont été approuvés. Depuis sa création en 1997, plus de 3 000 jeunes stagiaires se sont rendus dans divers pays dont le Bangladesh, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Pérou, le Brésil, le Nicaragua, le Malawi, l'Afrique du Sud, le Kenya et le Swaziland.
Outre les jeunes, la participation de communautés des Premières Nations est une nouvelle priorité avec
la relance du Programme de partenariat avec les peuples autochtones en mars 2005. Ce programme vise à relier des organisations canadiennes avec d'autres organisations des Amériques dans le cadre de projets de développement international. Les Canadiens y participent aussi pleinement par l'entremise du programme Partenariats pour l'avenir (PPA-II), du SACO, du Programme de gestion en matière de redressement et du Fonds canadien de coopération technique, conjointement avec la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Par l'intermédiaire de ces programmes, environ 300 Canadiens se sont rendus dans des pays d'Europe centrale et orientale et ont participé à divers échanges favorisant l'apprentissage ou le renforcement des capacités.
|
Encadré 21 : La nouvelle carte " Un monde en
développement "
|
À l'exception du site Web de l'ACDI, le moyen de communication et d'éducation du public le plus populaire - et le plus utilisé -est la carte " Un monde en développement ", remise en circulation après dix ans d'interruption. Produite par l'Agence en collaboration avec Canadian Geographic Entreprises, elle a été distribuée à grande échelle aux établissements
d'enseignement, de santé, aux médias et à d'autres institutions publiques au Canada ainsi que dans le monde entier aux ambassades, aux hauts-commissariats et à de multiples partenaires du développement.
La carte met en évidence la répartition inégale des richesses et des ressources dans le monde et attire l'attention sur le rôle du programme d'aide canadien dans la lutte contre ces inégalités. La carte a été
distribuée par l'intermédiaire du Canadian Geographic et de L'Actualité à plus de 476 000 abonnés et à quelque 15 000 écoles. L'ACDI poursuit sa campagne de distribution proactive dans le pays. Une version en ligne de la carte permet aux utilisateurs d'accéder facilement à des données économiques et démographiques sur tous les pays, établies en fonction de l'indice du développement humain des Nations Unies, et de pouvoir
les comparer.
|
Le site Web de l'ACDI attire plus de deux millions de visiteurs chaque année, parmi lesquels on compte aussi bien des étudiants, des éducateurs et des spécialistes du développement que des journalistes, des représentants élus, des membres du grand public et des représentants du secteur privé. Le site a subi certaines transformations pour faciliter la navigation et fournir des renseignements actuels et
pertinents à des auditoires très variés.
L'appui aux consultations du public est également demeuré une importante priorité en 2004-2005. En novembre 2004, la ministre de la Coopération internationale a organisé pour la troisième année consécutive les Journées de la coopération internationale de l'ACDI, un événement qui a réuni 1 400 participants. Le Fonds canadien pour l'Afrique et
l'École de journalisme et de communication de l'Université Carleton ont coanimé une importante conférence sur les jeunes et le VIH/sida, l'environnement et les jeunes touchés par la guerre en Afrique, ainsi que sur les reportages journalistiques sur les enjeux clés du développement. La conférence a attiré quelque 500 participants et été diffusée sur le canal local. L'année dernière, des responsables de la
programmation sur l'Ukraine de l'ACDI ont participé à de multiples activités de consultation menées auprès de la communauté canado-ukrainienne. L'Agence a également tenu des consultations publiques sur la responsabilisation afférente à l'aide humanitaire, les pratiques exemplaires dans le cadre de la programmation sur la gouvernance en Chine, ainsi que sur différents moyens dont la communauté canado-haïtienne peut contribuer à la
reconstruction en Haïti.
L'ACDI a maintenu ses efforts pour faire du développement international un pilier des valeurs canadiennes. Par l'entremise de son Programme d'information sur le développement, surtout de l'Initiative Médias de masse, l'Agence touche des millions de Canadiens grâce à des productions télévisées et radiophoniques, ainsi que par des initiatives visant la presse écrite et les nouveaux médias. En 2004-2005,
l'ACDI a appuyé près de 70 projets liés aux médias de masse sur tout un éventail de thèmes prioritaires en matière de développement. Parmi ces derniers, figuraient deux documentaires, diffusés sur Much Music (450 000 jeunes téléspectateurs), qui ont sensibilisé le public au travail dans les ateliers clandestins au Mexique et au Bangladesh, ainsi qu'à la participation d'artistes canadiens à des collectes de fonds
en faveur des victimes du tsunami.
Un examen du Programme canadien de coopération volontaire de l'ACDI, qui a été achevé en mars 2005, a permis de constater que les initiatives sur l'engagement du public des organismes de coopération volontaire (OCV) ont aidé les Canadiens à mieux comprendre les différentes cultures et à mieux s'ouvrir à ces dernières; ils ont aussi accru leurs connaissances sur les enjeux du
développement et leur sensibilité à ces derniers; ils ont davantage tendance à participer aux initiatives communautaires ou au développement international; et accru leur appui financier et volontaire aux OCV.
2.2.5 Renforcement institutionnel des partenaires de l'ACDI
Dans son RPP pour 2004-2005, l'ACDI a indiqué qu'au cours des trois prochaines années elle compte :
-
développer la capacité de ses
partenaires dans des domaines clés comme la gestion axée sur les résultats et l'intégration de l'égalité entre les sexes dans les programmes;
-
aider les partenaires multilatéraux à concevoir des programmes dans des secteurs importants comme la lutte au VIH/sida;
-
alimenter l'intérêt international dans la lutte contre les mines terrestres, et la désertification, en participant à des réunions
internationales en vue de planifier les progrès et de procéder à leur suivi;
-
faire la promotion de résultats efficaces et rentables au sein des conseils d'administration auxquels elle siège, tout en participant à des initiatives destinées à améliorer les pratiques des donateurs.
Le renforcement de la capacité des gouvernements et des organismes partenaires est un élément clé du
programme d'aide au développement de l'ACDI. En 2004-2005, l'Agence a milité pour l'utilisation des systèmes de gestion des finances, de planification et de prestation de services des pays partenaires, tant dans le secteur gouvernemental que non gouvernemental, pour exécuter des projets. De plus, l'Agence a dispensé des cours, de l'encadrement et offert des services de mentorat, notamment sur la gestion des finances et l'approvisionnement, l'engagement du public et la gestion
axée sur les résultats, afin de renforcer l'aide relative aux programmes.
Certains organismes ne sont pas prêts à assumer autant de responsabilités, tandis que d'autres sont au stade où ils peuvent offrir la formation et le renforcement institutionnel nécessaire. Par exemple, dans les Caraïbes, le recours accru aux organismes locaux plutôt qu'à des agents d'exécution canadiens a dans un premier temps donné lieu à des
problèmes d'établissement de rapports et à des retards. L'ACDI a passé un marché avec un consultant pour qu'il accompagne ces organismes dans la gestion axée sur les résultats et les aide à respecter d'autres exigences en matière d'établissement de rapports afin d'aplanir les difficultés. À la Direction générale de l'Afrique, la capacité du personnel de l'Agence a été renforcée
grâce une équipe multidisciplinaire d'intervention (qui incluait des spécialistes des politiques, des finances, de la passation des marchés, du rendement, de la gestion des connaissances et du droit). Cette équipe a rédigé des évaluations diagnostiques par pays. Elle a aussi appuyé la conception de programmes et les discussions sur les politiques, particulièrement dans les domaines des finances publiques et de l'approvisionnement, afin de
s'assurer que les fonds étaient dépensés judicieusement.
Le renforcement institutionnel est au cœur de plusieurs programmes de l'ACDI, dont celui de la Francophonie et le Programme panafricain. Par exemple, l'Agence a aidé l'Institut Supérieur Panafricain d'Économie Coopérative à procéder à un examen des ressources humaines qui a mené à une série de recommandations, maintenant en voie d'application. La gestion
du secrétariat de l'organisme a été renforcée et l'organisme dans son ensemble est plus efficace, davantage axé sur les résultats et plus dynamique. Le programme de partenariat canadien de l'ACDI inclut toujours un volet de renforcement des capacités dans ses activités de coopération avec les partenaires des pays en développement. L'Entraide universitaire mondiale du Canada a formé un consortium avec le Centre canadien
d'étude et de coopération internationale (CECI) dans le but précis de renforcer la capacité de leurs partenaires des pays en développement qui s'emploient à réduire la pauvreté.
L'ACDI a également renforcé les capacités de ses partenaires régionaux en 2004-2005 en donnant de la formation sur la gestion axée sur les résultats au personnel de l'OSCE et aux participants aux programmes de renforcement des
capacités dans le domaine du commerce extérieur financés par le FC A, tels que le Centre du commerce international. À la suite d'une séance de formation sur les méthodes de vérification et d'évaluation de l'ACDI, l'Agence intergouvernementale de la Francophonie a décidé de les adopter.
En 2004-2005, la collaboration de l'Agence avec les organisations multilatérales est demeurée d'une importance capitale. L'ACDI confie plus de 40 .
100 de ses programmes de développement aux organisations multilatérales comme le système de l'ONU, les banques régionales de développement et les organismes d'assistance humanitaire. L'ACDI ne fait pas que verser une aide financière à ces organismes; elle les aide aussi à accroître leur efficacité en faisant la promotion de politiques appropriées et en fournissant de l'assistance technique
(voir
l'encadré 22
)
.
En appuyant les initiatives et les organisations multilatérales, l'ACDI a continué de s'imposer comme un acteur primordial quant à certains grands enjeux mondiaux tels que la lutte contre le VIH/sida. Tel qu'indiqué précédemment, l'ACDI a généreusement contribué au Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme et à l'initiative " 3 millions d'ici 2005 " de l'OMS. Mentionnons
également l'appui de l'ACDI à la phase II du Projet du Caribbean Epidemiology Centre (CAREC) sur le VIH/sida, une initiative régionale, à plusieurs intervenants et à donateurs multiples, qui s'apparente à une approche sectorielle. La majorité des pays membres du CAREC ont pris des mesures pour renforcer leur réponse nationale à l'épidémie de VIH/sida.
(Veuillez consulter la section 2.1 du présent rapport pour obtenir des
renseignements supplémentaires sur le bilan de l'ACDI dans la lutte contre le VIH/sida)
.
|
Encadré 22 : Renforcer l'efficacité de l'aide dans le système multilatéral
|
|
Le multilatéralisme est l'une des pierres angulaires de la politique internationale du Canada. Le Canada siège au conseil d'administration
de la majorité des grandes institutions multilatérales. Il est ainsi en position de défendre ses priorités stratégiques. De plus, en versant un appui aux fonds spéciaux d'assistance technique, le Canada collabore avec les institutions elles-mêmes pour améliorer leur reddition de comptes, leurs résultats, leurs priorités et leur rendement.
L'élaboration de nouveaux outils : Le Canada a joué un rôle clé dans
l'élaboration d'un système perfectionné d'alerte rapide pour évaluer l'état nutritionnel dans les situations d'urgence. L'ACDI finance maintenant un projet pilote dans lequel l'UNICEF utilise le logiciel de ce système.
La gestion en fonction des résultats :
Le Canada a aidé la Banque asiatique de développement à adopter un cadre de mesure des résultats et a mis sur pied un fonds à donateurs multiples pour
renforcer la capacité nationale dans ce domaine. Le Canada a également incité la Banque à mieux harmoniser ses opérations dans le secteur privé avec sa stratégie de réduction de la pauvreté et les priorités de chaque pays.
Le maintien de la concentration sur l'Afrique :
La Banque mondiale, avec l'appui solide du Canada, a continué d'accorder une priorité élevée à l'Afrique. Elle veut
diriger 50 p. 100 de son aide à ce continent.
Le renforcement des activités sur le terrain :
Le Canada a appuyé le renforcement de la cohérence, de la coordination et de la capacité des équipes de pays des Nations Unies et a négocié l'intégration des enjeux hommes-femmes dans le système des coordonnateurs résidents. Le Canada a aussi appuyé la stratégie de l'ONU sur l'harmonisation et le
renforcement des communications avec les ONG.
|
En 2004-2005, l'ACDI a aidé à maintenir l'attention de la communauté internationale sur la question des mines terrestres. Elle a participé au Sommet de Nairobi pour un monde sans mines (du 29 novembre au 3 décembre 2004) et à l'élaboration du Plan d'action de Nairobi de 2005-2009. La Stratégie d'action contre les mines de 2005-2009 de l'ACDI, actuellement en cours de
rédaction, encouragera l'intégration de l'action contre les mines non seulement dans les programmes bilatéraux et humanitaires, mais aussi à l'échelon international afin de s'assurer que les niveaux de financement pour le déminage et l'aide aux survivants des mines terrestres sont maintenus jusqu'à ce que la menace soit éliminée et que la dernière victime soit réintégrée à la société.
Prenant appui sur
ses activités antérieures, l'ACDI continuera à accorder une importance prioritaire à la collaboration avec les grandes institutions multilatérales et au renforcement de leur efficacité. En appui à cet engagement, l'ACDI agit dans le cadre d'initiatives comme le Réseau d'évaluation du rendement des organisations multilatérales pour évaluer les effets de la programmation multilatérale à l'échelon des pays. Tout au
long de 2004-2005, l'ACDI a aussi déployé des efforts considérables aux préparatifs de la réunion du Sommet mondial de l'ONU de septembre 2005, y compris l'élaboration de la position du Canada concernant divers rapports importants sur les ODM et la réforme des Nations Unies.
L'EPI de 2005 réaffirme l'engagement du Canada en faveur du système multilatéral. Conformément aux orientations présentées dans
l'Énoncé, l'ACDI cherchera à atteindre le meilleur équilibre entre les voies de distribution de l'aide (bilatérale, partenariat et multilatérale) et à l'intérieur de chacune de celles-ci. Dans ce contexte, l'Agence visera à centrer son appui sur les institutions multilatérales qui sont les plus efficaces.
2.2.6 Un juste équilibre entre les programmes dirigés et les programmes spontanés
Comme l'indique le RPP de l'ACDI pour 2004-2005, l'atteinte d'un juste équilibre entre les programmes dirigés et les programmes spontanés exige des adaptations dans la manière dont l'ACDI travaille avec ses partenaires. À mesure que les partenaires assument davantage de responsabilités en matière de résultats de développement, le rôle de l'ACDI dans la conception et la gestion des initiatives s'amenuise. Toutefois, au même
moment, l'Agence cherche à obtenir des résultats plus percutants grâce à des programmes mieux ciblés, ce qui se traduit souvent par un rôle accru dans la gestion des programmes d'aide. Le défi consiste à trouver le juste équilibre entre ces deux approches.
En 2004-2005, la Direction générale du partenariat canadien a examiné tous les accords de financement de nouveaux programmes pour s'assurer qu'ils correspondent aux
priorités et aux directives de l'Agence, qui prévoient une augmentation du nombre de programmes réactifs. L'ACDI a renforcé sa programmation réactive en définissant un cadre de gestion du Programme du secteur volontaire et un plan de mise en œuvre de la Politique en matière de développement du secteur privé. L'ACDI a également adopté une approche intégrée pour s'assurer que l'on tient compte des programmes de
partenariat dans l'élaboration des cadres de programmation-pays, dans les secours d'urgence et la reconstruction après le tsunami et dans la stratégie de développement de l'ACDI pour Haïti.
Toutefois, maintenir un équilibre optimal entre les programmes réactifs et les programmes directifs n'est pas sans difficultés À mesure que l'ACDI fait des progrès dans l'application des priorités et des orientations énoncées
dans l'EPI, il faudra des efforts permanents pour veiller à trouver un équilibre entre réagir aux idées, aux innovations et aux investissements des partenaires canadiens dans le domaine du développement international et respecter les priorités de l'Agence et du gouvernement du Canada.
|
