Symboles officiels du Canada
Les symboles suivants ont été adoptés officiellement par le gouvernement du Canada au cours du dernier siècle et sont maintenant considérés comme des symboles officiels de notre pays.
Le castor
Le castor est devenu emblème officiel du Canada le 24 mars 1975, lorsqu'une « loi portant reconnaissance au castor (castor canadensis) comme symbole de la souveraineté du Canada » reçut la sanction royale. Néanmoins, le castor faisait partie de l’identité canadienne bien avant l’adoption de la Loi instituant un symbole national.

Importance historique du castor
Lorsque les premiers explorateurs européens se rendent compte que le Canada n'est pas l'Orient regorgeant d'épices qu'ils cherchent, les millions de castors qui s'y trouvent deviennent le principal attrait commercial du pays. À la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, la mode était aux chapeaux confectionnés à partir de peaux de castor. C'est ainsi que la demande pour les fourrures de castor s'accrut à mesure que ces chapeaux devenaient de plus en plus populaires.
Le roi de France, Henri IV, voit dans la traite des fourrures l'occasion d'aller chercher les revenus dont il avait tant besoin et d'établir une colonie française en Amérique du Nord. Bientôt, les commerçants de fourrures anglais et français vendent en Europe leurs peaux de castor vingt fois plus cher qu'ils ne les ont payées.
La traite des fourrures est un commerce tellement payant que plusieurs Canadiens se sentent tenus de rendre hommage à l’animal aux incisives proéminentes.
- Sir William Alexander, à qui la Nouvelle-Écosse a été concédée en 1621, est le premier à inclure le castor dans des armoiries.
- Les armoiries de la Compagnie de la Baie d'Hudson comprennent quatre castors pour démontrer l’important rôle de ce rongeur laborieux.
- On a créé une pièce de monnaie d'une valeur égale à une peau de castor mâle connue, en anglais, sous le nom de « buck ».
- En 1678, Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France, propose pour la ville de Québec des armoiries contenant un castor, celui-ci étant à son avis un emblème approprié pour la colonie.
- En 1690, pour commémorer la résistance victorieuse des Français à Québec, la médaille « Kebeca Liberata » est frappée: une femme assise, symbolisant la France, avec un castor à ses pieds, représentant le Canada, figure au revers de la médaille.
- Le castor est également inclus dans les armes de la ville de Montréal en 1833, lorsque celle-ci devint une municipalité.
- En 1851, sir Sandford Fleming assure la postérité au castor à titre de symbole national lorsqu'il choisit de le représenter sur le premier timbre-poste canadien le « Castor de trois pence ».
- Le castor apparaît dans le cartouche de titre du journal Le Canadien, publié dans le Bas-CanadaNote de bas de page 1.
- Pendant un certain temps, le castor fut l'un des emblèmes de la Société Saint-Jean-Baptiste.
- La société de chemins de fer Canadien Pacifique l’inclut encore aujourd’hui dans son logo.
Malgré cette reconnaissance, le castor était en voie d'extinction au milieu du XIXe siècle. Avant le début du commerce des fourrures, on estime qu'il y avait six millions de spécimens au pays. Au plus fort du commerce, 100 000 peaux étaient expédiées en Europe chaque année, le castor canadien était en danger de disparaître. Fort heureusement cependant, le goût des Européens pour les frivolités se tourne vers les hauts-de-forme et la demande pour les peaux de castor s'effrite complètement.
Aujourd'hui, grâce aux techniques de préservation de la faune et aux hauts-de-forme, le castor, le plus gros rongeur du Canada, survit et prospère dans tout le pays.
Les armoiries
Au Moyen Âge, les armoiries servaient de marque d'identité, notamment sur les champs de bataille où elles permettaient de distinguer les alliés des ennemis. Il est important de noter que les armoiries jouent un rôle essentiel dans la conservation des traditions et l'inspiration de l'amour de la patrie.
Les armoiries du Canada furent d’abord adoptées par Sa Majesté le roi George V en 1921. En 1994, un ruban rouge a été ajouté aux armoiries, affichant la devise de l'Ordre du Canada, Desirantes Meliorem Patriam (Ils aspirent à une meilleure patrie) – la Sainte Bible (épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 16).
Modèle des armoiries du Canada
La version actuelle des armoiries du Canada a été dessinée par madame Cathy Bursey-Sabourin, Héraut FraserNote de bas de page 2 de l’Autorité héraldique du CanadaNote de bas de page 3au Bureau du gouverneur général du Canada. Cette version reproduit fidèlement les armoiries décrites dans la Proclamation royale du 21 novembre 1921. Ce modèle montrait ce qui suit :
- Les symboles des quatre nations fondatrices du Canada ornent l’écu (les trois léopardsNote de bas de page 4 d'Angleterre, le lion d'Écosse, la fleur de lis de France et la harpe irlandaise de Tara).
- Le lion d'Angleterre déployant la bannière du Royaume-Uni et la licorne d'Écosse déployant le drapeau du royaume français.
- L'emblème floral à la base des armoiries reprend les symboles royaux : la rose anglaise, le chardon écossais, le lis français et le trèfle irlandais.
- La couronne royale qui surmonte les armoiries les identifie comme celles de la souveraine du Canada. On les appelle souvent les armoiries royales du Canada ou les armoiries du Canada.

Où trouve-t-on les armoiries du Canada
Les armoiries du Canada sont utilisées sur les possessions du gouvernement fédéral : édifices, sceaux officiels, monnaie, passeports, proclamations et publications. Elles sont également reproduites sur les insignes de grade de certains membres des Forces canadiennes. Les armoiries du Canada sont également utilisées par les institutions fédérales comme la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale et la Cour canadienne de l'impôt afin de marquer leur indépendance judiciaire du gouvernement du Canada.
La devise
L'usage héraldique qui consiste à ajouter à des armoiries une inscription exprimant une pensée appropriée a été observé par le Canada et par 8 des 10 provinces. Les deux territoires n'ont pas de devise, mais beaucoup de municipalités en ont.
A Mari Usque Ad Mare, traduit officiellement par « d'un océan à l'autre » et « From Sea to Sea » est tiré du livre des Psaumes de la Bible, chapitre 72, verset 8.
Le tartan de la feuille d’érable
Le tartan de la feuille d'érable est déclaré symbole officiel national le 9 mars 2011.
Le tartan de la feuille d'érable est créé en 1964 par David Weiser, en prévision du 100e anniversaire du Canada, en 1967. Inspiré des couleurs que prennent les feuilles d'érable au fil des saisons, le motif du tartan intègre le vert de l'été, l'or du début de l'automne, le rouge qui apparaît aux premières gelées et le brun des feuilles mortes.

Le corps de cornemuse du 2e Bataillon du Royal Canadian Regiment a adopté le tartan de la feuille d'érable, de même que les 2e, 3e et 4e Bataillons. Symbole de fierté nationale, le tartan a été conçu pour être porté par les Canadiens de toutes origines, peu importe leurs ancêtres, en particulier à l'occasion de journées nationales comme le 1er juillet (fête du Canada) et le 6 avril (Jour du tartan).
L’érable
Bien que la feuille d'érable soit étroitement associée au Canada, l'érable n'avait jamais été officiellement reconnu comme l'emblème arboricole du Canada jusqu'en 1996.
Des 150 espèces d'érable connues (genre Acer), 13 seulement sont indigènes en Amérique du Nord. Dix d'entre elles poussent au Canada : l'érable à sucre, l'érable noir, l'érable grandi folié, l'érable argenté, l'érable rouge, l'érable à épis, l'érable de Pennsylvanie, l'érable glabre de Drummond, l'érable circiné et l'érable négondo. Au moins une des 10 espèces pousse naturellement dans chaque province. C'est l'érable en tant qu'espèce qui est reconnu comme emblème du Canada.
Les arbres ont joué un rôle important dans l'histoire du Canada et ils conservent aujourd'hui un intérêt commercial, environnemental et esthétique. L'érable est une source de précieux produits en bois et il alimente l'industrie du sucre d'érable. Cet arbre fait la promotion du Canada de façon idéale comme chef de file mondial de la gestion durable des forêts.
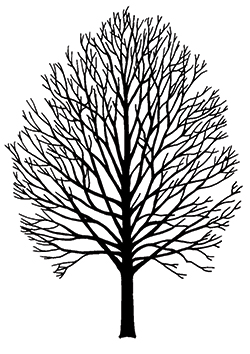
L’hymne national
L’« Ô Canada! » a été proclamé hymne national le 1er juillet 1980, un siècle après avoir été chanté pour la première fois, le 24 juin 1880 à Québec.
La musique est l'oeuvre de Calixa Lavallée, célèbre compositeur né à Verchères (Canada EstNote de bas de page 5), et les paroles françaises sont d'Adolphe-Basile Routhier qui, lui, est né à St-Placide (Bas-Canada). Au cours des années, il est apparu de nombreuses versions anglaises de ce chant. La version anglaise officielle se fonde sur celle que Robert Stanley Weir, né à Hamilton (Ontario) a composée en 1908.
Lisez la genèse de l’Ô Canada ! et apprenez-en davantage sur les gens derrière l’hymne.
Le drapeau national
Avec sa feuille d’érable distinctive, le drapeau rouge et blanc du Canada est facile à reconnaître partout dans le monde.
Le drapeau national a été adopté en 1965, à la suite d'années de discussions sur des milliers de schémas, puis d'un débat houleux au Parlement. La quête d'un drapeau canadien distinct commence en 1925, lorsqu'un comité du Conseil privé est chargé d'étudier les dessins proposés pour le nouvel emblème national. En 1946, un comité parlementaire examine plus de 2 600 propositions, mais ses membres ne réussissent pas à s'entendre sur le modèle d'un nouveau drapeau. Cependant, à l'approche du centenaire de la Confédération, le Parlement redouble d'efforts pour en arriver à un choix.
Notre drapeau actuel est déployé pour la première fois le 15 février 1965, sur la Colline du Parlement. Le motif rouge-blanc-rouge reprend le motif du drapeau du Collège militaire royal du Canada et du ruban de la Médaille pour services généraux de 1899, une décoration britannique accordée aux soldats qui avaient défendu le Canada dans les batailles du XIXe siècle. La feuille a onze pointes. Ses dimensions sont deux de longueur sur un de largeur.
Tout le pays commémore la journée du Drapeau national du Canada, le 15 février de chaque année.
Apprenez-en davantage sur le drapeau national du Canada, dont son histoire et ses dimensions, l’étiquette à suivre et les règles concernant sa mise en berne.
Le cheval national
Bien que ce soit en 1909 que le Parlement du Canada ait décrété que le cheval canadien était la race nationale, ce n’est qu’en mai 2002 qu'il est devenu le cheval national du Canada, en vertu d’une loi du Parlement.
Les origines du cheval canadien remontent en 1665. À cette époque, le roi de France envoyait des chevaux des écuries royales en Nouvelle-France Ces chevaux normands et bretons étaient d'origines diverses : des chevaux arabes, barbes et andalous. Au cours du siècle suivant, la population de chevaux de la Nouvelle-France s'est développée indépendamment des autres races et, avec le temps, elle est devenue une race en soi, qu'on appelle le cheval canadien.
Cette race se caractérise par sa force, son endurance, sa résilience, son intelligence et son calme. Comme elle était menacée d'extinction à la fin du XIXe siècle, on a déployé des efforts, qui se sont poursuivis pendant tout le XXe siècle, pour préserver cette race unique.

Les sports nationaux
Le Parlement du Canada a déclaré le hockey sur glace comme étant le sport national d'hiver du Canada, et la crosse comme le sport national d'été du Canada en sanctionnant la Loi sur les sports nationaux du Canada le 12 mai 1994.
Informez-vous sur le sport au Canada.

Les couleurs nationales
Le rouge et le blanc deviennent les couleurs officielles à la proclamation des armoiries du Canada par le roi George V en 1921.Néanmoins, l'histoire officielle remonte à la première croisade, au XIe siècle.
Bohémond 1er, seigneur normand, avait fait découper des croix rouges dans ses manteaux pour ensuite les distribuer à 10 000 croisés qui les portèrent sur leurs vêtements comme signe distinctif.
Aux croisades suivantes, chaque nation fut désignée par une croix de couleur différente. La France conserva longtemps la croix rouge sur ses bannières tandis que l'Angleterre portait une croix blanche. Avec le temps, le rouge et le blanc devinrent tour à tour les couleurs nationales de la France et de l'Angleterre.